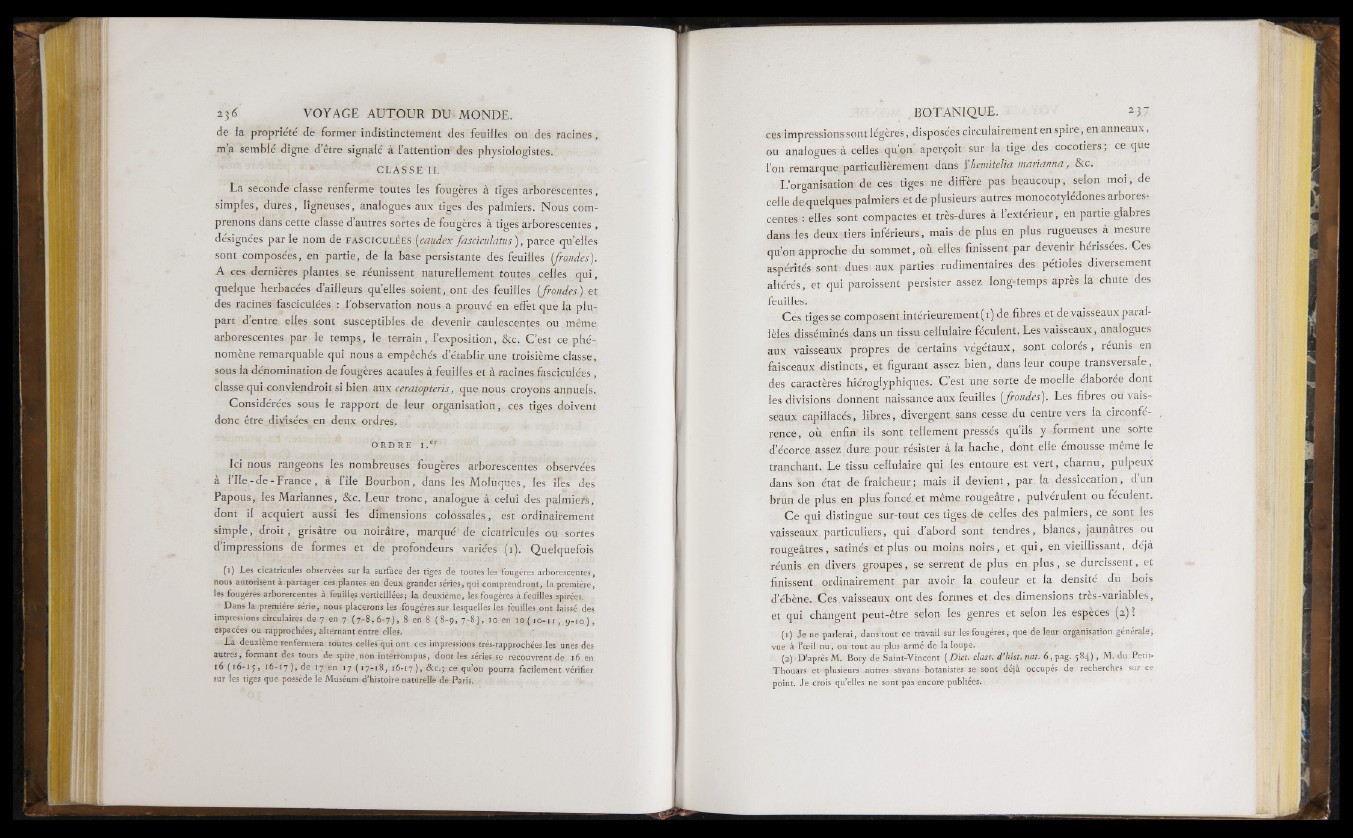
de la propriété de former indistinctement des feuilles ou des racines ,
m’a semblé digne d’être signalé à l’attention des physiologistes.
C L A S S E I I .
La seconde classe renferme toutes les fougères à tiges arborescentes,
simples, dures, ligneuses, analogues aux tiges des palmiers. Nous comprenons
dans cette classe d’autres sortes de fougères à tiges arborescentes ,
désignées p a r le nom de f a s c i c u l é e s [caiidex fasciculatus), parce quelles
sont composées, en partie, de ia base persistante des feuilles [frondes).
A ces dernières piantes se réunissent naturellement tontes celles qui,
quelque herbacées d’ailleurs qu’elles soient, ont des feuilles [frondes ) et
des racines fasciculées : i’observation nous a prouvé en effet que la plupart
d’entre elles sont susceptibles de devenir caulescentes ou même
arborescentes par ie temps, le terrain, l’exposition, &c. C ’est ce phénomène
remarquable qui nous a empêchés d’établir une troisième classe,
sous la dénomination de fougères acaules à feuilles et à racines fasciculées ,
classe qui conviendroit si bien aux ceratopteris, que nous croyons annuels.
Considérées sous le rapport de leur organisation, ces tiges doivent
donc être divisées en deux ordres.
O R D R E
Ici nous rangeons les nombreuses fougères arborescentes observées
à l ’Iie - de - France , à l’île Bourbon , dans les Moluques, ies îles des
Papous, les Mariannes, &c. Leur tronc, analogue à celui des palmiers,
dont il acquiert aussi ies dimensions colossales, est ordinairement
simple, dro it, grisâtre ou noirâtre, marqué de cicatricules ou sortes
d’impressions de formes et de profondeurs variées (i). Quelquefois
( i) Les cicatricules observées sur la surface des tiges de toutes ies fougères arborescentes,
nous autorisent à partager ces plantes en deux grandes séries, qui comprendront, ia première,
les fougères arborercentes à feuilles verticillées; la deuxième, les fougères à feuilles spirées.
Dans la première série, nous placerons les fougères sur lesquelles les feuilles ont laissé des
impressions circulaires de 7 en 7 (7 -8 , 6 - 7 ) , 8 en 8 ( 8-9 , 7 - 8 ) , 10 en 10 ( l O - i i , y - i o ) ,
espacées ou rapprochées, alternant entre elles.
L a deuxième renfermera toutes c e lle s 'q u io n t ces impressions très-rapprochées les unes des
autres, formant des tours de spire non interrompus, dont les séries se recouvrent de 16 en
1 6 ( 1 6 - 1 5 , 16 - 17 ) , de 1 7 en 1 7 ( 1 7 - 1 8 , 1 6 - 1 7 ) , 6cc.; ce qu’on pourra facilement vérifier
sur les tiges que possède le Muséum d’histoire naturelle de Paris.
ces impressions sont légères, disposées circniairement en spire, en anneaux,
ou analogues à celles qu’on aperçoit sur la tige des cocotiers; ce que
l’on remarque particulièrement dans ihemitelia marianna, &c.
L ’organisation de ces tiges ne diffère pas beaucoup, selon moi, de
celle de quelques palmiers et de plusieurs autres monocotylédones arborescentes
; elles sont compactes et très-dures à l’extérieur, en partie glabres
dans ies deux tiers inférieurs, mais de plus en pins rugueuses à mesure
qu’on approche du sommet, où elles finissent par devenir hérissées. Ces
aspérités sont dues aux parties rudimentaires des pétioles diversement
altérés, et qui paroissent persister assez long-temps après la chute des
feuilles.
Ces tiges se composent intérieurement (i) de fibres et de vaisseaux parallèles
disséminés dans un tissu cellulaire féculent. Les vaisseaux, analogues
aux vaisseaux propres de certains végétaux, sont colorés, réunis en
faisceaux distincts, et figurant assez bien, dans ieur coupe transversale,
des caractères hiéroglyphiques. C ’est une sorte de moelle élaborée dont
les divisions donnent naissance aux feuilles [frondes). Les fibres ou vaisseaux
capillacés, libres, divergent sans cesse du centre vers la circonférence,
où enfin ils sont tellement pressés qu’ils y forment une sorte
d’écorce assez dure pour résister à la hache, dont elle emousse meme le
tranchant. Le tissu cellulaire qui les entoure est ve rt, charnu, pulpeux
dans son état de fraîcheur; mais il devient, par la dessiccation, d’un
brun de plus en plus foncé et même rougeâtre , pulvérulent ou féculent.
C e qui distingue sur-tout ces tiges de celles des palmiers, ce sont les
vaisseaux particuliers, qui d’abord sont tendres, blancs, jaunâtres ou
rougeâtres, satinés et pius ou moins noirs, et q u i, en vieillissant, déjà
réunis en divers groupes, se serrent de plus en p lu s , se durcissent, et
finissent ordinairement par avoir la couleur et la densité du bois
d’ébène. Ces vaisseaux ont des formes et des dimensions très-variables,
et qui changent peut-être selon les genres et selon les espèces (2) î
(r) Je ne parlerai, dans tout ce travail sur les fougères, que de leur organisation générale,
vue à l’oeil n u , ou tout au plus armé de la loupe.
(2) D ’après M. Bory de Saint-Vincent (D ic t . clasî. d ’ hist. nat. 6 , pag. 584) , M. du Petit-
Thouars et plusieurs autres savans botanistes se sont déjà occupés de recherches sur ce
point. Je crois qu’elles ne sont pas encore publiées.