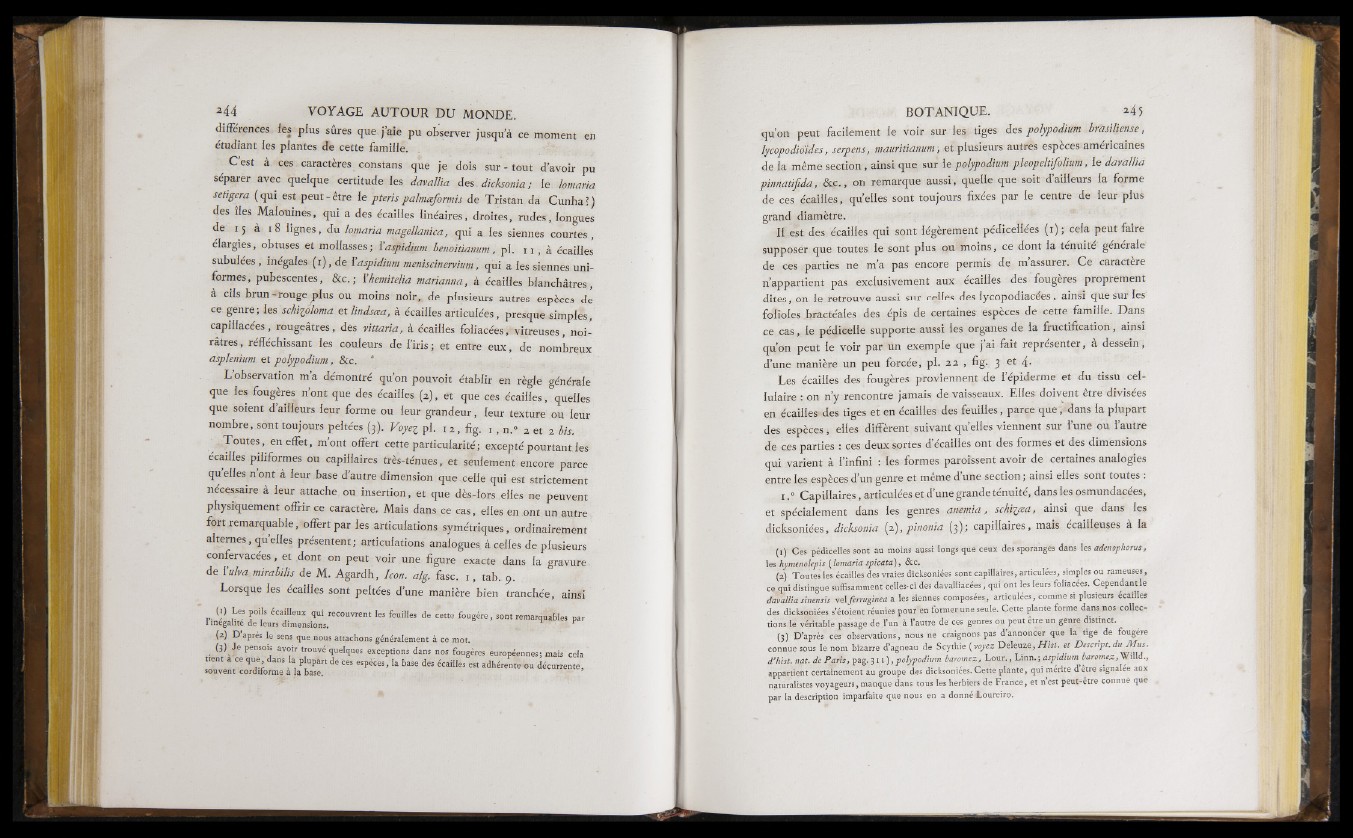
differances les plus sûres que j ’aie pu observer jusqu’à ce moment en
étudiant les plantes de cette famille.
C ’est à ces caractères constans que je dois sur - tout d’avoir pu
séparer avec quelque certitude les davallia des dicksonia; le lomaria
setigera (qui est peut-être le pterispalmceformis de Tristan da C u n b a !)
des îles Malouines, qui a des écailles linéaires, droites, rudes, longues
de 15 à 18 lignes, du lomaria magellanica, qui a les siennes courtes ,
élargies, obtuses et mollasses; Xaspidium benoitianum, pi. 11 , à écailles
subulées , inégales ( i ) , de Xaspidium menisdnervium, qui a les siennes uniformes,
pubescentes, &c. ; Xhemitelia marianna, à écailles blanchâtres,
à cils brun-rouge plus ou moins noir, de plusieurs autres espèces de
ce genre; les schiioloma et lindsoea, à écailles articulées, presque simples,
capillacées, rougeâtres, des vittaria, à écailles foliacées, vitreuses, noirâtres,
réfléchissant les couleurs de l’iris; et entre eu x , de nombreux
asplénium et polypodium, &c. "
L ’observation m’a démontré qu’on pouvoit établir en règle générale
que les fougères n’ont que des écailles (2), et que ces écailles, quelles
que soient d ailleurs leur forme ou leur grandeur, leur texture ou leur
nombre, sont toujours peitées (3). Voyez pl. 12 , fig. i , n.» 2 et 2 bis.
T ou te s , en effet, m’ont offert cette particularité ; excepté pourtant les
écailles piliformes ou capillaires très-ténues, et seulement encore parce
qu’elles n’ont à leur base d’autre dimension que celle qui est strictement
nécessaire à leur attache ou insertion, et que dès-lors elles ne peuvent
physiquement offrir ce caractère. Mais dans ce cas, elles en ont un autre
fort remarquable, offert par les articulations symétriques, ordinairement
alternes, qu’elles présentent; articulations analogues à celles de plusieurs
confervacees , et dont on peut voir une figure exacte dans la gravure
de Xulva mirabilis de M. Agardh, Icon. alg. fasc. i , tab. 9.
Lorsque les écailles sont peitées d’une manière bien tranchée, ainsi
(1) Les poils écailleux qui recouvrent les feuilles de cette fo u g è re , sont remarquables par
1 inégalité de leurs dimensions.
(2) D ’après le sens que nous attachons généralement à ce mot.
(3) Je pensois avoir trouvé quelques exceptions dans nos fougères européennes; mais cela
tient a ce que dans la plupart de ces espèces, la base des écailles est adhérente ou décurrente,
souvent cordiforme a la base.
qu’on peut facilement le voir sur ies tiges des polypodium hrasiliense,
lycopodioides, serpens, mauritianum, et plusieurs autres espèces américaines
de la même section , ainsi que sur le polypodium pleopeltifolium, le davallia
pinnatifida, & c . , on remarque aussi, quelle que soit d’ailleurs la forme
de ces écailles, qu’elles sont toujours fixées par le centre de ieur pius
grand diamètre.
Il est des écailles qui sont légèrement pédicellées (i) ; cela peut faire
supposer que toutes ie sont pius ou moins, ce dont la ténuité generaie
de ces parties ne m’a pas encore permis de m’assurer. C e caractère
n’appartient pas exclusivement aux écailles des fougères proprement
dites, on le retrouve aussi sur celles des lycopodiacees, ainsi que sur les
folioles bractéales des épis de certaines espèces de cette famille. Dans
ce c a s , le pédicelle supporte aussi ies organes de la fructification, ainsi
qu’on peut ie voir par un exemple que j ai fait représenter, a dessein,
d’une manière un peu forcée, pl. 22 , fig. 3 et 4 -
Les écailles des fougères proviennent de l’épiderme et du tissu cellulaire
1 on n’y rencontre jamais de vaisseaux. Elles doivent etre divisées
en écailles des tiges et en écailles des feuiiies, parce q u e , dans la plupart
des espèces, eiles diffèrent suivant qu’elles viennent sur l’une ou l’autre
de ces parties : ces deux sortes d’écailles ont des formes et des dimensions
qui varient à i’infini : les formes paroissent avoir de certaines analogies
entre les espèces d’un genre et même d’une section ; ainsi eiles sont toutes :
i.° Gapiiiaires , articulées et d’une grande ténuité, dans ies osmundacées,
et spécialement dans ies genres anemia, schizoea, ainsi que dans les
dicksoniées, dicksonia (2), pinonia (3); capillaires, mais écailleuses à la
(1) C e s pédicelles sont au moins aussi longs que ceux des sporanges dans les adenophorus,
les hymenolepis [lomaría spicata) ^ & c .
(2) Toutes les écailles des vraies dicksoniées sont capillaires, articulées, simples ou rameuses,
ce qui distingue suffisamment celles-ci des davallia cées, qui ont les leurs foliacées. Cependant le
davallia sinensis velferruginea a les siennes composées, articulées, comme si plusieurs écailles
des dicksoniées s’étoient réunies pour en former une seule. Ce tte p kn te forme dans nos co lle ctions
le véritable passage de l’un à l’ autre de ces genres ou peut être un genre distinct.
(3) D ’après ces observations, nous ne craignons pas d annoncer que la tige de fougère
connue sous le nom bizarre d’ agneau de Scythie (voyez D e le u z e , H is t . et Descript.du M u s .
d ’ hist. nat. de P a r is , pag. 31 1 ) , polypodium baromez, L o u r ., Linn. ; aspidium baro,nez, W illd .,
appartient certainement au groupe des dicksoniées. C e tte plante, qui mérite d’être signalée aux
naturalistes voyageurs, manque dans tous les herbiers de F ranc e , et n’est peut-être connue que
par la description imparfaite que nous en a donné Loureiro.