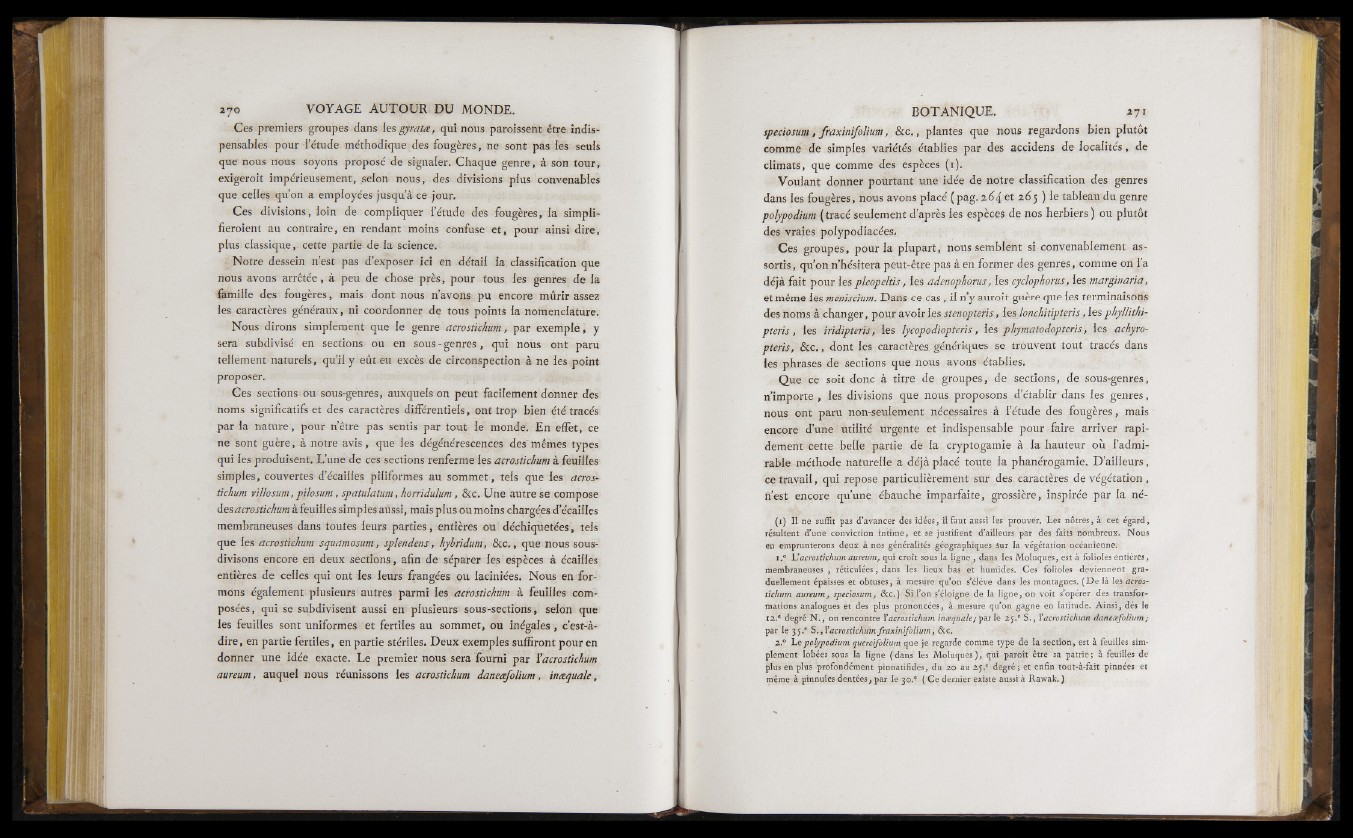
Ces premiers groupes dans les gyrata, qui nous paroissent être indispensables
pour l’e'tude méthodique des fougères, ne sont pas les seuls
que nous nous soyons proposé de signaler. Chaque genre, à son tour,
exigeroit impérieusement, selon nous, des divisions plus convenables
que celles qu’on a employées jusqu’à ce jour,
Ces divisions, ioin de compliquer l’étude des fougères, la simpli-
fieroient au contraire, en rendant moins confuse e t , pour ainsi dire,
plus classique, cette partie de la science.
Notre dessein n’est pas d’exposer ici en détail la classification que
nous avons arrêtée, à peu de chose près, pour tous les genres de la
famille des fougères, mais dont nous n’avons pu encore mûrir assez
les caractères généraux, ni coordonner de tous points la nomenclature.
Nous dirons simplement que le genre acrostichum, par exemple, y
sera subdivisé en sections ou en sous -g enre s, qui nous ont paru
tellement naturels, qu’il y eût eu excès de circonspection à ne les point
proposer.
Ces sections ou sous-genres, auxquels on peut facilement donner des
noms significatifs et des caractères différentiels, ont trop bien été tracés
par la nature, pour n’être pas sentis par tout le monde. En effet, ce
ne sont guère, à notre a v is , qne les dégénérescences des mêmes types
qui les produisent. L ’une de ces sections renferme les acrostichum à feuilles
simples, couvertes d’écailles piliformes au sommet, tels que les acrostichum
viJlosim, pilosum, spatiilatum, horridulum, & c. Une autre se compose
¿as acrostichum kfevàiïes simples aussi, mais plus ou moins chargées d’écailles
membraneuses dans toutes leurs parties, entières ou déchiquetées, tels
que les acrostichum squamosum, splendens, hybridum, & c . , que nous sous-
divisons encore en deux sections, afin de séparer les espèces à écailles
entières de celles qui ont les leurs frangées ou laciniées. Nous en formons
également plusieurs autres parmi les acrostichum à feuilles composées,
qui se subdivisent aussi en plusieurs sous-sections, selon que
les feuiiies sont uniformes et fertiles au sommet, ou inégales , c’est-à-
dire , en partie fertiles, en partie stériles. Deux exemples suffiront pour en
donner une idée exacte. Le premier nous sera fourni par ïacrostichum
aureum, auquel nous réunissons les acrostichum daneafolium, inaquale,
:l , . v
speciosum, fraxinifolium, & c . , plantes que nous regardons bien plutôt
comme de simples variétés établies par des accidens de lo c a lité s , de
climats, que comme des espèces (i).
Voulant donner pourtant une idée de notre classification des genres
dans les fougères, nous avons placé ( pag. 264 et 265 ) le tableau du genre
polypodium (tracé seulement d’après les espèces de nos herbiers) ou plutôt
des vraies polypodiacées.
Ces groupes, pour la plupart, nous semblent si convenablement assortis,
qu’on n’hésitera peut-être pas à en former des genres, comme on l’a
déjà fait pour les pleopeltis, les adenophorus, ies cyclophorus, les marginaria,
et même les meniscium. Dans ce c a s , il n’y auroit guère que les terminaisons
des noms à changer, pour avoir les stenopteris, ies lonchitipteris, les phyUithi-
pteris, les iridipteris, les lycopodiopteris, les phymatodoptcris, ies achyro-
pteris, & c . , dont les caractères génériques se trouvent tout tracés dans
les phrases de sections que nous avons établies.
Qu e ce soit donc à titre de groupes, de sections, de sous-genres,
n’importe , les divisions que nous proposons d’établir dans les genres,
nous ont paru non-seulement nécessaires à l’étude des fougères, mais
encore d’une utilité urgente et indispensable pour faire arriver rapidement
cette belle partie de la cryptogamie à la hauteur où l’admirable
méthode naturelle a déjà placé toute la phanérogamie. D ’a illeurs,
ce trav ail, qui repose particulièrement sur des caractères de végétation ,
n’est encore qu’une ébauche imparfaite, grossière, inspirée par la né-
( i) II ne suffit pas d’avancer des idées, il faut aussi les prouver. Les nôtres, à ce t égard,
résultent d’une conviction intime, et se justifient d’ailleurs par des faits nombreux. Nous
en emprunterons deux à nos généralités géographiques sur la végétation océanienne.
1.° acrostichum aureum, qui croît sous la ligne , dans les Moluques, est à folioles entières,
memb raneuses, réticulées , dans les lieux bas et humides. C e s folioles deviennent graduellement
épaisses et obtuses, à mesure qu’on s’élève dans les montagnes. (D e là les acrostichum
aureum, speciosum, & c .) S i l’on s’éloigne de la lig n e , on voit s’opérer des transformations
analogues et des plus prononcées, à mesure qu’on gagne en latitude. A in s i , dès le
12.® degré N . , on rencontre Y acrostichum inæquale; par le 25.® S . , Yacrostichum daneoefolium ;
par le 35.® S . ,Y acrostichum fraxinifolium, & c .
2.° luQpolypodium quercifolium que je regarde comme type de la section, est à feuilles simplement
lobées sous la ligne (dans les M o lu q u e s ) , qui paroît être sa patr ie; à feuilles de
plus en plus profondément pinnatifides, du 20 au 25.*= deg ré ; et enfin tout-à-fait pinnées et
même à pinnules d entées , par le 30.' ( C e dernier existe aussi à Rawak. )