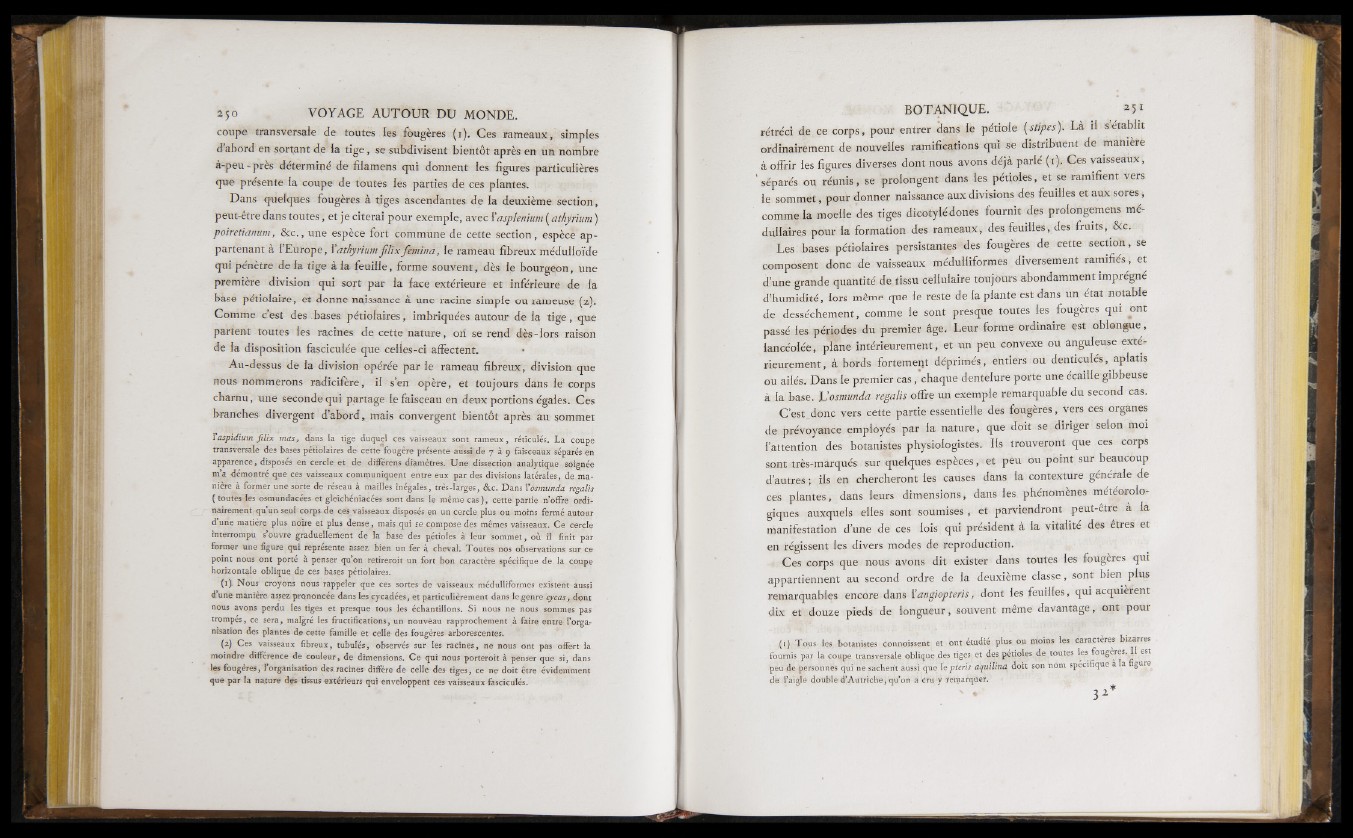
coupe transversale de toutes les fougères (i). Ces rameaux, simples
d’abord en sortant de la t ig e , se subdivisent bientôt après en un nombre
à-peu-près déterminé de filamens qui donnent les figures particulières
que présente la coupe de toutes les parties de ces plantes.
Dans quelques fougères à tiges ascendantes de la deuxième section,
peut-etre dans toutes , et je citerai pour exemple, avec Xasplénium ( athyrium )
poiretianum, & c ., une espèce fort commune de cette section, espèce appartenant
à l’Europe, X athyrium f l i x femina, le rameau fibreux médulloïde
qui pénètre d e là tige à la feuille, forme souvent, dès le bourgeon, une
première division qui sort par ia face extérieure et inférieure de la
base pétiolaire, et donne naissance à une racine simple ou rameuse (2).
Comme c’est des bases pétiolaires, imbriquées autour de la tig e , que
partent toutes les racines de cette nature, on se rend dès-lors raison
de la disposition fasciculée que celles-ci affectent.
Au-dessus de la division opérée par le rameau fibreux, division que
nous nommerons radicifère, il s’en opère, et toujours dans ie corps
cbarnii, une seconde qui partage le faisceau en deux portions égaies. Ces
branches divergent d’abord, mais convergent bientôt après au sommet
Y aspidium f i lix mas, dans la tige duquel ces vaisseaux sont rameux , réticulés. L a coupe
transversale des bases pétiolaires de cette fougère présente aussi de 7 à 9 faisceaux séparés en
apparence, disposes en cercle et de différens diamètres. U n e dissection analytique soignée
m’a démontré que ces vaisseaux communiquent entre eux par des divisions latérales, de manière
à former une sorte de réseau à mailles inégales, très-larges, & c . Dans l’osmunda regalis
(toutes les osmundacées et gleichéniacées sont dans le même c a s ) , cette partie n’offre ordinairement
qu un seul corps de ces vaisseaux disposés en un cercle plus ou moins fermé autour
dune matière plus noire et plus dense, mais qui ie compose des mêmes vaisseaux. C e cercle
interrompu s’ouvre graduellement de la base des pétioles à leur sommet, où il finit par
former une figure qui représente assez bien un fer à ch e v a l Toutes nos observations sur ce
point nous ont porté a penser qu’on retireroit un fort bon caractère spécifique de la coupe
horizontale oblique de ces bases pétiolaires.
(1) Nous croyons nous rappeler que ces sortes de vaisseaux médulliformes existent aussi
d une manière assez prononcée dans les cycadées, et particulièrement dans le genre cycas, dont
nous avons perdu les tiges et presque tous les échantillons. S i nous ne nous sommes pas
trompés, ce sera, malgré les fructifications, un nouveau rapprochement à faire entre l’organisation
des plantes de cette famille et celle des fougères arborescentes.
(2) C e s vaisseaux fibreux, tubulés, observés sur les racines, ne nous ont pas offert la
moindre différence de couleur, de dimensions. C e qui nous porteroit à penser que si, dans
les fougères, I organisation des racines diffère de celle des tiges, ce ne doit être évidemment
que par la nature des tissus extérieurs qui enveloppent ces vaisseaux fasciculés.
rétréci de ce corps, pour entrer dans le pétiole [stipes). La il s établit
ordinairement de nouveiles ramifications qui se distribuent de manière
à offrir les figures diverses dont nous avons déjà parlé (i). Ces vaisseaux,
'séparés ou réunis, se prolongent dans ies pétioles, et se ramifient vers
le sommet, pour donner naissance aux divisions des feuilles et aux sores,
comme ia moeile des tiges dicotylédones fournit des prolongemens mé-
duliaires pour ia formation des rameaux, des feuiiies, des fruits, &c.
Les bases pétioiaires persistantes des fougères de cette sec tion, se
composent donc de vaisseaux médulliformes diversement ramifiés, et
d’une grande quantité de tissu ceiiuiaire toujours abondamment imprégné
d’humidité, iors même que le reste de la plante est dans un état notable
de dessèchement, comme le sont presque tontes les fougères qui ont
passé les périodes du premier âge. Leur forme ordinaire est ob longue,
iancéoiée, plane intérieurement, et nn peu convexe on anguleuse extérieurement,
à bords fortement déprimés, entiers ou denticulés, aplatis
ou ailés. Dans le premier cas, chaque dentelure porte une écaiile gibbeuse
à la base. Idosmunda regalis offre un exemple remarquable du second cas.
C ’est donc vers cette partie essentielle des fougères, vers ces organes
de prévoyance employés par ia nature, que doit se diriger selon moi
l’attention des botanistes physiologistes. Ils trouveront qne ces corps
sont très-marqués sur quelques espèces, et peu ou point sur beaucoup
d’autres ; ils en chercheront ies causes dans la contexture générale de
ces plantes, dans leurs dimensions, dans les phénomènes météorologiques
auxquels elles sont soumises , et parviendront peut-être à la
manifestation d’une de ces lois qui président à ia vitalité des eties et
en régissent les divers modes de reproduction.
Ces corps que nous avons dit exister dans tontes les fougères qui
appartiennent au second ordre de la deuxième classe , sont bien plus
remarquables encore dans Xangiopteris, dont ies feuilles, qui acquièrent
dix et douze pieds de longueur , souvent même davantage, ont pour
( i) T o u s les botanistes connoissent et ont étudié plus ou moins les caractères bizarres
fournis par la coupe transversale oblique des tiges et des pétioles de toutes les fougères. Il est
peu de personnes qui ne sachent aussi que \e pteris aquilina doit son nom spécifique a la figure
de l’ aigle double d’A u tr ich e , qu’on a cru y remarquer.