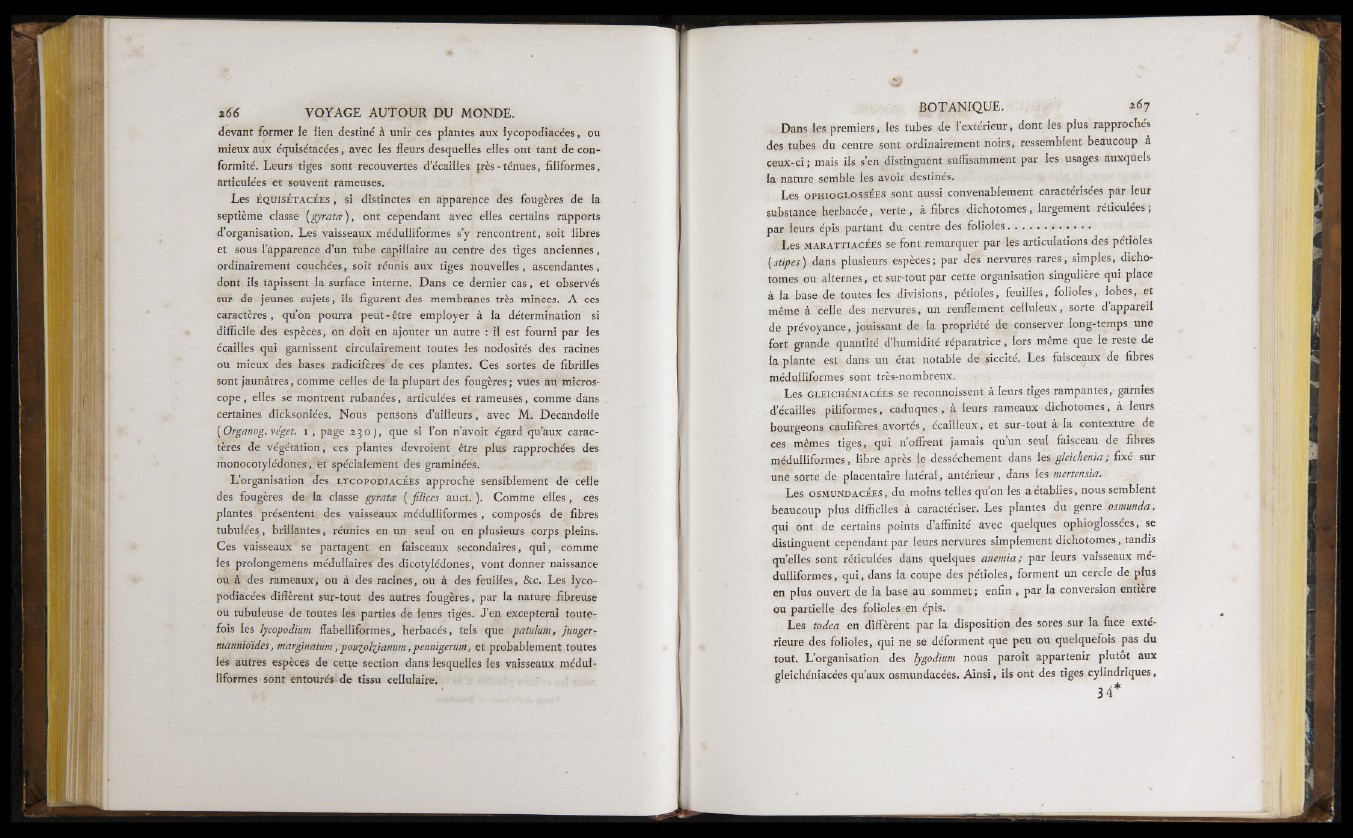
devant former le lien destiné à unir ces plantes aux lycopodiacées, ou
mieux aux équisétacées, avec les fleurs desquelles elles ont tant de conformité.
Leurs tiges sont recouvertes d’écailles très-ténues, filiformes,
articulées et souvent rameuses.
Les ÉQUISÉTACÉES, si distinctes en apparence des fougères de la
septième classe (gyrûtoe), ont cependant avec elles certains rapports
d’organisation. Les vaisseaux médulliformes s’y rencontrent, soit libres
et sous l’apparence d’un tube capillaire au centre des tiges anciennes ,
ordinairement couchées, soit réunis aux tiges nouvelles, ascendantes,
dont ils tapissent la surface interne. Dans ce dernier c a s , et observés
sur de jeunes sujets, iis figurent des membranes très-minces. A ces
caractères, qu’on pourra peut-être employer à la détermination si
difficile des espèces, on doit en ajouter un autre : il est fourni par les
écailles qui garnissent circniairement toutes les nodosités des racines
ou mieux des bases radiciferes de ces plantes. Ces sortes de fibrilles
sont jaunâtres, comme celles de la plupart des fougères ; vues au microscope
, elles se montrent riibanées, articulées et rameuses, comme dans
certaines dicksoniées. Nous pensons d’a illeu rs, avec M. Decandolle
( Organog. ve'get, i , page 2 3 o J, que si l’on n’avoit égard qu’aux caractères
de végétation, ces plantes devroient être plus rapprochées des
monocotylédones, et spécialement des graminées.
L ’organisation des l y c o p o d i a c é e s approche sensiblement de celle
des fougères de la classe gyrata ( jUices auct. ). Comme elles , ces
plantes présentent des vaisseaux médulliformes , composés de fibres
tubuiées, brillantes, réunies en un seul ou en plusieurs corps pleins.
Ces vaisseaux se partagent en faisceaux secondaires, qui, comme
les prolongemens médullaires des dicotylédones, vont donner naissance
ou à des rameaux, ou à des racines, ou à des feuilles, &c. Les ly co podiacées
diflèrent sur-tout des autres fougères, par la nature fibreuse
ou tubuleuse de toutes les parties de leurs tiges. J’en excepterai toutefois
les lycopodium flabelliformes,, herbacés, tels que patulum, junger-
mannidides, marginatum, pouzolzianum, pennigerum, et probablement toutes
les autres espèces de cette section dans lesquelles les vaisseaux méduT
liformes sont entourés de tissu cellulaire.
Dans les premiers, les tubes de l’extérieur, dont les plus rapprochés
des tubes du centre sont ordinairement noirs, ressemblent beaucoup à
ceux-ci ; mais ils s’en distinguent suffisamment par les usages auxquels
la nature semble les avoir destines.
Les OPHIOGLOS SÉE S sont aussi convenablement caractérisées par leur
substance herbacée, verte , à fibres dichotomes, largement réticulées ;
par leurs épis partant du centre des fo lio le s ..............................
Les M A R A T T I A C É E S se font remarquer par les articulations des pétioles
[stipes) dans plusieurs espèces; par des nervures rares, simples, dichotomes
ou alternes, et sur-tout par cette organisation singulière qui place
à la base de toutes les divisions, pétioles, feuilles, folioles, lobes, et
même à celle des nervures, un renflement celluleux, sorte d appareil
de prévoyance, jouissant de la propriété de conserver long-temps une
fort grande quantité d’humidité réparatrice, lors même que le reste de
la plante est dans un état notable de sicclté. Les faisceaux de fibres
médulliformes sont très-nombreux.
Les G L E IC H É N I .A C É E S se reconiioissent à leurs tiges rampantes, garnies
d’écailles piliformes, caduques , à leurs rameaux dichotomes, à leurs
bourgeons cauiiferes avortés, écailleux, et sur-tout à ia contexture de
ces mêmes tiges, qui n’offrent jamais qu’un seul faisceau de fibres
médulliformes, libre après le dessèchement dans les gleichenia ; fixé sur
une sorte de placentaire latéral, antérieur, dans les mertensia.
Les O S M U N D A C É E S , du moiits telles qu’on les a établies, nous semblent
beaucoup plus difficiles à caractériser. Les plantes du genre osmunda,
qui ont de certains points d’affinité avec quelques ophioglossees, se
distinguent cependant par leurs nervures simplement dichotomes, tandis
qu’elles sont réticulées dans quelques anemia; par leurs vaisseaux médulliformes,
qui, dans la coupe des pétioles, forment un cercle de plus
en plus ouvert de la base au sommet; enfin , par la conversion entière
ou partielle des folioles en épis.
Les todea en diffèrent par la disposition des sores sur la face extérieure
des folioles, qui ne se déforment que peu ou quelquefois pas du
tout. L ’organisation des lygodium nous paroît appartenir plutôt aux
gleichéniacées qu’aux osmundacées. A in s i, ils ont des tiges cylindriques,