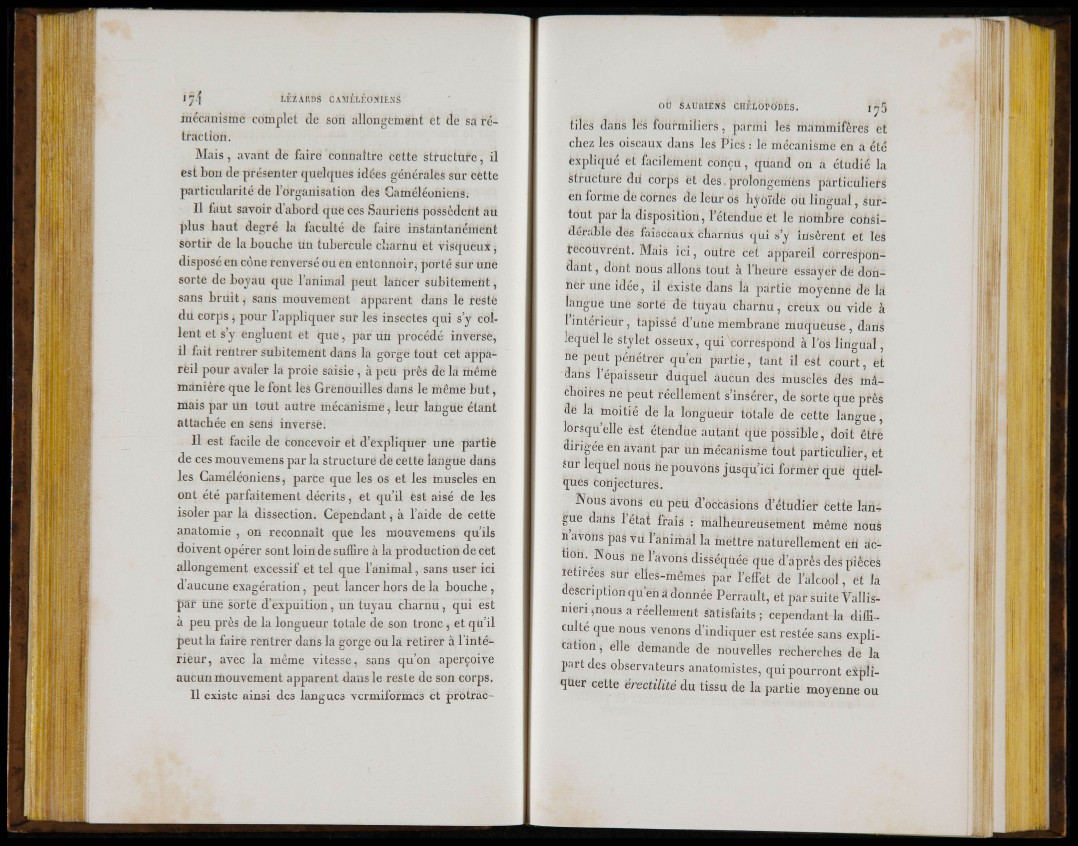
i f ;
174 LÉZAIIDS CAMÉLKONIF.NS
niécanisme complet de son allongement et de sa rétraction.
Mais, avant de faire connaître cette structure, il
est bon de présenter (juelc|ues idées générales sur cette
particularité de l'organisation des Caméléoniens.
Il faut savoir d'abord que ces Sauriens possèdent au
plus haut degré la faculté de faire instantanément
sortir de la bouche un tubercule charnu et visqueux,
disposé en cône renversé ou en entonnoir, porté sur une
sorte de boyau que l'animal peut laûcer subitement,
sans bruit, sans mouvement apparent dans le reste
du corps, pour l'appliquer sur les insectes qui s'y collent
et s'y engluent et que, par un procédé inverse,
il fait rentrer subitement dans la gorge tout cet appareil
pour avaler la proie saisie , à peu près de la même
manière que le font les Grenouilles dans le même but,
mais par un tout autre mécanisme, leur langue étant
attachée en sens inverse.
Il est facile de concevoir et d'expliquer une partie
de ces mouvemens par la structure de cette langue dans
les Caméléoniens, parce que les os et les muscles en
ont été parfaitement décrits, et qu'il est aisé de les
isoler par la dissection. Cependant, à l'aide de cette
anatomie , on reconnaît que les mouvemens qu'ils
doivent opérer sont loin de suffire à la production de cet
allon gement excessif et tel que l'animal, sans user ici
d'aucune exagération, peut lancer hors de la bouche ,
pair une sorte d'exj)uition, un tuyau charnu, qui est
à peu près de la longueur totale de son tronc , et qu'il
peut la faire rentrer dans la gorge ou la retirer à l'intérieur,
avec la même vitesse, sans c[u'on aperçoive
aucun mouvement apparent dans le reste de son corps.
Il existe ainsi des langues vermiformes et protracou
SAUniENS CinOLOl'ODES.
tiles dans les fourmiliers , parmi les mammifères et
chez les oiseaux dans les Pics : le mécanisme en a été
exijliqué et facilement conçu , quand on a étudié la
structure du corps et des prolongemens particuliers
en forme de cornes de leur os hyoïde ou lingual, surtout
par la disposition, l'étendue et le nombre considérable
des faisceaux charnus qui s'y insèrent et les
recouvrent. Mais ici, outre cet appareil correspondant
, dont nous allons tout à l'heure essayer de donner
une idée, il existe dans la partie moyenne de là
langue une sorte de tuyau charnu, creux ou vide à
l'intérieur, tapissé d'une membrane muqueuse, dans
lequel le stylet osseux, qui Wr e s p o n d à l'os lingual,
ne peut pénétrer qu'en partie, tant il est court, et
dans l'épaisseur duquel aucun des muscles des mâchoires
ne peut réellement s'insérer, de sorte que près
de la moitié de la longueur totale de cette langue,
lorsqu'elle est étendue autant cjue possible, doit étie
dirigée en avant par un mécanisme tout particulier, et
sur lequel nous ne pouvons jusqu'ici former que quelc[
ues conjectures.
Nous avons eu peu d'occasions d'étudier Cetie lan.
gue dans l'état frais : malheureusement même nous
n'avons pas vu l'animal la mettre naturellement en action.
Kous ne l'avons disséquée que d'après des pièces
retirees sur elles-mêmes par l'effet de l'alcool, et la
description qu end donnée Perrault, et par suite Vallisnieri,
nous a réellement satisfaits; cependant la difficulté
que nous venons d'indiquer est restée sans explication
, elle demande de nouvelles recherches de la
part des observateurs anatomistes, qui pourront expliquer
cette érectilité du tissu de la partie moyenne ou
fl
vm
fp r^i ! ( a/' •