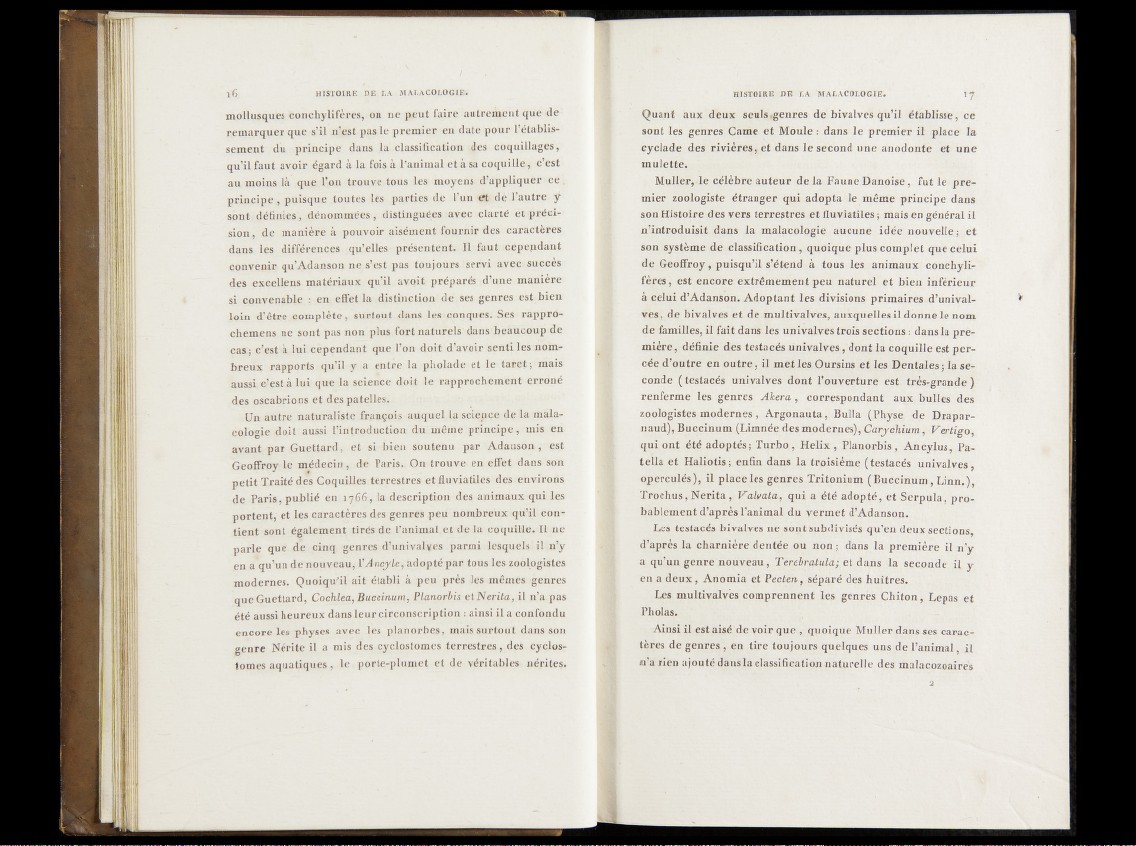
mollusques conchylifères, on. ne peut faire autrement que de
remarquer que s’il n’est pas le premier en date pour l’établissement
du principe dans la classification -des coquillages»
qu’il faut avoir égard à la fois à l’animal et à sa coquille-, c’est
au moins là que l’on trouve tous les moyens d’appliquer ce ;
principe, puisque toutes les parties de l’un et dé l’autre f
sont définies , dénommées, distinguées avec clarté et précision,
de manière à pouvoir aisément fournir des caractères
dans les différences qu’elles - présentent. Il faut cependant
convenir qu’Adanson ne s’est pas toujours servi avec succès
des excellons matériaux qu’il avqié préparés,;d’une manière
si convenable : en effet la distinction de ses genres est bien
loin d’être complète, surtout dans les conques. Ses rappro-
chemens ne sont pas non plus fort naturels’dons beaucoup de
cas;; c’est à luicèpendant que l’on doit d’avoir senti les nombreux
rapports qu’il y a entre la pholade et le taret; mais
aussi e-’est à lui que la science doit le rapprochement erroné
des oscabrions et des patelles.
Un autre naturaliste françois auquel la science de la malacologie
doit aussi l’introduction du même principe, mis en
avant par Guettard, et si bien soutenu par Adanson., est
Geoffroy le médecin , de Paris,. On trouve- en effet dans son
petit Traité des Coquilles terrestres etâuviatiles des environs
de Paris, publié en 1766:, la description des animaux qui les
portent, et les caractères des genres peu nombreux qu’il contient
sont également tirés de l’animal.et de la coquille. Il ne
parle que de cinq genres d’univalyes parmi lesquels! il n’y
en a qu’un de nouveau, l’Àncyle, adopté par tous les zoologistes
modernes. Quoiqu’il ait établi à peu près les mêmes genres
que Guettard, Cochlta, Buccinum, Planorbis etNerita, il n’a pas
été aussi heureux dans leur circonscription : ainsi il a confondu
encore les physes avec les planorbes, mais surtout dans son
genre Nérite il a mis des cyclostomes terrestres, des cyclos-
tomes aquatiques, le porte-plumet et de véritables mérites*
Quant aux deux seuls^genres dé bivalves qù’il établisse, ce
sont les genres Came et Moule : dans» le premier il place la
cyclade des rivières, et dans le second une ano^onte et une
mulette.
Muller,*le, célèbre auteur de lac, Faune Danoise, fut le premier
zoologiste étranger qui adopta le même principe dans
son Histoire des vers terrestres et ïluviatiles ; mais en général il
n’introduisit dans la malacologie aucune idéèînouveüe- et
son système de classification, quoique plus complet que celui
de Geoffroy, puisqu’il s’étend à tous les animaux! conchylifères
, est encore extrêmement peu naturel, et bien inférieur
à celui d’Adanson. Adoptant les divisions primaires,d’unival-
ves, de bivalves et de multivalves, auxquelles il donne le nom
de familles, il fait dans les univalves trois sections : dans la prè-
mière, définie des testacés univalves, dont la coquille est percée
d’outre en outre, il met les Oursins elles Dentales ; la seconde
( testacés univalves dont l’ouverture est trésrgrande )
renferme les genres 4 kera, correspondant a^c bulles des
zoologistes modernes , Argonauta, Bull a (Physe de Drapar-
naud), Buccinum (Limnée des modem es), Caryehium, Vertigo,
qui ont été adoptés; Turbo, Hélix, Planorbis, Ancylus, Patelin
et Haliotis ; enfin dans la troisième (testacés univalves,
operculés ), il place les genres Tritonium ( Buccinum, Linn.),
Trochus,Nerita, Valvata, qui a été adopté, et-Serpula, probablement
d’après l’animal du vermet d’Adanson.
Les testacés bivalves ne sont subdivisés qu’en deux sections
d’après la charnière dentée ou non ; dans la première il n’y
a qu’un genre nouveau, Terçàrqfuia; et da^s la seconde. il y
en a deux, Anomîa et Peetere y séparé des huîtres.
Les multivalves comprennent les genres Chiton , Lepas et
Pholas.
Ainsi il est aisé de voir que , quoique Muller dans ses caractères
de genres, en tire toujours quelques uns de l’animal, il
n’a rien ajouté dans la classification naturelle des malacozoairès