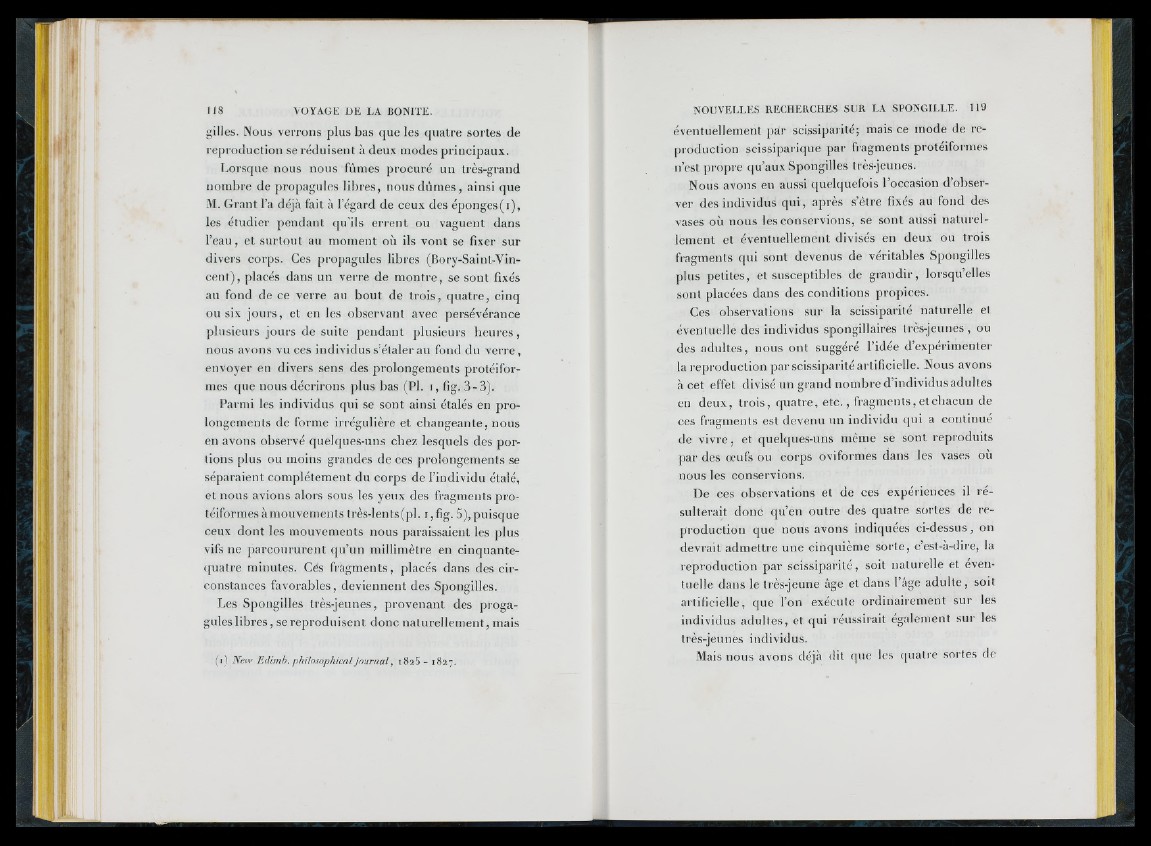
: I
i'
gilíes. Nous verrons pins bas que les quatre sortes de
repioduct ion se réduisent à deux modes principaux.
Lorscpie nous nous fûmes procuré un très-grand
nombre de propagules libres, nous dûmes , ainsi que
M. Graut l’a déjà fait à l’égard de ceux des épong e s ( i ) ,
les étudier pendant qu’ ils errent ou vaguent dans
l’eau, et surtout au moment où ils vont se fixer sur
divers corps. Ces piopngiiles libres (Bory-Saint-Vincent),
placés dans un ve ire de montre, se sont fixés
au fond de ce verre au bout de trois, quatre, cinq
ou six jour s , et en les observant avec persévérance
plusieurs jours de suite pendant plusieui-s heures ,
nous avons vu ces individus s étaler au fond du v e r r e ,
envoyer eu divers sens des prolongements protéifor-
mes que nous décrirons plus bas (Pl. i , fig. 3 - 3 ).
Parmi les individus qui se sont ainsi étalés en prolongements
de forme irrégulière et changeante, nous
en avons observé quelques-uns cbez lesquels des portions
plus ou moins grandes de ces prolongements se
séparaient complètement du corps de l’individu étalé,
et nous avions alors sous les yeux des fragments pro-
téiformes à mouvements très-lents(pl. i , fig. 5 ), puisque
ceux dont les mouvements nous paraissaient les plus
vifs ne jiarconrurent q u’un millimètre en cinquante-
([uatre minutes. Cés fragments, placés dans des c irconstances
favorables, deviennent des Spongilles.
Les Spongilles très-jeunes, provenant des proga-
gules l ib re s , se reproduisent donc naturel lement , mais
( i) New Edimb. philasophknl jo u r n a l, i S a S - 189.7.
NOUVEI.LKS RECHERCHE.S SLR LA SPONGILLE. 119
èventiiellement par scissipar ité; mais ce mode de r-e-
produclion scissipar iqne par fragments protéifornres
n’est ]>r opre (jit’aux Spongilles très-jeunes.
Noirs avons en aussi quelquefois l ’occasion d’observer
des individus qui , après s’èlre fixés au fond des
vases où nous les conservions, se sont aussi naturellement
et éventuellement divisés eu deux ou trois
fragments ipii sont devenus de véritables Spongilles
plus petites, et susceptibles de grandir , lorsqu’elles
sont placées dans des conditions propices.
Ces observations sur la scissiparité naturelle el
évenluelle des individus spongillaires très-jeunes, ou
des adultes, nous ont suggéré l’ idée d’expér-imenter-
la repr'oduction par scissiparité artificielle. Nous avons
à cet effet divisé un gr and nombre d ’individus adultes
en deux, ti’ois, quati-e, e tc . , fragments, et cbacuu de
ces fragments est devenu un individu qui a continué
de v iv re , et quelques-uns même se sont reproduits
jrar des oeufs ou corps ovifor mes dans les vases où
nous les conservions.
De ces observalions et de ces expériences il résulterait
donc qu’en outre des quatre sortes de reproduction
que nous avons indiquées ci-dessus, on
devrait admettre une cinquième sor te, c’est-à-dire, la
lepi ’oducl iou par scissiparité, soit naturelle el éventuelle
dans le ti’ès-jeune âge et dans l’âge adul te, soit
artificielle, que l ’on exécute ordinairement sur les
individus adultes, et qui réussirait également sur- les
très-jeunes individus.
Mais nous avons déjà dil que les f|iialie sor tes de