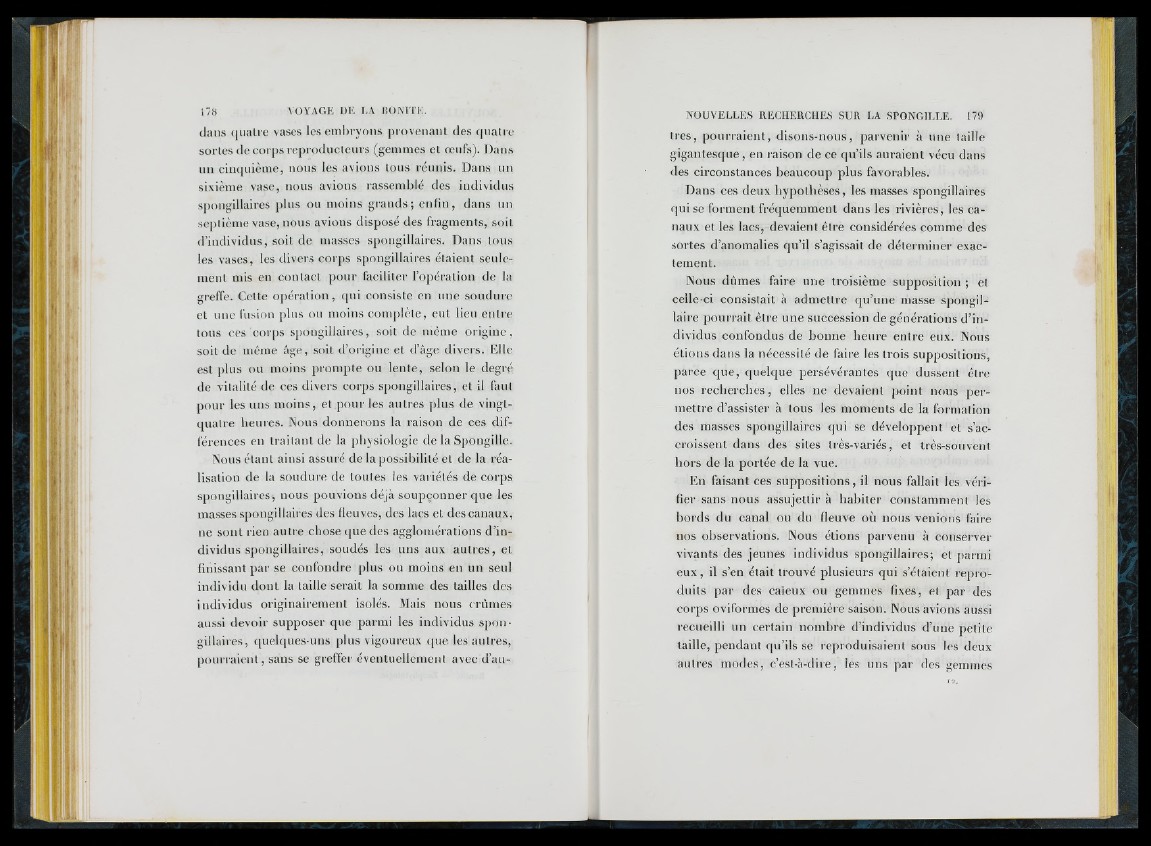
Ii!'
I!
f
ï:■
it ■
dans ([uatie vases les embryons proveiianl des cpialie
sortes de coi ps repi'oducteurs (gemmes et oenfs). Dans
1111 cinipiième, nous les avions tous réunis. Dans im
sixième vase, nons avions rassemblé des individus
sjiongillaires plus ou moins grands; enfin, dans un
septième vase, nous avions disposé des fragments, soit
d’individus, soit de masses spongillaires. Dans tous
les vases, les divers corps spongillaires étaient seulement
mis en contact pour faciliter l’opération de la
greffe. Celte ojiération, (|iii consiste en une soudure
el nnc fusion jilus on moins comjilèle, eut lien entre
tous C C S corps spongillaires, soit de iiiéme origine,
soit de même âge, soit d’origine el d’âge divers. Elle
est jilus ou moins prompte ou lente, selon le degré
de vitalité de ces divers corps spongillaires, et il faut
pour les nus moins, el jiour les autres plus de vingt-
(jualre heures. Nous donnerons la raison de ces différences
en Irailanl de la physiologie de la Spongille.
Nous étant ainsi assuré de la possibilité et de la réalisation
de la soudure de toutes les vaiiélés de corps
spongillaires, nous pouvions déjà soupçonner que les
masses spongillaires des fleuves, des lacs et des canaux,
ne sont rien autre chose rpie des agglomérations d’individus
spongillaires, soudés les uns aux autres, el
finissant par se confondi'e plus ou moins en un seul
intlividu dont la taille serait la somme des tailles des
individus originairement isolés. Mais nous crûmes
aussi devoir supposer (jue parmi les individus spongillaires,
([uelijuesuns jilus vigoui-eux (jue lesautres,
pourraient, sans se greffer évenluelleineni avec d’au-
NÜUVELLE.S RECHERCHES SU R I,A S PO N G IL L E . 179
1res, pouriaient, disons-nous, parvenir à une taille
gigantesijue , en raison de ce qu’ils auraient vécu dans
des circonstances beaucouji jilus favorables.
Dans ces deux liypolbèses, les masses spongillaires
(jui se foi ment fréquemment dans les rivières, les canaux
et les lacs, devaient être considérées comme des
sortes d’anomalies qu’il s’agissait de déterminer exactement.
Nous dûmes faire une troisième supjiosition ; el
celle-ci consistait à admettre qu’une niasse sjiongil-
laire pourrait être une succession de générations d’individus
confondus de bonne heure entre eux. Nous
étions dans la nécessité de faire les trois suppositions,
parce que, quelque persévérantes (juc dussent être
nos recherches, elles ne devaient jioint nous permettre
d’assister à tous les moments de la formation
des masses sjiongillaires qui se développent et s’accroissent
dans des sites très-variés, el très-soiivenl
hors de la portée de la vue.
En faisant ces suppositions, il nous fallait les vérifier
sans nous assujettir à habiter constamment les
bords du canal ou du fleuve où nous venions faire
nos observations. Nous étions parvenu à conserver
vivants des jeunes individus spongillaires; et parmi
e u x , il s’en était trouvé plusieurs qui s’étaient rejiro-
duils jiar des caïeux ou gemmes fixes, el jiar des
corps oviformes de première saison. Nous avions aussi
recueilli un certain nombre d’individus d’une petite
taille, jiendant qu’ils se reproduisaient sous les deux
autres modes, c’est-à-dire, les uns par des gemmes