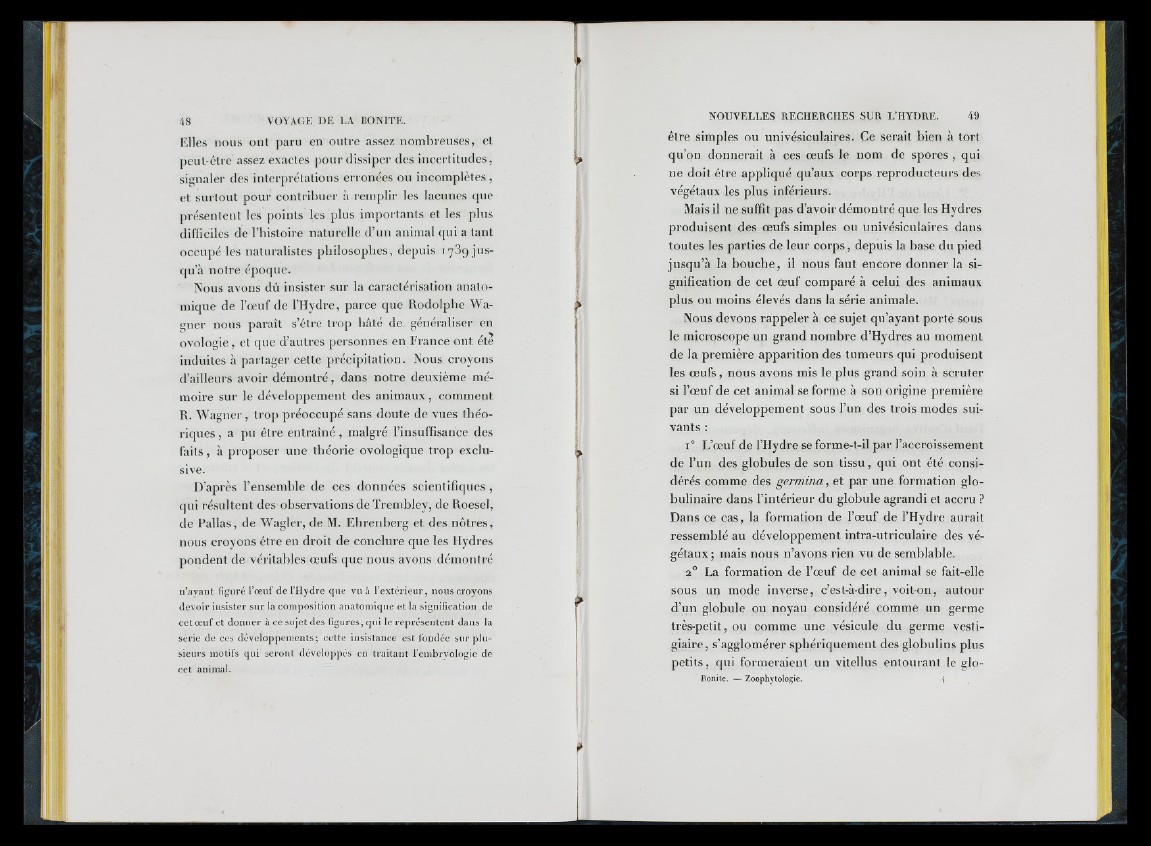
Elles nous ont paru en outre assez nombreuses, et
peut-être assez exactes pour dissiper des incertitudes,
signaler des interprétations erronées ou incomplètes ,
et surtout pour conlrilnier à remplir les lacunes que
présentent les points les plus impoi laols et les plus
difficiles de l’iiistoire naturelle d’un animal cpii a tant
occupé les naturalistes philosophes, depuis 1739 jusqu’à
notre époque.
Nous avons dû iusistei' sur la caractérisation anatomique
de l’oeuf de THydre, parce que Rodolphe Wagner
nous paraît s’être trop bâté de généraliser en
ovologie , et que d’autres pei'soimcs en France ont été
induites à pailager cette précipitation. Nous croyons
d’ailleurs avoir démontré, dans notre deuxième mémoire
sur le développement des animaux, comment
R. Wagner , ti op pi éocciipé sans doute de vues théoriques,
a pu être entraîné, malgré l’insuffisance des
faits, à proposer une théorie ovologique trop exclusive.
D’après l’ensemble de ces données scientifiques ,
qui l ésultent des observations de Trembley, de Roesel,
de Pallas, de Wagler, de M. Ebrenbei'g et des nôtres,
nous croyons être en droit de conclure que les Hydres
pondent de véritables oeufs que nous avons démontré
n’avant figure l’oe uf de l’Hydre que vu à l ’extérieur , nous croyons
devoir insister sur la composi t ion anatomique et la signification de
cet oeuf et donner à ce sujet des figures, qui le représentent dans la
serie de ces développements; cette insistance est fondée sur plusieurs
motifs qui seront développés en traitant rei i ibrvotogic de
cet animal.
NO U V E L L E S RECHERCHES SUR L ’HYDRE. 49
être simples ou univésiculaires. Ce serait bien à tort
qu’on donnerait à ces oeufs le nom de spores , qui
ne doit être appliqué qu’aux corps reproducteurs des
végétaux les plus inférieurs.
Mais il ne suffit pas d’avoir démontré que les Hydres
produisent des oeufs simples ou univésiculaires dans
toutes les parties de leur corps, depuis la base du pied
jusqu’à la bouche, il nous faut encore donner la signification
de cet oeuf comparé à celui des animaux
plus ou moins élevés dans la série animale.
Nous devons rappeler à ce sujet qu’ayant porté sous
le microscope un grand nombre d’Hydres au moment
de la première apparition des tumeurs qui produisent
les oeufs, nous avons mis le plus grand soin à scruter
si Toeuf de cet animal se forme à son origine première
par un développement sous Tun des trois modes suivants
:
1° L’oeuf de THydre se forme-t-il par l’accroissement
de Tun des globules de son tissu, qui ont été considérés
comme des germina, et par une formation glo-
bulinaire dans Tintérieur du globule agrandi et accru ?
Dans ce cas, la formation de Toeuf de THydre aurait
ressemblé au développement intra-utriculaire des végétaux;
mais nous n’avons rien vu de semblable.
2° La formation de Toeuf de cet animal se fait-elle
sous un mode inverse, c’esl-à-dii'e, voit-on, autour
d’un globule ou noyau considéré comme un germe
très-petit, ou comme une vésicule du germe vesti-
giaire, s’agglomérer sphériquement des globulins plus
petits, (pii formeraient un vitellus enlouiaiit le glo-
Bonile. — Zoophytologie. 4