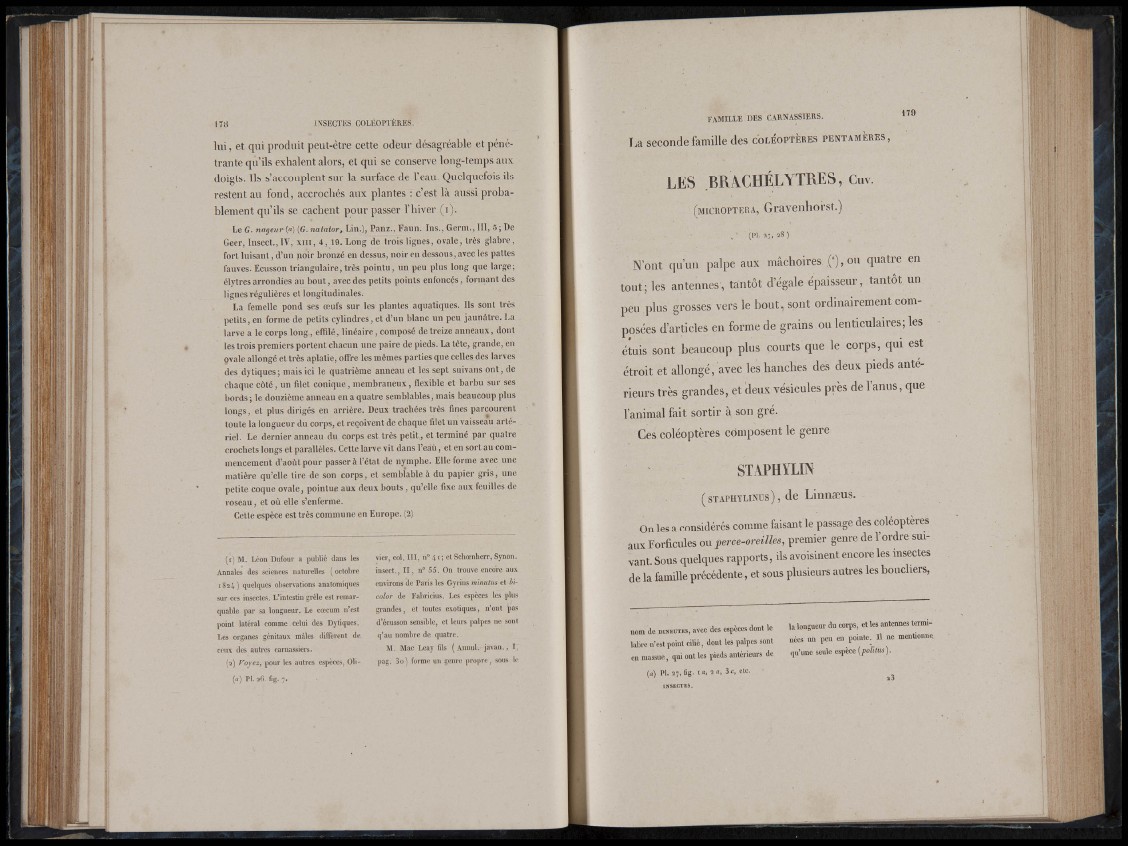
17(j 1N S E C Ï HS COLÉOPTÈRES.
l u i , et qui p rodui t pe,ut-ètre cette odeur désagréable et pénét
r a n t e qu' i l s exhalent alors, et q ui se conserve loni);-temps aux
d o i g t s . Ils s 'accouplent sur la siu-face d e l 'eau Quelquefois ils
r e s t e n t a u fond, accrochés aux plantes : c ' e s t là aussi probab
l e m e n t qu' i l s se cachent ponr passer l'hiver (i).
Le G. nagi!ur{«)(G.ntilator, Lin.), Panz., Faim. Ins., Germ., Ill, 5; De
Geer, Insect., lY, xni , 4, 19. Long de n-ois l ignes, ovale, U'ès glabre,
fort luisant , d'un noir bronzé en dessus, noir en dessons, avec les paUes
fa\ives. Ecusson triangulaire, très pointu, nn peu plus long que large;
élyn-es a r rondies au bout , avec des petits points enfoncés , formant des
lignes régulières el longitudinales.
La femelle pond ses oeufs sur les plantes aquatiques. Ils soul Irès
p e l i t s , en forme de petits cylindres, et d'un blanc un peu jaunâtre. La
larve a le corps long, effilé, linéair e , compos é de treize anneaux, dont
les trois premier s por tent chacun une paire de pieds. La tète, grande, eu
ovale allongé et très aplatie, offre les mêmes parties que celles des larves
des dytiques ; mai s ici le quatrième anneau et les sept suivans ont , de
chaque cùlé, un filet conique, membraneux , flexible et barbu sur ses
bords; le douzième anneau en a quat r e semblables, mais beaucoup plus
longs, el plus dirigés en arrière. Deux trachées très fines parcourent
toute la longueur du corps, el reçoivent de chaque filet un vaissea'u artériel.
Le dernier anneau du corps est très pet i t , et terminé par quatre
crochets longs et parallèles. Celle larve vil dans l'eaû, el en sort au commencement
d'août pour passer à l'étal de nymphe. Elle forme avec une
matière qu'elle tire de son corps, et semblable à du papier gris, une
pelile coque ovale, poinlue aux deux bouts, qu'elle fixe aux feuilles de
roseau, et où elle s'enferme.
Cette espèce est très commune en Europe. (2)
(1) M. Léon Diifour a publié dans les
Annales des sciences naturelles (octobre
1824) quelques ol>servalions anatomiques
sur ces inseeles. L'intestin grêle est remarqual)!
e par sa longueur. Le coecum n'est
point latéral comme celui des Dyti([ues.
Les organes génitaux mâles diffèrent tle
ccux des autres carnassiers.
(2) Voyez, pour les antres espèces, Oli-
{a) Pl. 26. lîg. 7.
vier, col. m , n" 41; et Schoenher r , Synon.
i n s e c t . , I l , n° 55. On trouve encore au\
environs de Paris les Gyrin« s et ÌAcolor
de Falmcius. Les espèces les plu.s
g r a n d e s , et toutes exotiques, n'ont pas
d'écusson sensible, et leurs palpes ne sont
q ' a u nombre de quatre.
M. Mac Leay fils (Annul, javan., I,
pag. 3o) formi- u » genre propn;, sous !<•
FAMILLE DES CARNAbSIEKS. ^^ ^
h-A s e c o n d e fami l l e d e s COLÉOPTÈRES PENTAMÈRES,
LES BMCHÉLYTRES, Cuv.
(MICROPTERA, Gravenhorst. )
, • (IM, a8 )
N ' o n t (|iùiu palpe aux mâchoires ,C),ou quatre en
t o u t ; les antennes , tantôt d'égale épa i s s eur , tantôt un
p e u plus grosses ver s l e b o u t , sont o r d i n a i r eme n t comp
o s é e s d'ar t icles e n forme d e g r a ins o u l ent i cul a i r e s ; les
é t u i s sont beaucoup plus courts que le corps, qui est
é t r o i t et a l longé , avec les h a n c h e s des d eux p i e ds antér
i e u r s t r è s g r a n d e s , et d e u x v é s i cul e s p r è s d e l ' a n u s , que
l ' a n i m a l fai t sor t i r à son gré.
C e s c o l é o p t è r e s composent le genre
S T A P H Y L I N
( s T A P H Y L i s n s ) , de Linnaeus.
O n les a cons idé r é s c omme faisant l e p a s s age des coléoptères
a u x F o r f i c u l e s o n perce-oreilles, premier genre d e l ' o r d r e suiv
a n t . S o u s q u e l q u e s r a p p o r t s , ils a v o i s i n e n t encor e les msectes
d e l a fami l l e p r é c é d e n t e , et s o u s p lus ieur s aut r e s les boucl iers,
„ „ „ , de . « . ^ . s , avec des espèces don. le la longueur du corps, e, les antenues . emi -
l a l « „'es, point cilié, don. les palpes son. nées nn peu en po.n.e. Il ne menuorn.»
en massue, .[ni o n . les pieds an.érieurs de qn'nM seule espeee [pol,lu,].
M ri. lig. '
INSECTES.
n, etc.