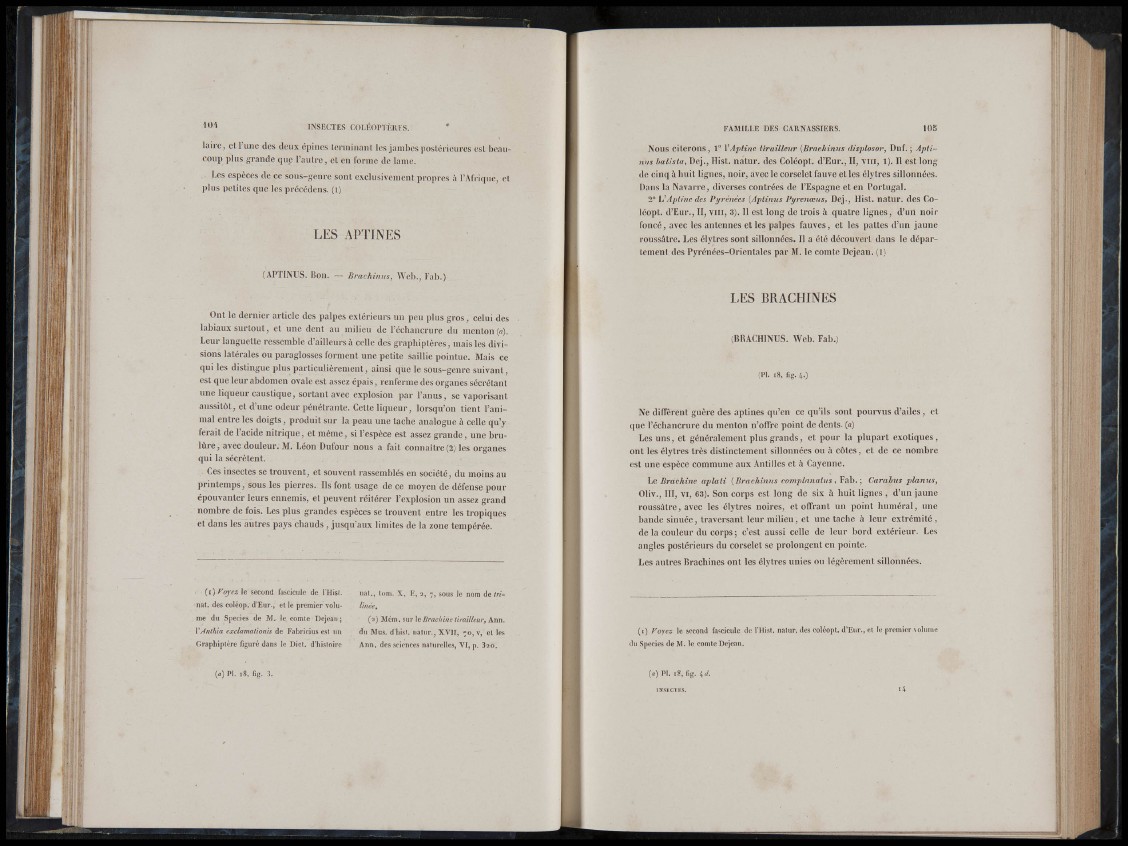
s s
•
lO'l ì n s f . c t e s c;oi.koi>iì;ki:s.
lairc, ci l'une des ilcux Épines li-nninani Ics janiljes |iosléi i(!iii-es esl beancoup
pins grande que l'auh-e, ci en forme de lame.
Les espèces de ce soiis-gcnrc soni exclnsivemcnl propres à l'Afi-iiiue, el
plus peliles que Ics prccédens. (l)
LES APTINES
(APTIM'S. Bon. — Brachinus, Wel)., Fai).)
Onl le dernier article des palpes exléricurs un peu plus g ros, celui des
labiaux snrloul, et une dent au milieu de l'éehancrure du menton (<i).
Leur languette ressemble d'ailleurs à celle des graphiptères, mais les divisions
latérales ou paraglosses forment une petite saillie pointue. Mais ce
qui les distingue plus particulièi-enient, ainsi que le sous-genre suivant,
est que leur abdomen ovale est assez épais, renferme des organes .sécrétant
une liqueur caustique, sortant avec explosion par l'anus, se vaporisant
aussitôt, et d'une odeur pénétrante. Cette l iqueur , lorsqu'on tient l'animal
entre les doigts, produit sur la peau une tache analogue à celle qu'y
ferait de l'acide ni trique, et même, si l'espèce est assez grande, une brul
ù r e , avec douleur. M. Léon Dufour nous a fait connaître (2) les organes
qui la sécrètent.
Ces insectes se t rouvent , et souvent rassemblés en société, du moins au
printemps, sous les pierres. Ils font usage de ce moyen de défense pour
épouvanter leurs ennemis, et peuvent réitérer l'explosion un assez grand
nombre de fois. Les plus grandes espèces se trouvent entre les tropiques
et dans les autres pays chauds , jusqu'aux limites de la zone tempérée.
(I ) ^ojca le second fascicule de IHisl.
nat. des coléop. d'Eur., et le premier volume
du .Species de M. le comle Dcjean ;
X'Anihia rxdamalloms de Fabricius est 1111
Oraphipière fij;iiré dans le Diet, d'hisloiic
M Pl. ,8. lig. ,1.
liai., loin. X. F; 2, 7, sous le nom de in-
Unèe,
{'i) Mém. sur le Braciùna itraclUur, Ann.
du Mus. d liisl. ualur., XVII, 70, v, et les
Ann. de.s sciences nalnrelles, VI, p. Bao.
FAMILLE DES CARN.\SSTERS. lOS
Nous citerons, I" VApli/tc Itraillcur {Braehimis dispiosor, Duf. ; Apti-
?nfs halisifi, Dej., Ilist. natur. des Coléopt. d'Eur., 11, v i l l , 1). Il est long
de cinq il Iiuit lignes, noir, avec le corselet fauve e l les élytres sillonnées.
Dans la Navarre, diverses contrées de l'Espagne et en Portugal.
2" UAiilinc des Pf/reitées {Apliniis Pyrenoeus, Dej-, Hist, natur. des Coléopt.
d'Eur., II, vni , 3). 11 est long de trois à quatre lignes, d'un noir
foncé, avec les antennes et les palpes fauves, et les pattes d'un jaune
roussâtre. Les élytres sont sillonnées. Il a été découvert dans le départeuienl
des Pyrénées-Orientales par M. le comte Dejean. (1}
LES BRACHINES
(BRACHINUS. Web. Fab.)
(Pl. 18. iig. 4.)
Ne diiTiircnt guère des aplines qu'en ce qu'ils sont pourvus d'ailes, et
(|ue l'échancrure du menton n'oiTrc point de dénis, (a)
Les uns, el généralement plus grands, et pour la plupart exotiques,
ont les élytres très distinctement sillonnées ou ù côtes , et de ce nombre
est une espèce commune aux Antilles et h Cayenne.
Le Brachinc aylaii {Brachinus comjylnnnlus, Fab.; Carabus jylanvs,
Oliv., m , VI, 63). Son corps esl long de six à huit lignes , d'un jaune
roussiUrc, avec les élytres noires, et offrant un point huméral, une
bande sinuée, traversant leur milieu, et une tache à leur extrémité .
de la couleur du corps; c'est aussi celle de leur bord extérieur. Les
angles postérieurs du corselet se prolongent en pointe.
Les autres Brachines ont les élytres unies ou légèrement sillonnées.
(i) Voyez le second fascicule ilf l'Hist. naUir. des coléopt. d'Eiir., el le iiremier \olnme
<lu S|)ecie,s de M. le comle Dejean.
(«) Pl. fip. /,</.