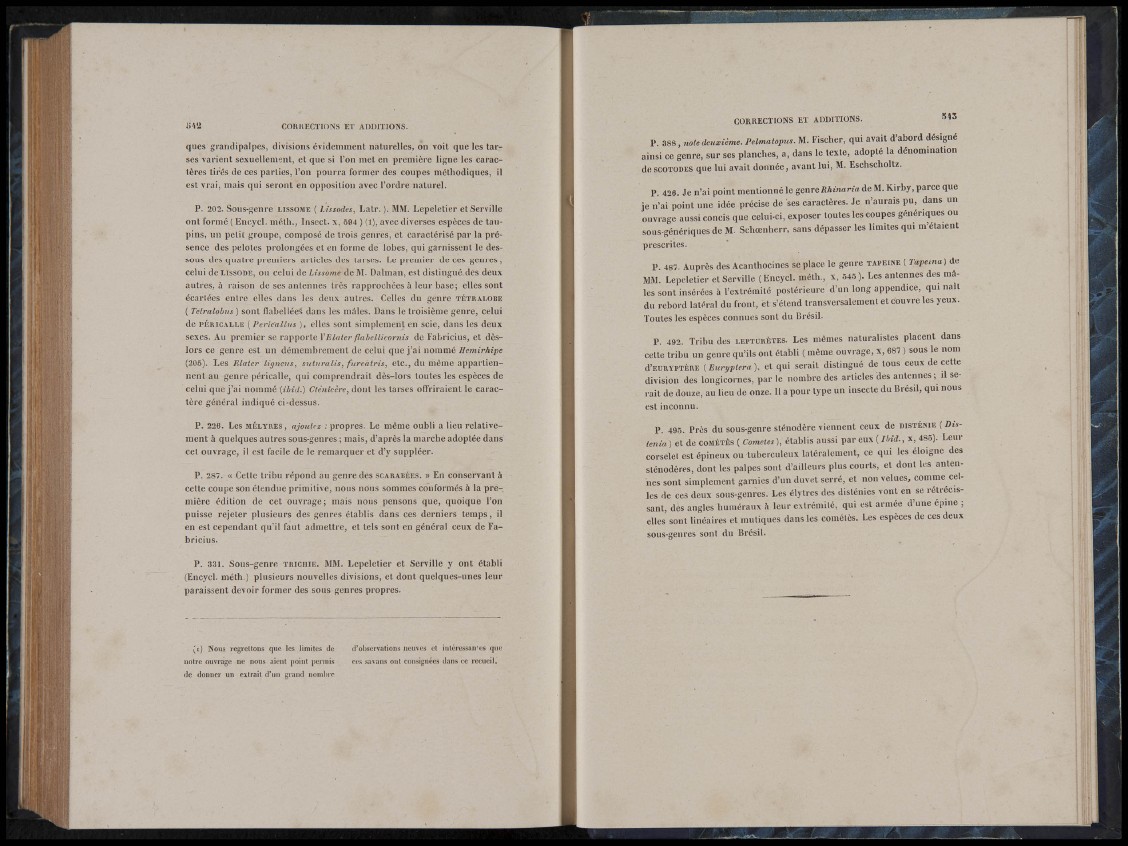
nvi CORRECTIONS ET ADDITIONS.
ques grandipalpes, divisions évidemment naturelles, on volt que les tarses
varient sexuellement, et que si Ton met en première ligne les caractères
tirés de ces parties, l'on pourra Ibrnier des coupes méthodiques, il
est vrai, mais qui seront en opposition avec l'ordi'e naturel.
P. 202. Sous-genre LISSOME ( Ussodes, Lalr. ). MM. Lepeletier etServille
ont formé ( Enc-.ycl. méth.. Insect, x, 594 ) (i), avec diverses espèces de tanpins,
un petit groupe, composé de trois genres, et caractérisé par la présence
des pelotes prolongées et en forme de lobes, qui garnissent le dessous
des quatre premiers articles des tarses. Le premier de ces genres,
celui de LISSODE, OU celui de Lissome de IVI- Dalman, est distingue des deux
autres, à raison de ses antennes très rapprochées ù leur base; elles sont
écartées entre elles dans les deux autres. Celles du genre TÉTRALOBE
( Telralobus) sont flabellées dans les mûles. Dans le troisième genre, celui
de PÉRICALLE ( l'ericalius ), elles sont simplement en scie, dans les deux
sexes. Au premier se rapport e VBluter fïaheUicomis de Fabricius, et dèslors
ce genre est un démembrement de celui que j'ai nommé Hemirhipe
(205). Les F.later ligtiats, suluralis, fiircatris, etc., du même appartiennent
au genre pérlcalle, qui comprendrait dès-lors toutes les espèces de
celui que j'ai nommé (¿¿¿£/.) Clénicère,ào\ï\. les tarses offriraient le caractère
général Indiqué cl-dessus.
P. 226. Les BiÉLYRES, ajoutez : propres. Le même oubli a lieu relativement
à quelques autres sous-genres ; mai s , d'après la marche adoptée dans
cet ouvrage, il est facile de le remarquer et d'y suppléer.
P. 287. « Cette tribu répond au genre des SCARABÉES. » En conservant à
cette coupe son étendue primitive, nous nous sommes conformés à la première
édition de cet ouvrage; mais nous pensons que, quoique l'on
puisse rejeter plusieurs des genres établis dans ces derniers temps, il
en est cependant qu'il faut admettre, et tels sont en général ceux de Fabricius
P. 331. Sous-genre TKICHIE. MM. Lepelelier et Serville y ont établi
(Encycl. méth.) plusieurs nouvelles divisions, et dont quelques-unes leur
paraissent devoir former des sous genres propres.
{i) Nous regreUons que les limites de
noUe ouvrage ne nous aient point permis
tie donner un cxlrail d'un grand nonihrr
d'observations neuves et intéressan'es quo
cos savons ont consignées dans ce recueil.
CORKECtiONS ET ADDITIONS. ^^ ^
P. 3SS, note deuxième. Pclmatopus. M. Fischer, qui avait d'abord désigné
ainsi ce genre, sur ses planches, a, dans le texte, adopté la dénomination
descoTODES que lui avait donnée, avant lui, M. Eschscholtz.
P 426. Je n'ai point mentionné le genreflAtra«r2« de M.Kirby, parce que
je n'ai point une idée précise de ses caractères. Je n'aurais pu, dans un
ouvrage aussi concis que celui-ci, exposer toutes les coupes génériques ou
sous-génériques de M. Schoenherr, sans dépasser les limites qui m'étaient
prescrites.
P. 487. Auprès des Acanthocines se place le genre TAPEIKE ( Tapeina) de
MM. Lepeletier et Serville ( Encycl. méth., x, 54-5 ). Les antennes des mâles
sont insérées à l'extrémité postérieure dun long appendice, qui naît
du rebord latéral du front, et s'étend transversalement et couvre les yeux.
Toutes les espèces connues sont du Brésil.
P. 492. Tribu des LEPTURÈTES. Les mêmes naturalistes placent dans
cette tribu un genre qu'ils ont établi ( même ouvrage, x, 687 ) sous le nom
d'EURYPTÈRE {E7,rj/vtera). et qui serait distingué de tous ceux de cette
division des longlcornes, par le nombre des articles des antennes; il serait
de douze, au lieu de onze. Il a pour type un insecte du Brésil, qui nous
est inconnu.
P. 495. Près du sous-genre sténodère viennent ceux de niSTÉaiE ( ZJtV
iejiia ) et de COHÉTÈS ( Cometes ), établis aussi par eux ( n i d . , x, 4S5). Leur
corselel est épineux ou tuberculeux latéralement, ce qui les éloigne des
slénodères, dont les palpes sont d'ailleurs plus courts, et dont les antennes
sont simplement garnies d'un duvet serré, et non velues, comme celles
de ces deux sous-genres. Les élytres des disténies vont en se rétrécissant,
des angles huméraux à leur extrémilé, qui est armée d'une epine ;
elles sont linéaires et mutiques dans les cométès. Les espèces de ces deux
sous-genres sont du Brésil.