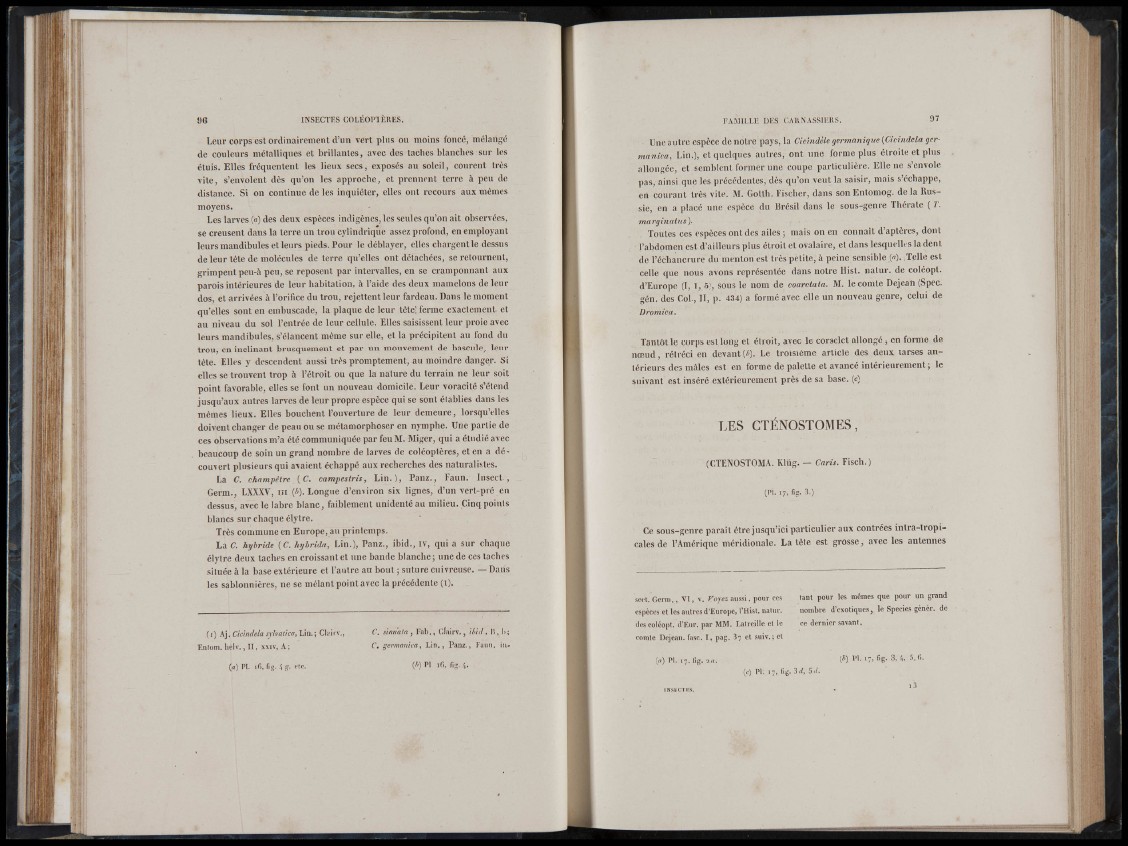
uo INSECTES COLÉOl'lÈHtS.
Leur corps est ordinai rement d'un vert plus ou moins l'once, mélangé
de couleurs niélalUques et brillanles, avec des ladies blanches sur les
étuis. Elles fréquentent les lieux secs, exposés au soleil, courent très
vite, s'envolent dès qu'on les approche, et prennent terre à peu de
distance. Si on continue de les inquiéter, elles ont recours aux mêmes
moyens.
Les larves {a) des deux espèces indigènes, les seules qu'on ait observées,
se creusent dans la terre un trou cylindrique assez profond, en employant
leurs mandibules et leurs pieds. Pour le déblayer, elles chargent le dessus
de leur tète de molécules de terre qu'elles ont détachées, se relournent,
grimpent peu-à peu, se reposent par intervalles, en se cramponnant aux
parois intérieures de leur habitation, h l'aide des deux mamelons de leur
dos, et arrivées l'i l'orifice du trou, rejettent leur fardeau. Dans le moment
qu'elles sont en embuscade, la plaque de leur tête! ferme exaclement et
au niveau du sol l'entrée de leur cellule. Elles saisissent leur proie avec
leurs mandibules, s'élancent même sur elle, et la précipitent au fond du
trou, en inclinant brusquement et par un mouvement de bascule, leur
tête. Elles y descendent aussi très promptement , au moindre danger. Si
elles se trouvent trop h l'étroit ou que la nature du terrain ne leur soit
point favorable, elles se font un nouveau domicile. Leur voracité s'étend
jusqu'aux autres larves de leur propre espèce qui se sont établies dans les
mêmes lieux. Elles bouchent l'ouverture de leur demeure, lorsqu'elles
doivent changer de peau ou se métamorphoser en nymphe. Une partie de
ces observations m' a été communiquée par feu M. Miger, qui a étudi é avec
beaucoup de soin un grand nombre de larves de coléoptères, et en a découvert
plitsieurs qui a-vaient échappé aux recherches des naturalistes.
La C. champêtre ( C. campestris, Lin.), Panz., Faun. Insect ,
Germ., LXXXV, ni Longue d'environ six lignes, d'un vert-pré en
dessus, avec le labre blanc, faiblement unidentéau milieu. Cinq points
blancs sur chaque élylre.
Très commune en Europe, au printemps.
La C. hybride (C. hyhrida, Lin.), Panz., ibid., IV, qui a sur chaque
élytrc deux taches en croissant et une bande blanche; une de ces taches
.située à la base extérieure et l'antre au bout ; sutur e cuivreuse. — Dans
les sablonnières, ne se mêlant point avec la précédente (i).
(i) h.\.Clchuiela sylvatica. Lin.; Ck-Ir
Enlum. lielv., II, xxiv, A ;
(a) l't. ifi, il-, i-tc.
C. sinuala f Fab., (llairv., ih'nl, lì,
C. germanica. Lin., Panz., T'unn. i
(A) PI if», n-/i.
J
l'AMlLLlî Ui-S CAKSASSIKIiS. «'
Une aut r e cspicc de not r e pays, la Cicindèle qermmiique [Cicindela gcrmnnien,
Lin.), et quelques autres, ont une forme plus elroite el plus
allousée, et semblent former une coupe particulière. Elle ne s'envole
pas, ainsi que les précédentes, dès qu'on veut la saisir, mais s'échappe,
en courant très vite. M. Cottli. Fischer, dans son Entomog. de la Russie,
en a placé une espèce du Brésil dans le sous-genre Thérate ( T.
mftrginatns).
Toutes ces espèces ont des ailes ; mais on en connaît d'aptères, dont
l'abdomen est d'ailleurs plus étroit et ovalaire, et dans lesquelle s la dent
de l'cchancrure du menton est très petite, à peine sensible (<i). Telle est
celle que nous avons représentée dans notre Hist, natur. de coléopt.
d'Europe (I, I, 5), sous le nom de coarclala. M. le comt e Dejean (Spec,
gén. des Col., II, p. 434) a forme avec elle un nouveau genre, celui de
Uremica.
Tantôt le corps est long et élroit, avec le corselet allongé , en forme de
n oe u d , rétréci en devant(i). Le troisième article des deux tarses anlerieurs
des mâles est en forme de palette et avancé intérieurement; le
suivant est inséré extérieurement près do sa base, (e)
I . E S CTÉNOSTOMES,
(CTENOSTOM.\. Klüg. — Ciyrii. Fiscb.)
(l'I. -7. fig- 3.)
Ce sous-genre parait être jusqu' ici particulier aux contrées inlra-tropicales
de l'Amérique méridionale. La têle est grosse, avec les antennes
sttrt. Ge rni . , VI, v. r'oyez aussi, pour ces
c.spècos el les aul res d'Europe, l'Hisl. iiatiir.
(lescoléopl. d'Enr. par MM. Lalreille et le
eomte Dejean. lase. I , pag. et sniv. ; el
tant pour les mêmes que pour un grand
nombre d'exotifiues, le Species génér. de
ce dernier savant.
W Pl. , , .1:6. .
(c) IM. i ; , fig. 3ri, 5,1.
(S) t'I. 17, fig. 3.-'„ .s.n.