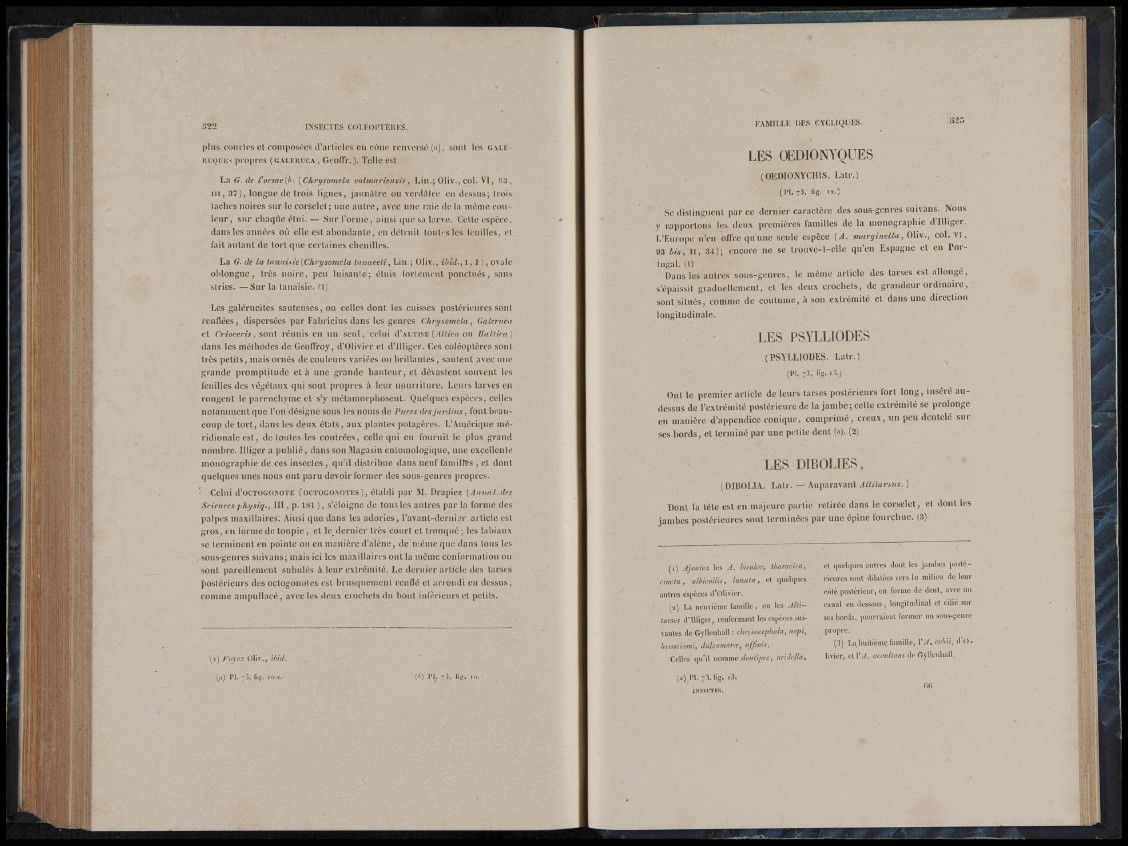
f
3 J f }
I
I Î .f,
iî'2'i îNSF-Ci r s c;oi.É()i''ii:iU':s.
plus coiirlos el comiiosrcs iroiiii'los cn ('«"ïno ronversc («), son! les GAI-KluioL'Ks
propres (GALERUCA , GoofTr.). Telle esl
La ii. dc ¿'orOTc(i; {Chnjsomcln cnltnariensis, Lin.; Oliv., col. VI, 513,
I I I , 37), longue clc trois lisfnes, janniUre ou vcnlAlre cn dessus; Irois
laches noires sur le corsclcl ; une iiulre, avec nno raie cl(i la même coul
e u r , sur cliaqiic élui. — Sur Tornie, ainsi que sa larve. Celte espèce,
dans les années où elle esl abondante, en dcMi uil loul' S les Icuillcs, cl
fail autant dc lorl que certaines chenilles.
L a G. (le la innaùieiChnjsomcla hitiaceli, Lin.; Oliv., i/nd., i, 1 ) , ovale
o h l o n g u e, très noire, peu luisante; étuis iortemenl ponctués, sans
slries. — S u r la tauaisie. a)
Les galérucites sauteuses, ou celles dont les cuisses postérieures sont
renflées, dispersées par Fabrieius dans les genres Chn/somcla, Galcrncu
e t Crioccris. sont réunis en un seul, celui d'AI-TisE ou Ifallira)
dans les mélhodes de GeoiTroy, d'Olivier et d'Jllij,'er. Ces coléoptères soul
ti'ès petits, mais ornés dc couleurs variées ou bri l lantes, sautent avec nue
grande promptitude et une grande hauteur, et dévastent souvent les
feuilles des végétaux qui sont propres à leur nourriture. Leurs larves en
rongent le parenchyme cl s'y métamorphosent. Quelques espèces, celles
nolanuiientque l'on désigne sous les noms de Puces des Jnnlhis, foui beaucoup
de tort , dans les deux étals, aux plantes potagères. L'Amérique méridionale
est, de toutes les contrées, celle qui en fournit le plus grand
nombre. Illiger a publié, dans son Magasin enlomologique, une excellente
monographie de ces insectes , qu'il distribue dans neuf faniilfts , cl dont
quelques unes nous ont paru devoir former des sous-getires ju'oprcs.
• Celui d'ocTOGOi>OTE Î0CT0G0>0TES), établi par M. Drapiez [Amuil.dcx
Srieyiccs jihijsig., 111, p. 181 ) , s'éloigne de tous les autres par la forme des
palpes maxillaires. Ainsi que dans les adories, ravant-derniiu- article est
gros, en lormede toupie , et le/ lernier très coin t e t lron(|ué ; les labiaux
se terminent en pointe ou eu manière d'alène, de même que dans tous les
. sous-geni'es suivans; mais ici les maxillaires ont la même confoi-uiation ou
sont pareillement subulés à leur exlrémité. Le ilernier ai licle des larses
postérieurs des octogonotes est brusquement rcnllé et arrondi cn dessus,
comme anipullaeé, avec les deux crochets du Imul inférieurs et petits.
•(i) roycz Otiv., iòu/.
(n) VI. lig. 10«. (/') l'i. HFAMILÎ,!:
DES F-VCLiQUES.
LES OEDIONYOUES
(OEDIOiNYCHlS. Lalr.)
(l>t. 75. Cg. IÎ.)
S e distinguent par ce dernier caractère des sous-genres suivans. Nous
y i-apporlons les deux premières familles de la monographie d'Illiger.
L'Europe n'en oiFrcqurnie seule espèce {A. mfinjinella, Oh\., col. vi .
93 bis, II, 34); encore ne se trouve-t-clle qu'en Espagne et en Portugal.
(I)
Dans les autres sous-genres, le môme article des tarses est allongé,
s'épaissit graduellement, et les deux crochets, de grandeur ordinaire,
sont situés, comme de coutume, à son extrémité et dans une direction
longitudinale.
LES PSYLLIODES
(PSYI.LIODES. l-alr.)
(PI, ,3, lig. ,3.)
Oui le premior arlicle de leurs tarses poslérieurs ton long, inséré audessus
de l'exlrémité poslérleui e de la jambe ; cel l e cxlrcmi t é se prolonge
cn manière d'appendice conique, comprimé, creux, un peu denlelc suises
bords, cl lerininé par une pclile dent («). (2)
LES DIBOLIES,
( n i BOMA. Latr. ^ Auparavant AUitar>iis. )
T)onl la lète est cn majeure partie retiree dans le corselcl , et dont les
jambes poslericures sont terminées par une épine lourchue. (3)
(1) Ajoiiuz les A. hkohr, liiomcua,
àncta, alhicoUu, innata, et quelques
anives espècc-s d'Olivier.
(2) La neuvième l'aiiiitlo, ou les ^lltilarsvs
d'Illiger, renfermant les csi>èeo.s .suivantes
de OylleiiiKill ; chv) soccpUala, iiopK
hyoscinmi, tiulcaniniw, oj'fiuis.
Cellos (ju'il nomme ar'iMla,
INSKCn-F-S.
el (jnelfuios aulres donl les jambes poslérienres
sont dilatées vers le milieu de lenr
rolé postÎM'ieur, cn forme de denl, avec un
canal cn dessous, longiUidinat et cilié sur
sesl)ords. pourraient former uii sons-;;cnre
propre.
(3) Lahuilièiiie famille, IV. echii, d'Olivier,
et \\ l. oa^iUous de Gyllenliall.