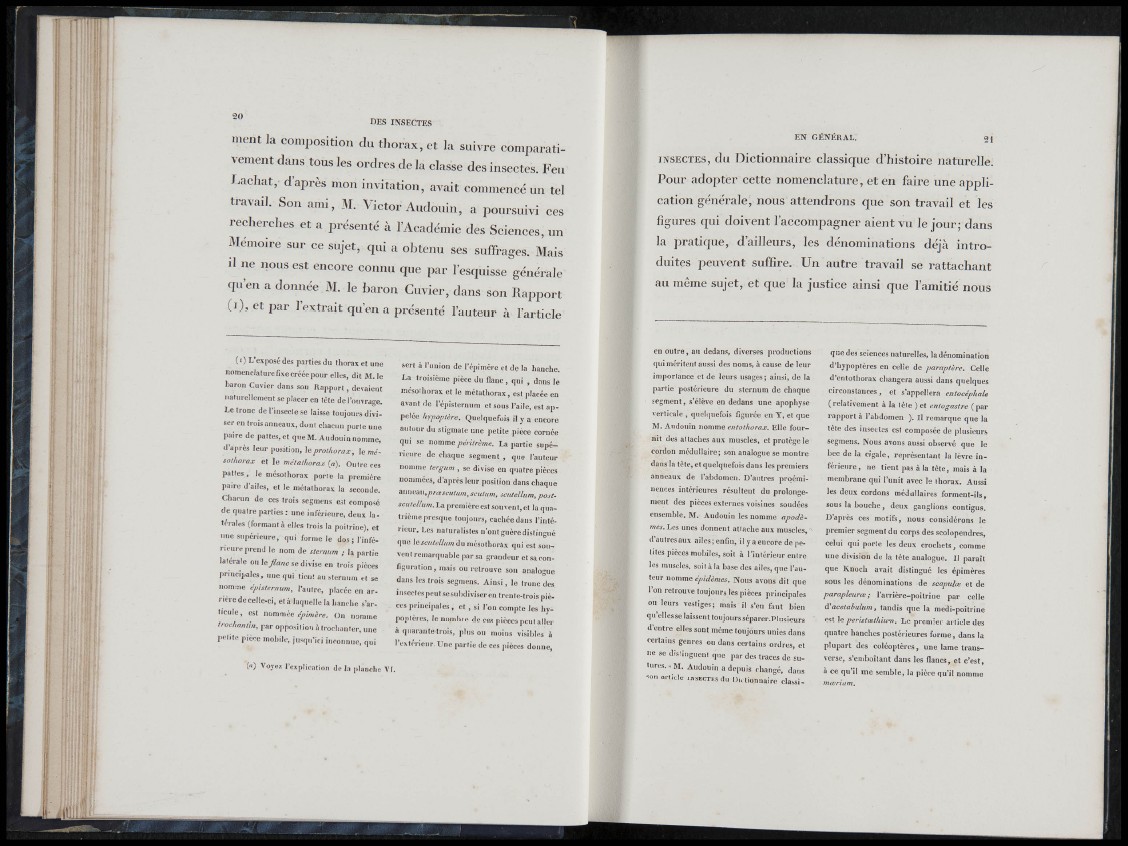
DES INSECTES
meiit la composition du tliorax, et la suivre con.parativement
dans tous les ordres de la classe des insectes. Feu
Lâchât, d'après mon invitation, avait commencé un tel
travail. Son ami, M. Victor Audouin, a poursuivi ces
recherches et a présenté à l'Académie des Sciences, un
Mémoire sur ce sujet, qui a obtenu ses suffrages. Mais
•1 ne nous est encore connu que par l'esquisse générale
q.i'en a donnée M. le baro.i Cuvier, dans son Rapport
( 0 , et par l'extrait qu'en a présenté l'auteur à l'article
( 0 L'exposé (les [inrllesdu Ihoras et une
mimeiiclalurefixecrééepour elles, dit M. le
Ijaron Cuvier dans sou Rapport, devaient
natui ellement se placer en tète de l'ouvrage.
Le troue de riuseole se laisse toujours diviser
en trois anneaux, doul chacun porte uue
paire de paites, et que M. Audouin nomme,
d'après leur position, \<iprothorax, le meiolhorax
et le métalhorax (a). Outre ce»
pattes , le niesothorax porte la première
paire d'ailes, et le métatliorax la seconde.
Chacun de ces trois segmcns est composé
de riuatre parties : une inférieure, deux latorales
(formant à elles trois la poitrine), et
"ue supérieure, qui fórmele dos ; l'intérieure
prend le nom de sternum ; la partie
latérale on l e / ^ c se divise en trois pièce»
principales, une qui tient au »lernum et se
nomme ¿¡nslmntm, l'antre, placée en arrière
de celle-ci, et à laquelle la liani he s'ar.
ticole, est nommée y r à i r e . On nonnne
trochantin, par opposition à trochanter, une
l'Clile pièce mobile, j,i<qu'iri inco qui
(a) Vojez l'oplii ation de la ,,lauclic VI.
sert .i l'nuion de l'épimère et de la hanche,
La troisième pièce du flanc , qui , dans le
mésoihorax et le métathorax, est placée en
avant de l'épisternum et sous l'aile, est appelée
hrpoptère. Quelquefois il y a encore
autour du stigmate une petite pièce cornée
qui se nomme périlritne. La i>arlie supérieure
de chaque segment , que l'auteur
nomme tergum , se divise en quatre pièces
nommées, d'après leur position dans chaque
amieaii,/)ra«„/,„„, scuttim, icutelUim, poitsmtdltun.
La première est souvent, et la quatrième
presque toujours, cachée dans l'intérieur.
Les naturalistes n'ont guèredistin^ué
quo lejc«i<-a,mdu mèsothorax qui est souvent
remarquable par sa grandeur et sa connguratioD,
mais ou retrouve son analogue
dans les trois segmcns. Ainsi, le tronc des
iusectespputsesnhdiviser en trente-trois pièecs
ju incipales , et , si l'on compte les bypoplèi
es, le nomhi c de ces pièces peut aller
à quarantetrois, pinson moins visibles à
l'extérieur. TIne partie de ces pièces donne,
EN GÉNÉRAL. 2 1
I^SECTES, du Dictionnaire classique d'histoire naturelle.
Pour adopter cette nomenclature, et en faire une application
générale, nous attendrons que son travail et les
figures qui doivent l'accompagner aient vu le jour; dans
la ]!)ratique, d ailleurs, les dénominations déjà introduites
peuvent suffire. Un autre travail se rattachant
au même sujet, et que la justice ainsi que l'amitié nous
en outre, an dedans, diverses productions
qui méritent anssi des noms, à cause de leur
importance et de leurs usages; ainsi, de la
partie postérieure du sternum de chaque
segment, s'élève en dedans une apopbyse
verticale , quelquefois figurée en Y, et que
M. Audouin nomme eiitothoraz. Elle fournit
des attaches aux muscles, et protège le
cordon médullaire; son analogue se montre
dans la tète, et quelquefois dans les premiers
anneaux de l'abdomen. D'autres proéminences
intérieures résulteut du prolongement
des pièces estei nes voisines soudées
ensemble. M. Andouiii les nomme apodimes.
Les unes donnent attache aux muscles,
d'autres aux ailes;cnfin, il y a encore de petites
pièces mobiles, soit à l'inlérieur entre
les muscles, soil à la base des ailes, que l'au-
Icur nomme Nous avons dit que
l'on retrouve toujours les pièces principales
on leurs vestiges; mais il s'en faut bien
qu'ellesse laissent toiijoin-sséparer.Plusieur»
«l'entre elles sont même toujours unies dans
certains ge.ires ou dans certains ordres, et
ne se dis:inguenl que par des traces de sulin
es.-M. Audouin a depuis changé, dans
•^on article .„SECTM,in I)i,tionuaire classique
des sciences naturelles, la dénomination
d'hypoptères en celle de paraptirc. Celle
d'entothorax changera aussi dans quelques
circojistance» , et s'appellera entocépkaU
( relativement à la léle ) et ejitogaitre ( par
r a p p o r t a l'abdomen ). Il remarque que la
tête des insectes est composée de plusieurs
segmens. Nous avons aussi observé que le
bec de la cigale, représentant la lèvre inférieure,
ne tient pas à la tète, mais à la
membrane qui l'unit avec le thorax. Aussi
les deux cordons médullaires forment-ils,
sous la bouche, deux ganglions contigus.
D'après ces motifs, nous considérons le
premier segment du corps des scolopendres,
celui qui porte les deux crochets, comme
une division de la tète analogue. Il parait
que Knoch avait distingué les epimères
sous les dénominations de scapula; et de
parapleural; l'arrière-poitrine par celle
i'acetabulum, tandis que la medi-poitrine
est le perlstoetliium. Le premier article des
quatre hanches postéiieures forme, dans la
plupart des coléoptères, une lame transverse,
s'enihoitant dans les flancs, et c'est,
à ce qu'il me semble, la pièce qu'il nomme
matriam.