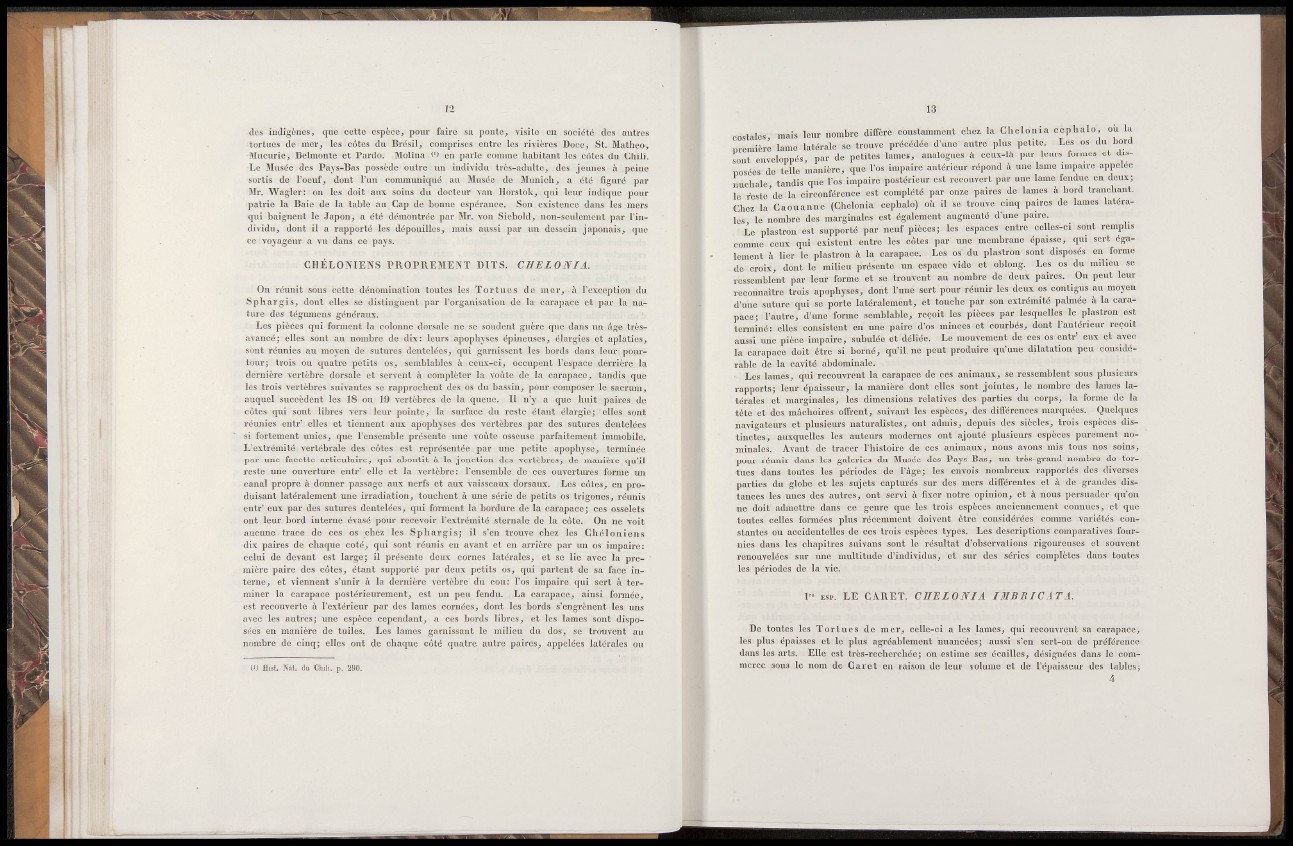
12
des indigènes, que cette espèce, pour faire sa poute, visite en société des autres
tortues de mer, les côtes du Brésil, comprises entre les rivières Doce, St. Matheo,
Mucurie, Belmonte et Pardo. Molina O en parle comme habitant les côtes du Chili.
Le Musée des Pays-Bas possède outre vui individu trè.s-adulte, des jeunes à peine
sortis de l'oeuf, dont l'uu communiqué au Musée de Munich, a été figuré par
Mr. Wagler: on les doit aux soins du docteur van Ilorstok, qui leur indique pour
patrie la Baie de la table au Cap de bonne espérance. Son existence dans les mers
qui baignent le Japon, a été démontrée par Mr. von Siebold, non-seulement ])ar l'individu,
dont il a rapporté les dépouilles, mais aussi par un dessein japonais, que
ce voyageur a vu dans ce pays.
CHÉLONIENS PROPREMENT DITS. CHELONIA.
On réunit sous cette dénomination toutes les Tortues de mer, à l'exception du
S p h a r g i s , dont elles se distinguent par l'organisation de la carapace et par la nature
des tégumeus généraux.
Les pièces qui forment la colonne dorsale ne se soudent guère que dans mi âge trèsavancé;
elles sont au nombre de dix: leurs apophyses épineuses, élargies et aplaties,
sont réunies au moyen de sutures dentelées, qui garnissent les bords dans leur pourtour;
ti'ois ou quatre petits os, semblables à ceux-ci, occupent l'espace derrière la
dernière vertèbre dorsale et servent à compléter la voûte de la carapace, tandis que
les trois vertèbres suivantes se rapprochent des os du bassin, pour composer le sacrum,
auquel succèdent les 18 ou 19 vertèbres de la queue. Il n'y a que huit paires de
côtes qui sont libres vers leur pointe, la surface du reste étant élargie; elles sont
réunies entr' elles et tiennent aux apophyses des vertèbres par des sutures dentelées
si fortement unies, que l'ensemble présente une voûte osseuse parfaitement immobile.
L'extrémité vertébrale des côtes est représentée par une petite apophyse, terminée
par line facette articulaire, qui aboutit à la jonction des vertèbres, de manière qu'il
reste ime ouverture entr' elle et la vertèbre: l'ensemble de ces ouvertures forme un
canal propre à donner passage aux nerfs et aux vaisseaux dorsaux. Les côtes, en produisant
latéralement une irradiation, touchent à une série de petits os trigones, réunis
entr' eux par des sutures dentelées, qui forment la bordure de la carapace; ces osselets
ont leur bord interne évasé pour recevoir l'extrémité sternale de la côte. On ne voit
aucune trace de ces os chez les Sphargis; il s'en trouve chez les Chéloniens
dix paires de chaque coté, qui sont réunis en avant et en arrière par un os impaire:
celui de devant est large; il présente deux cornes latérales, et se lie avec la première
paire des côtes, étant supporté par deux petits os, qui partent de sa face interne,
et viennent s'unir à la dernière vertèbre du cou: l'os impaire qui sert à terminer
la carapace postérieurement, est un pou fendu. La carapace, ainsi formée,
est recouverte à l'extérieur par des lames cornées, dont les bords s'engrènent les uns
avec les autres; une espèce cependant, a ces bords libres, et les lames sont disposées
en manière de tuiles. Les lames garnissant le milieu du dos, se trouvent au
nombre de cinq; elles ont de chaque côté quatre autre paires, appelées latérales ou
(1) Hist. iVat. du Chili, p. 290.
costales,
13
mais leur nombre diffère constamment chez la Chelonia cephalo, oii la
nremièï4 lame latérale se trouve précédée d'une autre plus petite. Les os du bord
Lut enveloppés, par de petites lames, analogues à ceux-là par leurs formes et disposées
de telle manière, que l'os impaire antérieur répond à une lame impaire appelée
michale tandis que l'os impaire postérieur est recouvert par une lame fendue en deux;
le re'stc'de la circonférence est complété par onze paires de lames à bord tranchant.
Chez la Caouanne (Chelonia cephalo) oii il se trouve cinq paires de lames latérales
le nombre des marginales est également augmenté d'une paire.
Le plastron est supporté par neuf pièces; les espaces entre celles-ci sont remplis
comme ceux qui existent entre les côtes par une membrane épaisse, qui sert également
à lier le plastron à la carapace. Les os du plastron sont disposés en forme
de croix, dont le milieu présente un espace vide et oblong. Les os du milieu se
ressemblent par leur forme et se trouvent au nombre de deux paires. On peut leur
reconnaître trois apophyses, dont l'une sert pour réunir les deux os contigus au moyen
d'une suture qui se porte latéralement, et touche par son extrémité palmée k la carapace;
l'autre, d'une forme semblable, reçoit les pièces par lesquelles le plastron est
terminé: elles consistent en une paire d'os minces et courbés, dont l'antérieur reçoit
aussi ime pièce impaire, subulée et déliée. Le mouvement de ces os entr' eux et avec
la carapace doit être si borné, qu'il ne peut produire qu'une dilatation peu considérable
de la cavité abdominale.
Les lames, qui recouvrent la carapace de ces animaux, se ressemblent sous plusieurs
rapports; leur épaisseur, la manière dont elles sont jointes, le nombre des lames latérales
et marginales, les dimensions relatives des parties du corps, la forme de la
té te et des mâchoires offrent, suivant les espèces, des différences marquées. Quelques
navigateurs et plusieurs naturalistes, ont admis, depuis des siècles, trois espèces distinctes,
auxquelles les auteurs modernes ont ajouté plusieurs espèces purement nominales.
Avant de tracer l'histoire de ces animaux, nous avons mis tous nos soins,
pour réimir dans les galeries du Musée des Pays-Bas, un très-grand nombre de tortues
dans toutes les périodes de l'âge; les envois nombreux rapportés des diverses
parties du globe et les sujets capturés sur des mors différentes et à de grandes distances
les unes des autres, ont servi à fixer notre opinion, et à nous persuader qu'on
ne doit admettre dans ce genre que les trois espèces anciennement connues, et que
toutes celles formées plus récemment doivent être considérées connue variétés constantes
ou accidentelles de ces trois espèces types. Les descriptions comparatives fournies
dans les chapitres suivans sont le résultat d'observations rigoureuses et souvent
renouvelées sur une multitude d'individus, et sur des séries complètes dans toutes
les périodes de la vie.
1 - ESP. LE CARET. CUE LO NI A I3IBRICATA.
De toutes les Tortues de mer, celle-ci a les lames, qui recouvrent sa carapace,
les plus épaisses et le plus agréablement nuancées; aussi s'en sert-on de préférence
dans les arts. Elle est très-recherchée; on estime ses écailles, désignées dans le commerce
sous le nom de Caret en raison de leur volume et de l'épaisseur des tables;
4