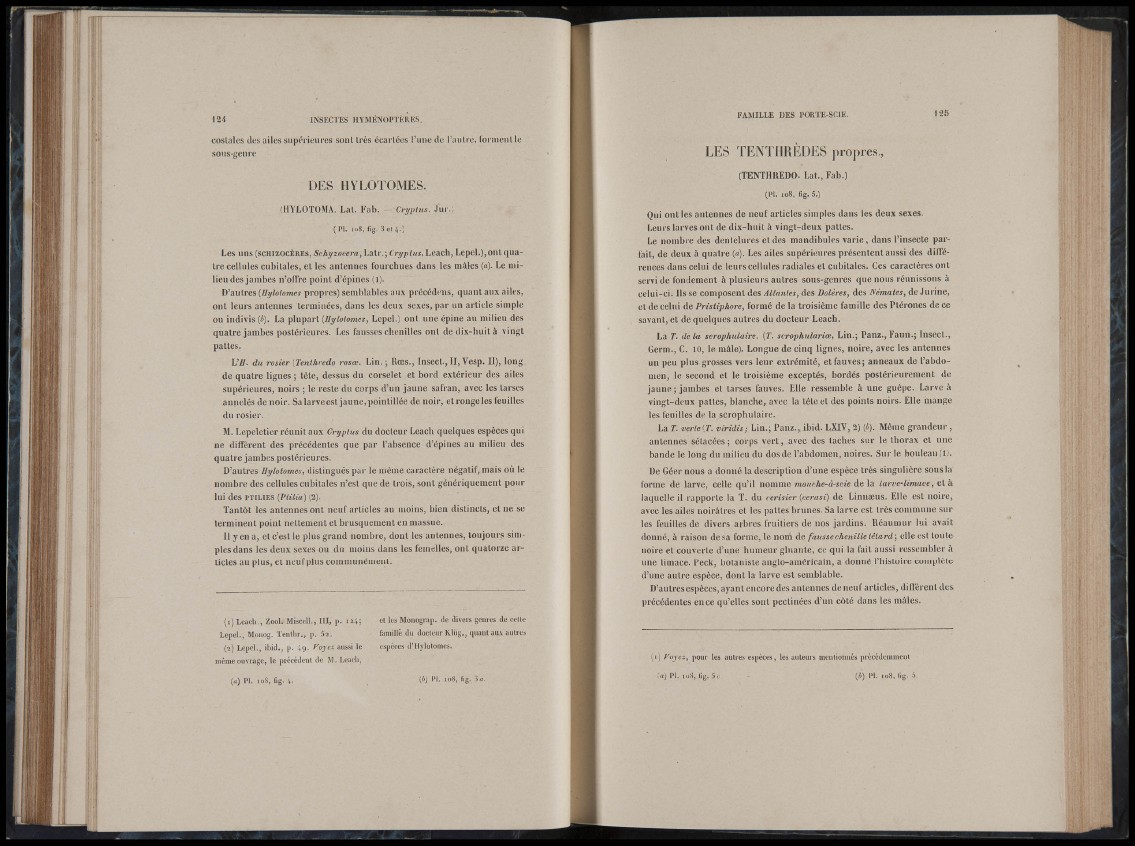
INSKOTES HYMÉNOPïkRES, FAMILLE DES l'OUTE-SCIE. 1-25
costales des ailes siipéi-ieures sonl l rès éearlées rune de l'auti'e, l'ormeiille
sons-genre
D E S HYLOTOMES.
iHYLOTOMA. LîU. ¥i\b. - Ciyplus. .lui .;
(l'I. 108. iij,'. 3 et 4-;
Les uns(scHizocÈREs,5cAyîi»ecm, Lepe l . ) ,oui quat
r e cellules cubitales, et les antennes fourchues dans les mâles (n). Le milieu
des j amb e s n'offre point d'épines (1).
D'autres (.ffyloiomcs propres) semblables aux précédcns, quant aux aiUs,
ont leurs antennes terminées, dans les deux sexes, par un article siuiple
ou indivis (¿). La plupart {Hylolomes, Lepel.) onl une épine au milieu des
q u a t r e jambes postérieures. Les fausses cheni l les ont de dix-huit à vingt
pattes.
VH. du rosier [Tenlhredo rosoe. Lin. j Roes., Insect., II, Vesp. II), long
d e quatre lignes ; tète, dessus du corselet et bord extérieur des ailes
s u p é r i e u r e s , noirs ; le reste du corps d'un jaune safran, avec les tarses
annelés de noi r . Sa larve est j aune , point i l lée de noir, et ronge les feuilles
du rosier.
M. Lepeletier réuni t aux Cryptus du docteur Leach quelques espèces qui
ne diffèrent des précédentes que par l'absence d'épines au milieu des
q u a t r e jambes postérieures.
D'autres Hylotomca-, distingués par le même caractère négatif, mai s où le
n o m b r e des cellules cubi tales n'est que de trois, sont génériquement pour
lui des P I I LIES {V tilia) (2).
Tantôt les antennes onl neuf articles au moins, bien distincts, et n e se
t e r m i n e n t point net tement el b rusquement en massue.
Il y e n a, el c'est le plus g rand nombre, dont les antennes, toujour s simples
dans les deux sexe.s ou du moins dans les femelles, ont quatorze articles
a u plus, et neuf plus communément.
(1) Leach., Z00I. Misceli., Ili, iM;
Lepel., Moiiog. Teutliv., ji. 52.
{2) Lepel., ibid., p. .'.O- Voyez aussi le
niémeouvvage, le précedenl de M. Leacli.
(«) PI.
tíl les Monogi ap. de divers genres de ceUe
famillé du docleur Kliig., (¡uaiil au\ anti ca
cspèces d'Hylolomes.
(6] PI. 108, lig. 3rt.
L E S X ENI H R E D E S ])ropres.,
(TENTHKEDO. Lai., Fab.)
(l'I. 108, Cg. 5.)
Qui ont les antennes de neuf articles simples dans les deux sexes.
Leurs larves ont de dix-hui t h vingt-deux pattes.
Le nombr e des dentelures et des mandibules varie, dans l'insecte parfait,
de deux à quatre (a). Les ailes supérieures présentent aussi des diiFérences
dans celui de leurs cel lules radiales el cubitales. Ces caractères onl
servi de fondement à plusieui s aut res sous-genres que nous réunissons ¿1
c e l u i - c i . Ils se composent des AUanies, des Dolères, des Némaics, de Jul ine,
e t de celui de Pristiphorc, formé de la troisième famille des Plérones de ce
savant, el de quelques autres du docteur Leach.
La T. de la scrophulaire. [T. scrophularioe. Lin.; Panz-, Faun. ; insect.,
Germ., C. 10, le mâle). Longue de cinq lignes, noire, avec les antennes
u n peu plus grosses vers leur extrémité, el f a u v e s ; anneaux de l'abdomen,
le second el le troisième exceptés, bordés postérieurement de
j a u n e ; jambes et tarses fauves. Elle ressemble à une guêpe. Larve à
vingt-deux pâlies, blanche, avec la tête et des points noirs. Elle man^e
les feuilles de la scrophulaire.
La T. verle'J. viridis; Lin.; Panz. , ibid. LXIV, 2) (¿). Même grandeur ,
a n t e n n e s sétacées ; corps vert, avec des taches sur le thorax et une
bande le long du milieu du dos de l 'abdomen, noires. Sur le bouleau (if.
De Géer nous a donné la descr ipt ion d'une espèce très singulière sous la
forme de larve, celle qu'il nomme mourhe-à-scie de la iarve-Umace, et à
laquelle il rapporte la T. du cerisier {cerasi) de Linnoeus. Elle est noire,
avec les ai les noirâtres et les pattes brunes. Sa larve est très c ommu n e sur
les feuilles de divers arbres fruitiers de nos jardins. Reaumur lui avait
donné, à raison de sa forme, le nom de favssechenille lêlard ] elle est toute
noire et couvert e d'une humeur gluante, ce qui la fait aussi lessemblei' à
une limace. Peck, botaniste anglo-américain, a donné l'histoire complète
d'une autre espèce, dont la larve est semblable.
D'autres espèces, ayant encor e des antennes de neuf articles, di i ïèrent du.s
précédentes enee qu'elles sont peclinées d'un côté dans les mâles.
(i) yoycz, pour tes autres espèces, tes auteurs mcnlioniiés prccédumnieiil
;«) Pl. lu«, (¡tj. Se. - Pl. to8, fiij. i».