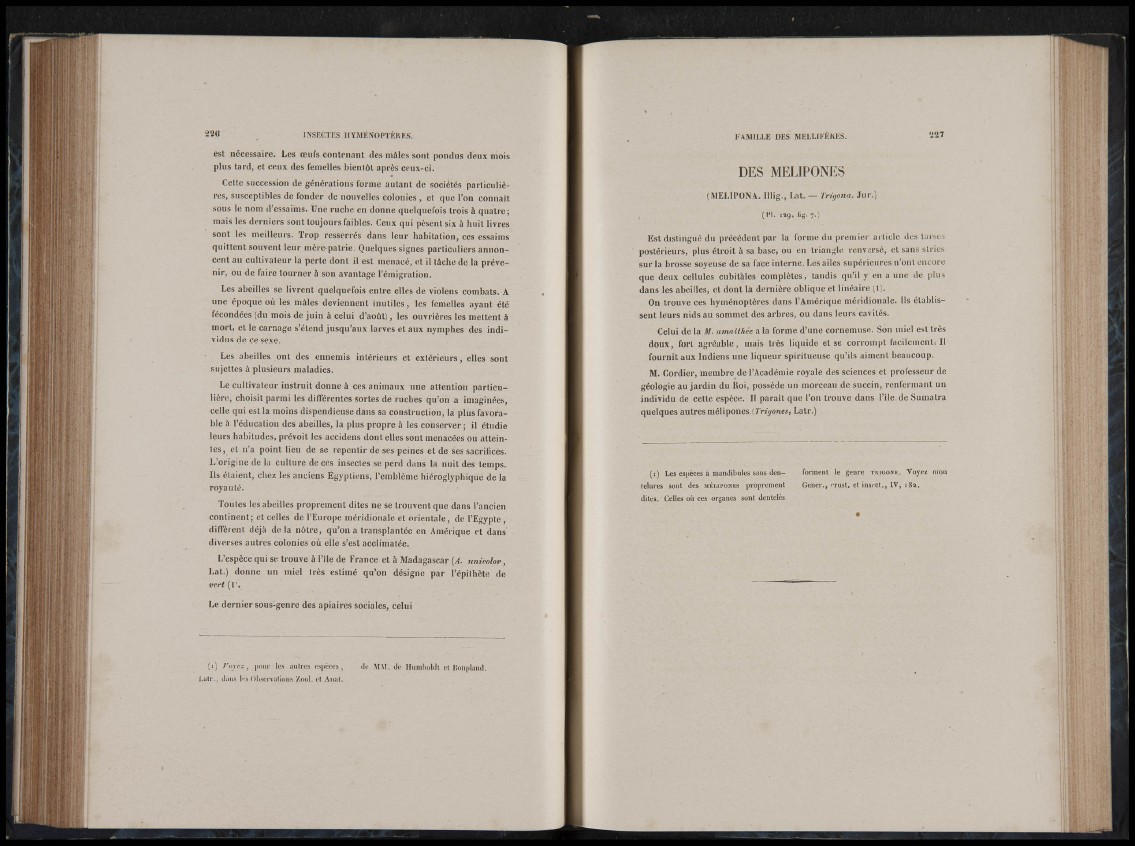
INSrCTI-S HYMKNOPTÈKF.S.
est nécessaire. Les oeufs contenant des mâles sont pondus deux mois
plus lard, el ceux des femelles bientôt après ceux-ci.
Cette succession de générations forme autant de sociétés particulières,
susceptibles de fonder de nouvelles colonies , el que l'on connaît
sous le nom d'essaims. Une ruche en donne quelquefois trois à quatre;
mais les derniers sont toujours faibles. Ceux qui pèsent six à hiiil livres
sont les meilleurs. Trop resserrés dans leur habitation, ces essaims
q u i t t e n t souvent leur mère-patrie. Quelques signes parllculiers annoncent
au cultivateur la perte dont il est menacé, el il lâche de la prévenir,
ou de faire tourner à son avantage l'émigration.
Les abeilles se livrent quelquefois entre elles de violens combats. A
une époque où les mûles deviennent inutiles, les femelles ayant été
fécondées (du mois de jui n à celui d'aoùl), les ouvrières les met tent à
mort, et le carnage s'étend jusqu'aux larves et aux nymphes des individus
de ce sexe.
Les abeilles ont des ennemis intérieurs et extérieurs, elles sont
stijettes à plusieurs maladies.
Le cul t ivateur instruit donne à ces animaux une attention particulière,
choisit parmi les différentes sortes de ruches qu'on a imaginées,
celle qui est la moins dispendieuse dans sa construction, la plus favorable
h l'éducation des abeilles, la plus propr e à les conserver ; il étudie
l e u r s habitudes, prévoit les accidens dont elles sont menacées ou atteint
e s , et n'a point lieu de se repentir de ses peines et de ses sacriiices.
L ' o r i g i n e de la culture de ces insectes se perd dans la nuit des temps.
Ils étaient, chez les anciens Égyptiens, l'emblème hiéroglyphique de la
royauté.
Toutes lesabeilles proprement dites ne se t rouventque dans l'ancien
c o n t i n e n t ; et celles de l'Europe méridionale et orientale, de l'Egypte ,
d i f f è i e n t déjà delà nôtre, qu'on a transplantée en Amérique et dans
diverses autres colonies où elle s'est acclimatée.
L'espèce qui se trouve à l'île de France et à Madagascar {A. nnimlor,
Lat.) donne un miel très estimé qu'on désigne par Tépithète de
vert (1\
Le dernier sous-genre des apiaires sociales, celui
fi] f'ofe:, pour les autres es))cces,
Lytr-, dans t-s ( H.smalions Zool. el Anal.
lie M\J. de Hiimholdl cl r,on|)l;iiul.
Jb AMlLLE DES MliLLIFKia-S.
DES MELIPONES
( MELIPONA. Illig., Lat. — Trùjonn. Jur.)
(i'I. ny, fi-.. 7.)
Est distingué du précédent par la forme du premiei' article des tarses
postérieurs, plus étroit à sa base, ou en triangle renversé, et sans stries
sur la brosse soyeuse de sa face interne. Les ailes supérieures n'ont encore
que deux cellules cubitales complètes, tandis qu'il y en a une de plus
dans les abeilles, et dont là dernière oblique et linéaire (!)•
On trouve ces hyménoptères dans l'Amérique méridionale. Ils établissent
leurs nids au sommet des arbres, ou dans leurs cavités.
Celui de la M- amnLtkée a la forme d'une cornemuse. Son miel est très
d o u x , fort agréable, mais très liquide else corrompLfacilemenl.il
f o u r n i t aux Indiens une liqueur spirituease qu'ils aiment beaucoup.
M. Cordier, menibre de l'Académie royale des sciences et professeur de
géologie au jardi n du Roi, possède un morceau de succin, renfermant un
individu de cette espèce. Il parait que l'on trouve dans l'ile de Sumatra
quelques autresmél ipones [Trùjones, Latr.)
(i) Les es|)èces à mandibules sans dentelures
sont des MÉLIPONES proprement
dites. Celles où ces orjjanes sont dentelés
forment le genre TRIGO.-ÎE. Voyei
Gener., '^rust. et insi-ct., IV, iSa.