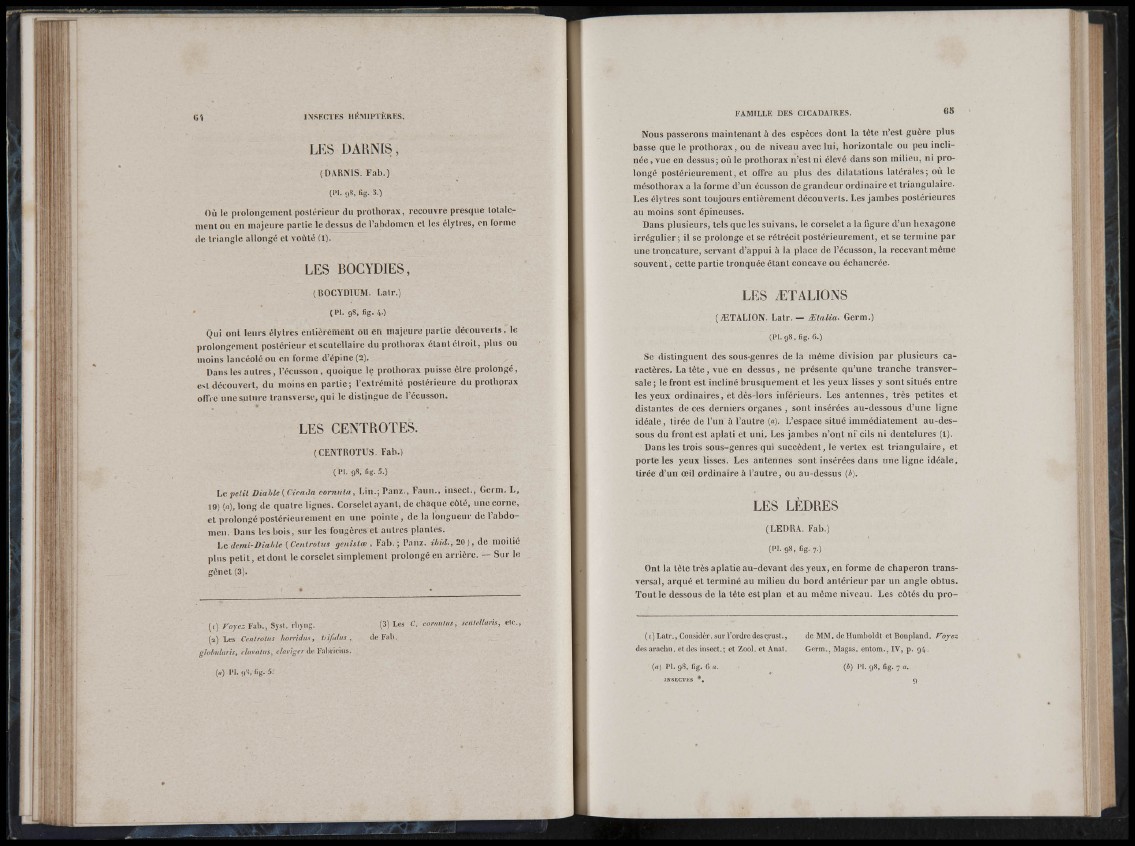
TTT
ïl-
( i ' l IN S F C T K S lUiMll'lkUKS.
LES DAHNIS,
(DARNIS. Fab.)
Où le prolongement poslérieur du prothorax, recouvre presque lolalenienl
ou en majeure partie le dessus de l'alKlomcn et les élyires, en forme
de triangle allongé et voûté (1).
LES BOCYDIES,
(BOCYDTUM. I.alr.)
(Pl. 98. Cg. 4-)
Qui ont leurs élytres entièrement ou en majeure partie découverts, le
prolongement postérieur et sculellaire du prolliorax étantéiroit, plus ou
moins lancéolé ou en forme d'épine (2).
Dans les aut res, l'écusson, quoique le protliorax puisse être prolongé,
est découvert, du moins en partie ; l'extrémité postérieure du prothprax
oITrc une suture transverse, qui le distingue de l'écusson.
LES CENTROTES.
(CENTROÏUS, Fab.)
( I M . 9S, fii. 5.)
Le relit Dial,le ( Cimila cannila, l,in.; Panz., Faun., insect.. Germ. L,
19) W, long tie quatre lignes. Corselet ayant, de chaque côté, une corne,
et prolongé postérieurement en une pointe , de la longueur de l'abdomen.
Dans les bois, sur les fougères et autres plantes.
Leikmi-nial,le {Ceniroiiis geiiisloe , Fab. ; Panz. iii<7., 20), de moitié
plus petit, et dont le corselet simplement prolongé en arrière. — Sur le
génet (3).
( t ) roy c z Fab., Sjsl. vlijiig.
(a) Les Cenlroiiis honidu.u tiifulus ,
ghhilaris, rltifntiis, cìctvìger tU- t'al)rioiils.
M Pl. ii'i. ils. 5.
(3) Les C. conmli'S, scutclUms, elc.,
clc! Fall.
F A M I L L E DES CICADAIRE.S. OS
Nous passerons maintenant à des espèces dont la tète n'est guère plus
basse que le prothorax, ou de niveau avec lui, horizontale ou peu inclin
é e , vue en dessus; où le prothorax n'est ni élevé dans son milieu, ni prolongé
postérieurement, et offre au plus des dilatations latérales; où le
mésothorax a la forme d'un écusson de gi andeur ordinaire et triangulaire.
Les élytres sont toujours ent ièrement découverts. Les jambes postérieures
au moins sont épineuses.
Bans plusieurs, tels que les suivans, le corselet a la figure d'un hexagone
irrégulier ; il se prolonge et se rétrécit postérieurement , et se termine par
une troncature, servant d'appui à la place de l'écusson, la recevant même
souvent, cette partie tronquée étant concave ou échancrée.
LES ^ETALIONS
{î:TALION. Latr. — m a l i a . Germ.)
( P l . 98. fig. 6.)
Se distinguent des sous-geni-es de la même division par plusieurs caractères.
La t è t e , vue en dessus, ne présente qu'une tranche transversale
; le f ront est incliné brusquement et les yeux lisses y sont situés entre
les yeux ordinaires, et dès-lors inférieurs. Les antennes, très petites et
distantes de ces derniers organes , sont inséi'ées au-dessous d'une ligne
idéale , tiiée de l'un à l'autre (a). L'espace situé immédiatement au-dessous
du front est aplati et uni. Les jambes n'ont ni'cils ni dentelures (1).
Dans les trois sous-genres qui succèdent, le vertex est triangulaire, et
porte les yeux lisses. Les antennes sont insérées dans une ligne idéale,
tirée d'un oeil ordinaire à l'autre, ou au-dessus (¿).
LES LÈDRES
(LEDRA. Fab.)
CI'!- gs.Gg- 7-)
Ont la léle très aplatie au-devant des 3'eux, en forme de chaperon transversal,
arqué et terminé au milieu du bord antérieur par un angle obtus.
Tout le dessous de la tôle est plan et au môme niveau. Les côtés du pro-
( 1 ) L a l r . , Consider, sur l 'ordr e des c rust . ,
de-saracUu. el des insect.; el Zool. el Anat.
(«) I'l.gS, Hg. (i«.
INSECTl'S
de M M . de H umb o l d l et Bonpland. Voyez
G e r m . , Magas. entom., I V , p. 94,
(¿) l'I. 98. fig. 7« .