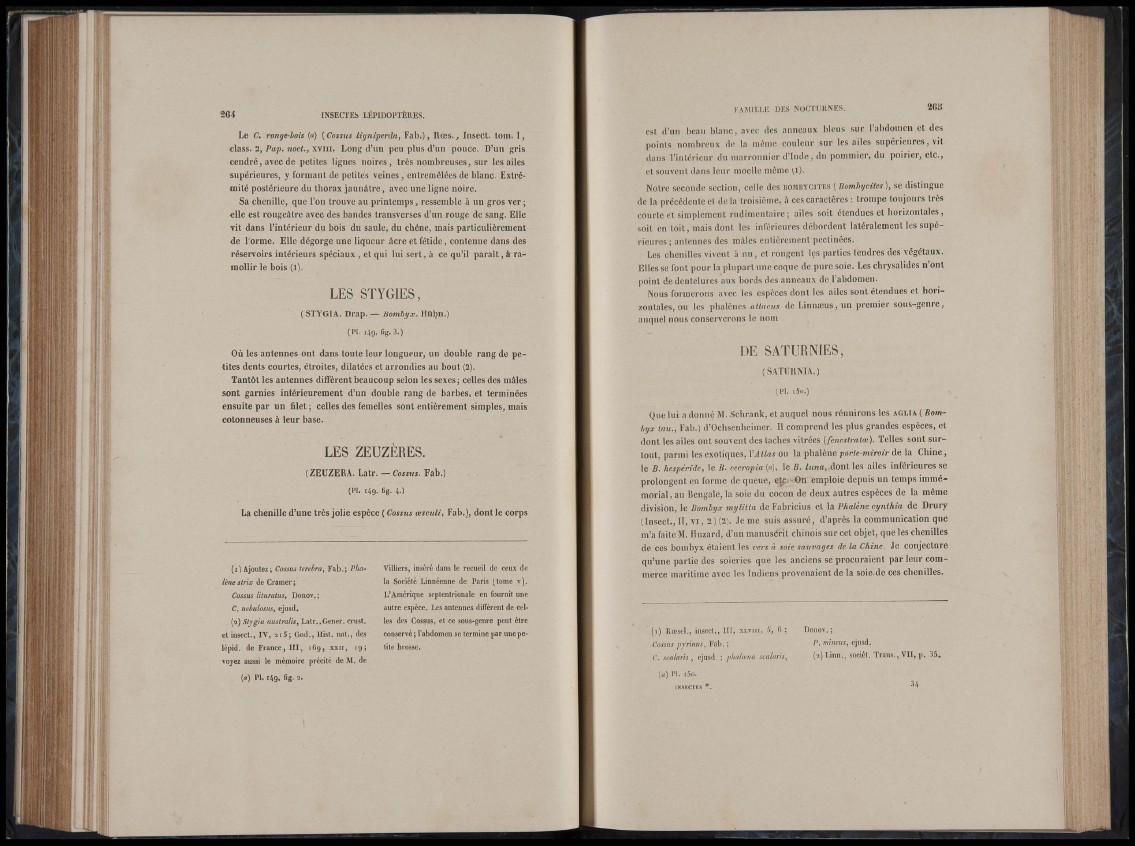
> I
I
I ,
2 6 4 INSECTES LÉPIDOPTÈRES.
Le C, ronge-lois {a) [Cossus lùjniperda, Fab.), Roes. , Insect, torn. I,
class. 2, Pap. noct., xviii. Long d'un peu plus d'un pouce. D'un gris
c e n d r é , avec de petites lignes noires, très nombreuses, sur les ailes
supérieures, y formant de petites veines , enlremélées de blanc. Extrémité
postérieure du thorax jaunâtre , avec une ligne noire.
Sa chenille, que l'on trouve au pr intemps, ressemble à un gros ver;
e l l e est rougeâtre avec des bandes transverses d'un rouge de sang. Elle
vit dans l'intérieur du bois du saule, du chêne, mais particulièrement
d e l o rme . Elle dégorge une liqueur âcre et fétide, contenue dans des
réservoirs intérieurs spéciaux , et qui lui sert, à ce qu'il paraît, à ramollir
le bois (1).
LES STYGIES,
( STYGIA. Drap. — Bombyx. Hubn.)
( P l . r49. Cs.3.)
Où les antennes ont dans toute leur longueur, un double rang de petites
dents courtes, étroites, dilatées et arrondies au bout (2).
Tantôt les antennes diffèrent b e aucoup selon les sexes; celles des mâles
sont garnies intérieurement d'un double rang de barbes, et terminées
e n s u i t e par un filet; celles des femelles sont ent ièrement simples, mais
cotonneuses à leur base.
LES ZEUZÈRES.
(ZEUZERA. Latr. — Cossus. Fab.)
(Pl. 149. Ëg- 4.1
La chenille d'une très jol i e espèce ( Cossus oescuU, Fab.), dont le corps
( l i Ajoutez; Cossus terebra, Fab.; Phalène
strix de Cramer ;
Cossus (iluratus, Donov.;
C. nebulosus, ejusd.
{2) Stygiu auslralis, Lalr..Gener. crust,
el insect., IV, 2 i5; God., Hist, nat., des
lépid. de France, III, 169, xxii, (9;
Toyez aussi le mémoire précité de M. de
{a) Pl. 149. fig.
Villiers, inséré dans le recueil de ceux de
la Société Linnéenne de Paris (tome v).
L'Amérique septentrionale en fournit une
a u t r e espèce. Les antennes dilFèrent de celles
des Cossus, et ce sous-genre peut être
conservé ; l ' abdome n se termine par une petite
brosse.
j
l'AMn.UÎ DES NOCTIJIINES. ÎCK
esl (l'un beau hlaiic, avec des anneaux bleus sur ral)(lonirn el îles
poinls nombreux de la même couleur sur les ailes supérieures, vil
dans rinlcrieur du marronnier d'Inde, du pommier, du poirier, etc.,
et souvent dans leur moelle niùme tl)-
Noire seconde section, celle des bombycites ( Bomhycilcs ), se distinRue
de la précédente cl delà troisième, à cescoraclères : Irompe toujours très
courte et simplement rudimentaire ; ailes soit étendues et horizontales ,
soit en toit, mais dont les inférieures débordent latéralement les supérieures
; ant enne s des mâles entièrement pectinées.
Les chenilles vivent à n u , et rongent les parties tendres des végétaux.
Elles se l'ont pour la p lupar t nne coque de pur e soie. Les chrysal ides n'ont
point de dentelures aux bords des anneaux de l'abdomen.
Nous formerons avec les espèces dont les ailes sont étendues et horizontales,
ou les iihalène.s allaoïs de Linnoeus, im premier sous-genre,
auquel nous conserverons le nom
DE SATURNIES,
(SATURNIA.)
( P i . i5o.)
Que lui a donne M. Schrank, et auquel nous réunirons les agl i a ( Bomhyx
tnu., Fab.) d'Ochsenbeimer. Il comprend les plus grandes espèces, et
dont les ailes ont souvent des taches vitrées [fenestratoe). Telles sont surtout,
parmi les exot iques, VA lias ou la phalène porte-miroir de la Chine,
le B. hespéride, le B- cccropia {a), le B. ¿wna,.donl les ailes inférieures se
prolongent en forme de queue, e^. -On emploie depuis u n temps immémorial
, a u Bengale, la soie du cocon de deux autres espèces de la même
division, le Bombyx mylitta de Fabricius el la Phalène cijnihia de Drury
( I n s e c t . , n , VI, 2)(2}. J eme suis assuré, d'après la communicat ion que
m'a faite M. Huzard, d'un manuscri t chinois sur cet objet, que les chenilles
de ces bombyx étaient les vers à soie sauvages de la Chine. -le conjecture
q u ' u n e partie des soieries que les anciens se procuraient par leur commerce
maritime avec les Indiens provenaient de la soie.de ces chenilles.
( t ) Roesel, insect., II!, xi.tcii, 5, 6 ; Donov.;
Cas-ius pyrhms, Fab. ; P.
C. scala ri s , ejusd. ; plialoeiia scalnris, (2) Li
(«) Pl. .50.
INSECTF.S *.
, ejusd.
.sociét. Trans, , VIT, p . :i5.