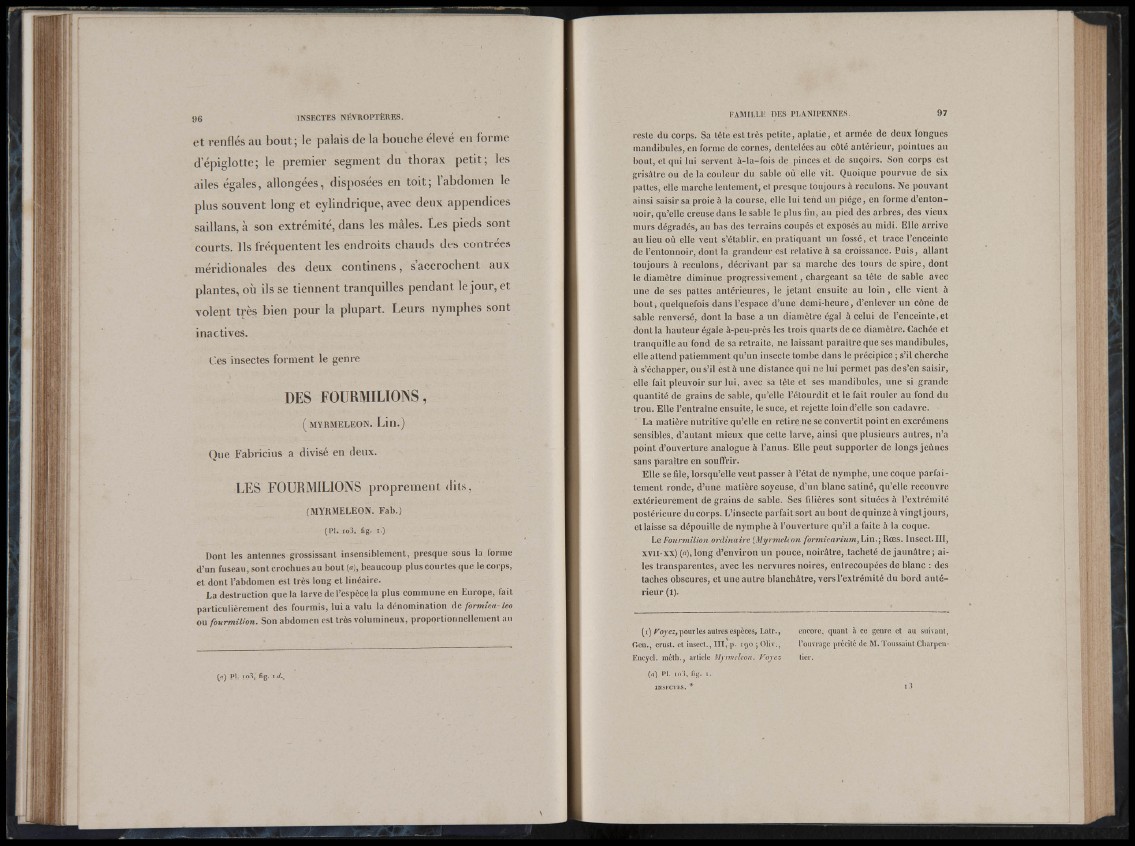
Ipr! «
I ' i ' a
Mi
•16 INSECTES NÉVROPTÈRES.
et renflés au bout; le palais de la bouche élevé eu foi nie
depiglotle; le premier segment du thorax petit; les
ailes égales, allongées, disposées en toit; l'abdomen le
plus souvent long et cylindriqiie, avec deux appendices
saillans, à son extrémité, dans les mâles. Les pieds sont
courts. Ils fréquentent les endroits chauds des contrées
méridionales des deux continens, s'accrochent aux
plantes, oil ils se tiennent tranquilles pendant le jour, et
volent très bien pour la plupart. Leurs nymphes sont
inactives.
i:es insectes forment le genre
DES FOURMILIONS,
( m y e m e l e o n . Lin.)
Que Fabricius a divisé en deux.
LES FOURMILIONS proprement dits,
(MYRMELEON. Fab.)
(1>1. ro3. fig. I.)
Dont les antennes grossissanl insensiblement, presque sous la forme
d'un fuseau, sont c rochues au bout (a), beaucoup plus cour les que le corps,
el dont l'abdomen est très long et linéaire.
La destruction que la larve de l'espiice la plus commune en Europe, fait
particulièrement des fourmis, lui a valu la dénominat ion i\e formim-leo
ou fourmilion. Son abdomen est très volumineux, proportionnellemenl au
(») Pl. io3. Eg. 1./..
I'AMI[.U! niîS PT.ANIPENNES, 97
reste du corps. Sa tito est très petite, aplatie, el armée de deux longues
mandibules, en forme de cornes, dentelées au côté antérieur, pointues au
bout, et qui lui servent à-ia-fois de pinces et de suçoirs. Son corps est
grisâtre ou de la couleur du sable où elle vit. Quoique pourvue de si,\
pattes, elle marche lentement , et presque toujours à reculons. Ne pouvant
ainsi saisir sa proie à la course, elle lui tend un piège, en forme d'entonnoir,
qu'elle creuse dans ïe sable le plus lin, au pied des arbres, des vieux
murs dégradés, au bas des terrains coupés et exposés au midi. Elle arrive
au lieu où elle veut s'établir, en pratiquant un fossé, et trace l'enceinte
de l'entonnoir, dont la grandeur est relative à sa croissance. Puis, allant
toujours à reculons, décrivant par sa marche des tours de spire, dont
le diamètre diminue progressivement, chargeant sa tète de sable avec
une de ses pattes antérieures, le jetant ensuite au loin, elle vient à
bout, quelquefois dans l'espace d'une demi-heure, d'enlever un cône de
sable renversé, dont la base a un diamètre égal à celui de l'enceinte,et
dont la hauteur égale à-peu-près les trois quarts de ce diamètre. Cachée et
tranquille au fond de sa retrai te, ne laissant paraî tre que ses mandibules,
elle at tend pat iemment qu'un insecte tombe dans le précipice ; s'il cherche
à s'échapper, ou s'il est à une distance qui ne lui permet pas de s'en saisir,
elle fait pleuvoi r sur lui, avec sa tète et ses mandibules, une si grande
quantité de grains de sable, qu'elle l'étourdit et le fait rouler au fond du
trou. Elle l'entraîne ensuite, le suce, et rejette loin d'elle son cadavre.
La nialière nutritive qu'elle en retire ne se conver t î t point en cxcrémens
sensibles, d'autant mieux que cette larve, ainsi que plusieurs autres, n'a
point d'ouverture analogue à l'anus. Elle peut supporter de longs jeùues
sans paraître en soufTrir.
Elle se file, lorsqu'elle veut passer à l'état de nymphe, une coque parfaitement
ronde, d'une matière soyeuse, d'un blanc satiné, qu'elle recouvre
extérieurement de grains de sable. Ses filières sont situées à l'extrémité
postérieure du corps. L'insecte parfait sort au bout de quinze à vingt jours,
etlaisse sa dépouille de nymphe à l 'ouverlure qu'il a faite à la coque.
L e FoiirmiLioii ordinaire {M?/rmelto}t formicarittm, Lin.; R oe s . I n s e c t . I l l ,
XYII-XX) (a), long d'environ un pouce, noirâtre, tacheté de jaunût r c ; ailes
transparentes, avec les nervures noires, entrecoupées de blanc : des
taches obscures, et uue aut r e blanchâtre, vers l'extréniité du bord antérieur
(1).
(i) ^ojer,poiirles autres espèces, Lalr.,
r.cn., crust, et iiiscct., i n , p. tgo ; Oliv.,
Kiicycl. mélh., article HJfmdcoii. f^oycz
M Pl. „.1, r.g, ..
INSKCl liS. *
encore, quant à ce geurc ut au suivant,
l'ouvrage prccilc de M. Tonssaiul Cliarpeulier.