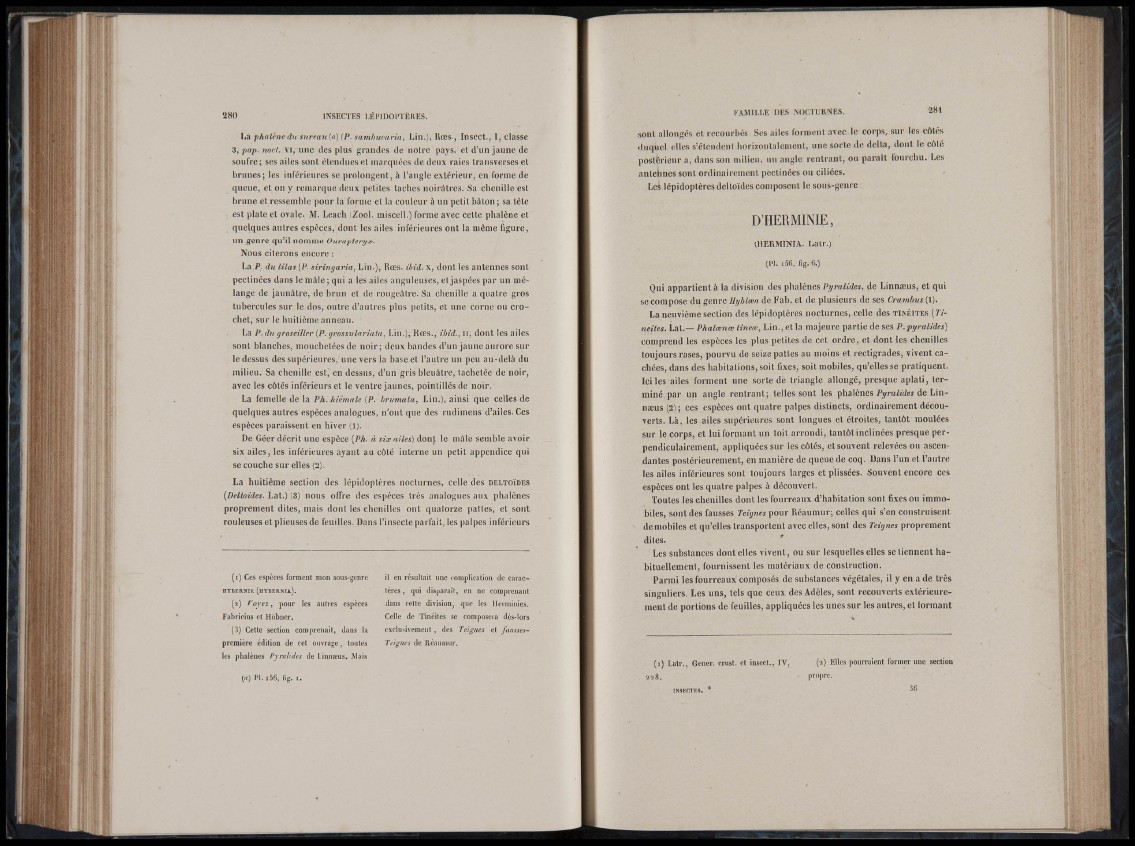
i
ü p f j ^ ;
l ' i ; » ' I '
Iii : :.
li V; •
m ; - , f
i f : ; .
. i ' t ; ; 'i-
•F'j :
sii 7
i:
i
' ¡ i IS
280 tNSECTKS LtìPIDOi'TÉKES.
La phalène du sureau {a) {P. s amò uf tin a, Lin.). Roes-, insect., 1, classe
3, pap. 7iovl. VI, une ties plus grandes de notre pays, et d'iin jaune de
s o u f r e ; ses ailes soni étendues et mai-qnccs de deux raies traiisverses el
b r u n e s ; les inférieures se prolongent , à l'anf^le extér ieur , en forme de
queue, el on y remarque deux petites taches noirâtres. Sa chenille est
b r u n e et ressembl e pour la forme et la couleur à un petit bâlon ; sa tête
est plate et ovale. M. Leach iZool- misceli.) forme avec celle phalène et
quelques autres espèces, dont les ailes inférieures ont la même figure,
un genre qu'il nomme Ouraplenjx.
Nous citerons encore :
La p. du nias {P. siring aria, Lin.), Roes. ibid. dont les antennes sont
pectinées dans le mâ l e ; qui a les ailes anguleuses, et jaspées par un mélange
de jaunâtre, de brun el tie roiigeùtre. Sa chenille a quatre gros
tubercules sur le dos, outre d'autres plus petits, et une corne ou crochet,
sur le hui t ième anneau.
La P. du groseiller {P. grossitlarinla. Lin,), Koes., i/iid., Il, dont les ailes
sont blanches, mouchetées de noir; deux bandes d'un jaune aurore sulle
dessus des supér ieures, une vers la base et l'autre un peu au-delà du
milieu. Sa chenille est," en dessus, d'un gris bleuâtre, tachetée de noir,
avec les côtés inférieurs et te vent r e jaunes, pointillés de noir.
La femelle de la Ph. hiémaLe {P. ¡¡rumata. Lin.), ainsi que celles de
quelques autres espèces analogues, n'ont que des rudimens d'ailes. Ces
espèces paraissent en hiver (i).
De Géer décrit une espèce {Ph. à six ailes) dont le mùle semble avoir
six ailes, les inférieures ayant au côté interne un petit appendice qui
se couche sur elles {2).
La huitième section des lépidoptères nocturnes, celle des DELTOÏDES
{Dcltoides. Lat.) (3) nous offre des es[>èces très analogues aux phalènes
p r o p r e m e n t dites, mais dont les chenilles ont qualorze pattes, et sont
rouleuses et plieuses de feuilles. Dans l'insecte parfai t, les palpes inférieurs
( i ) Ces espèces forment mon sous-genre
(a) l-'oyez, pour les autres espèces
Fabricius et Hiibner.
(3) Cette section comprenait, dans la
première édition de cel ouvrage, toutes
les phalènes PyraUdes de tinnoeus. Mais
(a) i'I. i56, fig. I.
il en résultait une coroplic.ntion de caract
è r e s , qui disparaît, on ne comprenant
dans celle division, ipie les llenninies.
Celle de Tinéites se cûmpo.seta dès-lors
exclu«ivemeiit , des Teignes el fuiisses-
Tfigncs de Iléauiniir.
DES NOCTURNES. 2« !
sont allongés et recourbés Ses ailes forment avec le corps, sur les côtés
duquel elles s'étendent horizontalement, une sorte de delta, dont te côté
postérieur a, dans son milieu, un angle rentrant, ou paraît fourchu. Les
antehnes sont ordinairement pectinées ou ciliées.
Leà lépidoptères deltoïdes composent le sous-genre
D ' H E R M I N I E ,
(HERMINIA. Latr.)
(Pl. i5fì. iig.fi.)
Qui appartient à la division des phalènes Pyralides, de Linnaîus, el qui
se compos e du genre Ihjhloen de Fab. et de plusieurs de ses Cramhns{\).
La neuvième section des lépidoptères nocturnes, celle des TIKÉITES [Tineiles.
Lat.— Phaloenoe lincoe. Lin., et la majeur e part i e de ses P.pyralides)
comprend les espèces les plus petites de cet ordre, et dont les chenilles
t o u j o u r s rases, pourvu de seize pat tes au moins et rectigrades, vivent ca -
chées, dans des habi tat ions, soit fixes, soit mobiles, qu'elles se pratiquent.
Ici les ailes forment une sorte dè triangle allongé, presque aplati, terminé
par un angle rentrant; telles sont les phalènes Pyra/idei de Linnîeus
(2); ces espèces ont quatre palpes distincts, ordinairement découverts.
Là, les ailes supérieures sont longues et étroites, tantôt moulées
sur le corps, el lui formant un toit arrondi , tantôt inclinées presque perpendiculairement,
appliquées sur les côtés, et souvent relevées ou ascendantes
postérieurement, en manière de queue de coq. Dans l'un et l'autre
les ailes inférieures sont toujours larges et plissées. Souvent encore ces
espèces ont les quat r e palpes à découvert.
Toutes les cheni l les dont les four reaux d'habitation sont fixes ou immobiles,
sont des fausses rc/jiMPi p o u r Réaumur; celles qui s'en construisent
de mobi les el qu'el les transportent avec elles, sont des pr o p r eme n t
diles.
Les substances dont elles vivent , ou sur lesquelles elles se t iennent habituellement,
fournissent les matériaux de construction.
Parmi les four reaux composés de substances végétales, il y en a de très
singuliers. Les uns, tels que ceux des Adèles, sont recouverts extérieurement
de portions de feuilles, appl iquées les unes sur les aut res, et lormant
( i ) Lalr., Gener. cnist. et insect., IV, (a) Elles pourraient former une section
propre.