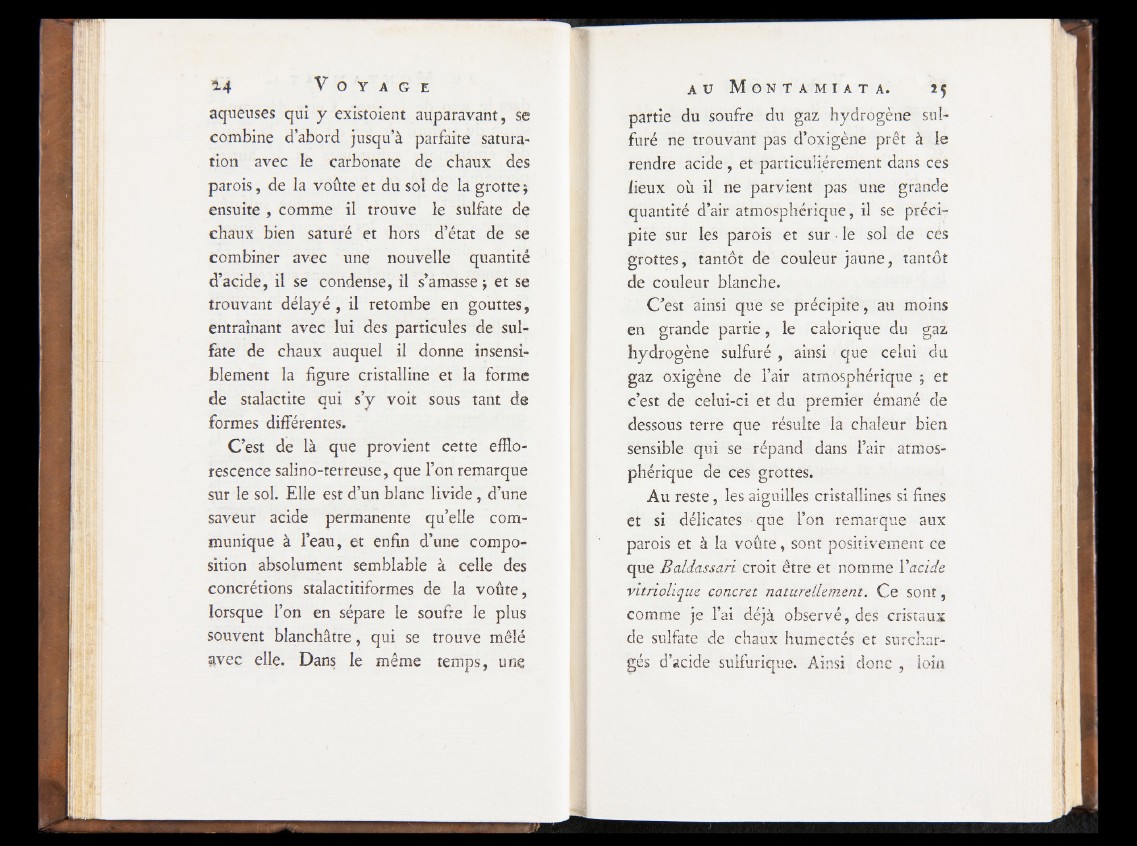
aqueuses qui y existoient auparavant, se
combine d’abord jusqu’à parfaite saturation
avec le carbonate de chaux des
parois, de la voûte et du sol de la grotte ;
ensuite , comme il trouve le sulfate de
chaux bien saturé et hors d’état de se
combiner avec une nouvelle quantité
d’acide, il se condense, il s’amasse 5 et se
trouvant délayé , il retombe en gouttes,
entraînant avec lui des particules de sulfate
de chaux auquel il donne insensiblement
la figure cristalline et la forme
de stalactite q* ui s’yv voit sous tant de
formes différentes.
C ’est de là que provient cette efflorescence
salino-terreuse, que l’on remarque
sur le sol. Elle est d’un blanc livide, d’une
saveur acide permanente qu’elle communique
à l’eau, et enfin d’une composition
absolument semblable à celle des
concrétions stalactitiformes de la voûte,
lorsque l’on en sépare le soufre le plus
souvent blanchâtre, qui se trouve mêlé
avec elle. Dan§ le même temps, une
partie du soufre du gaz hydrogène sulfuré
ne trouvant pas d’oxigène prêt à le
rendre acide, et particuliérement dans ces
lieux où il ne parvient pas une grande
quantité d’air atmosphérique, il se précipite
sur les parois et sur • le soi de cës
grottes, tantôt de couleur jaune, tantôt
de couleur blanche.
C ’est ainsi que se précipite, au moins
en grande partie, le calorique du gaz
hydrogène sulfuré , ainsi que celui du
gaz oxigène de l’air atmosphérique ; et
c’est de celui-ci et du premier émané de
dessous terre que résulte la chaleur bien
sensible qui se répand dans l’air atmosphérique
de ces grottes.
Au reste, les aiguilles cristallines si fines
et si délicates que l’on remarque aux
parois et à la voûte, sont positivement ce
que Bcildassari croit être et nomme l 'acide
vitriolique concret naturellement. Ce sont,
comme je l’ai déjà observé, des cristaux
de sulfate de chaux humectés et surchargés
d’acide sulfurique. Ainsi donc , loin