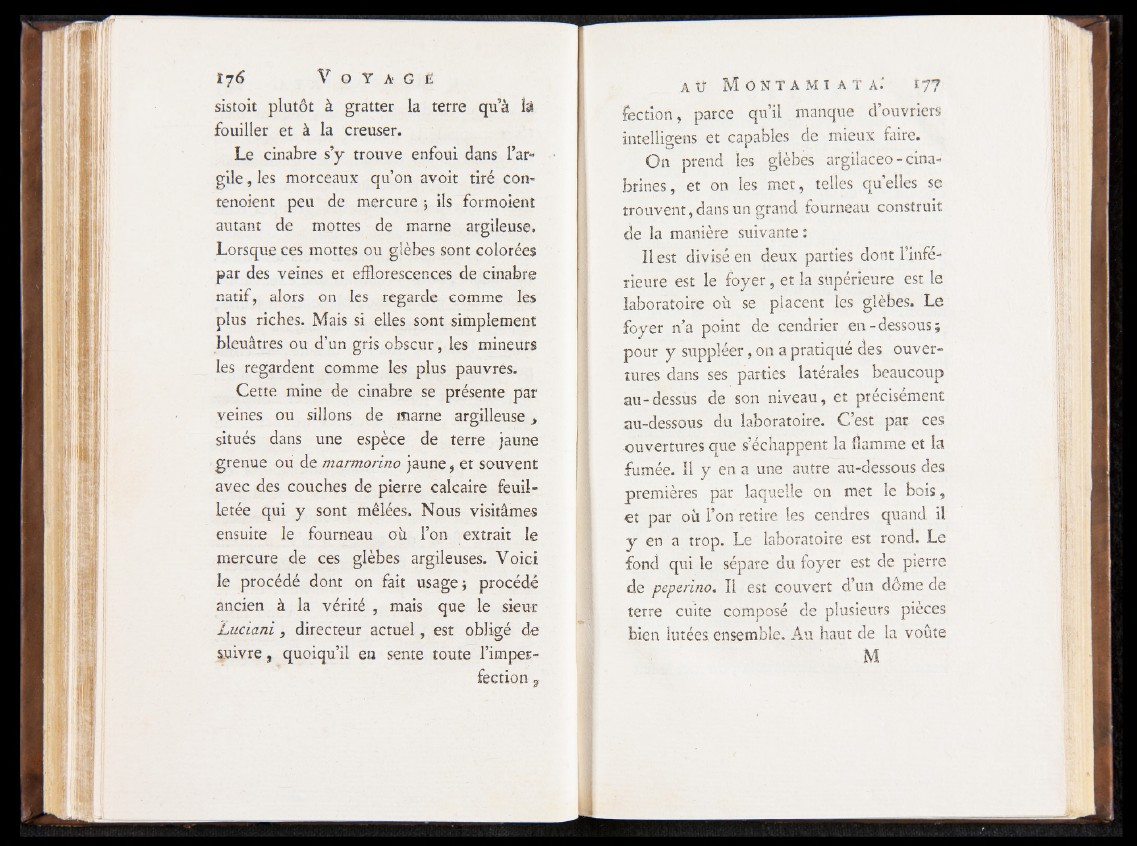
i? 6 V o y a g é
sistoit plutôt à gratter la terre qu’à là
fouiller et à la creuser.
Le cinabre s’y trouve enfoui dans l’argile
, les morceaux qu’on avoit tiré con-
tenoient peu de mercure * ils formoient
autant de mottes de marne argileuse,
Lorsque ces mottes ou glèbes sont colorées
par des veines et efflorescences de cinabre
natif, alors on les regarde comme les
plus riches. Mais si elles sont simplement
bleuâtres ou d’un gris obscur, les mineurs
les regardent comme les plus pauvres.
Cette mine de cinabre se présente par
veines ou sillons de marne argilleuse >
situés dans une espèce de terre jaune
grenue ou de marmorino jaune , et souvent
avec des couches de pierre calcaire feuilletée
qui y sont mêlées. Nous visitâmes
ensuite le fourneau où l’on extrait le
mercure de ces glèbes argileuses. Voici
le procédé dont on fait usage* procédé
ancien à la vérité , mais que le sieur
Luciani directeur actuel, est obligé de
suivre, quoiqu’il en sente toute l'imperfection
,
a ü M o n t a m i ATAl 177
fection, parce qu’il manque d’ouvriers
intelligens et capables de mieux faire.
On prend les glèbes argilaceo - cina-
brines, et on les met, telles quelles se
trouvent, dans un grand fourneau construit
de la manière suivante :
11 est divisé en deux parties dont l’inférieure
est le fo y e r, et la supérieure est le
laboratoire où se placent les glèbes. Le
foyer n’a point de cendrier en-dessous;
pour y suppléer, on a pratiqué des ouvertures
dans ses parties latérales beaucoup
au-dessus de son niveau, et précisément
au-dessous du laboratoire. C ’est par ces
ouvertures que s’échappent la flamme et la
fumée. 11 y en a une autre au-dessous des
premières par laquelle on met le bois,
et par où l’on retire les cendres quand il
y en a trop. Le laboratoire est rond. Le
fond qui le sépare du foyer est de pierre
de peperino. 11 est couvert d’un dôme de
terre cuite composé de plusieurs pièces
bien lutées ensemble. Au haut de la voûte
M