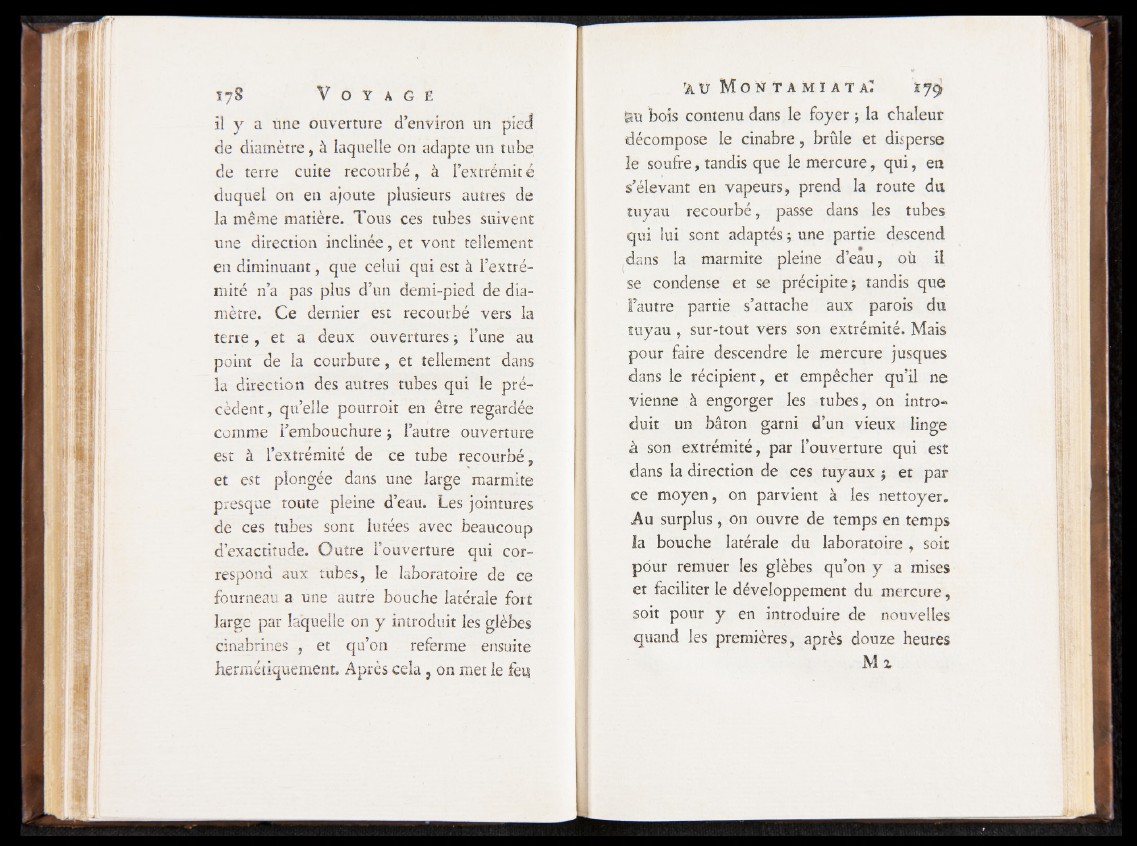
il y a une ouverture d’environ un pied
de diamètre, à laquelle on adapte un tube
de terre cuite recourbé, à fextrëmit é
duquel on en ajoute plusieurs autres de
la même matière. Tous ces tubes suivent
une direction inclinée, et vont tellement
en diminuant, que celui qui est à l’extrémité
n’a pas plus d’un demi-pied de diamètre.
Ce dernier est recourbé vers la
terre , et a deux ouvertures ; l’une au
point de la courbure, et tellement dans
la direction des autres tubes qui le précèdent,
qu’elle pourroit en être regardée
comme l’embouchure j l’autre ouverture
est à l’extrémité de ce tube recourbé,
et est plongée dans une large marmite
presque toute pleine d’eau. Les jointures
de ces tubes sont lutées avec beaucoup
d’exactitude. Outre l’ouverture qui correspond
aux tubes, le laboratoire de ce
fourneau a une autre bouche latérale fort
large par laquelle on y introduit les glèbes
cinabrines , et qu’on referme ensuite
hermétiquement. Après cela , on met le feu
rÀÜ Mo t t TAMÏATA? I79
&u bois contenu dans le foyer ; la chaleur
décompose le cinabre, brûle et disperse
le soufre, tandis que le mercure, q u i, en
s’élevant en vapeurs, prend la route du
tuyau recourbé, passe dans les tubes
qui lui sont adaptés ; une partie descend
dans la marmite pleine d’eau, où il
se condense et se précipite -, tandis que
l’autre partie s’attache aux parois du
tuyau , sur-tout vers son extrémité. Mais
pour faire descendre le mercure jusques
dans le récipient, et empêcher qu’il ne
vienne à engorger les tubes, on introduit
un bâton garni d’un vieux linge
à son extrémité, par l’ouverture qui est
dans la direction de ces tuyaux ; et par
ce moyen, on parvient à les nettoyer.
Au surplus, on ouvre de temps en temps
îa bouche latérale du laboratoire , soit
pour remuer les glèbes qu’on y a mises
et faciliter le développement du mercure,
soit pour y en introduire de nouvelles
quand les premières, après douze heures
M %