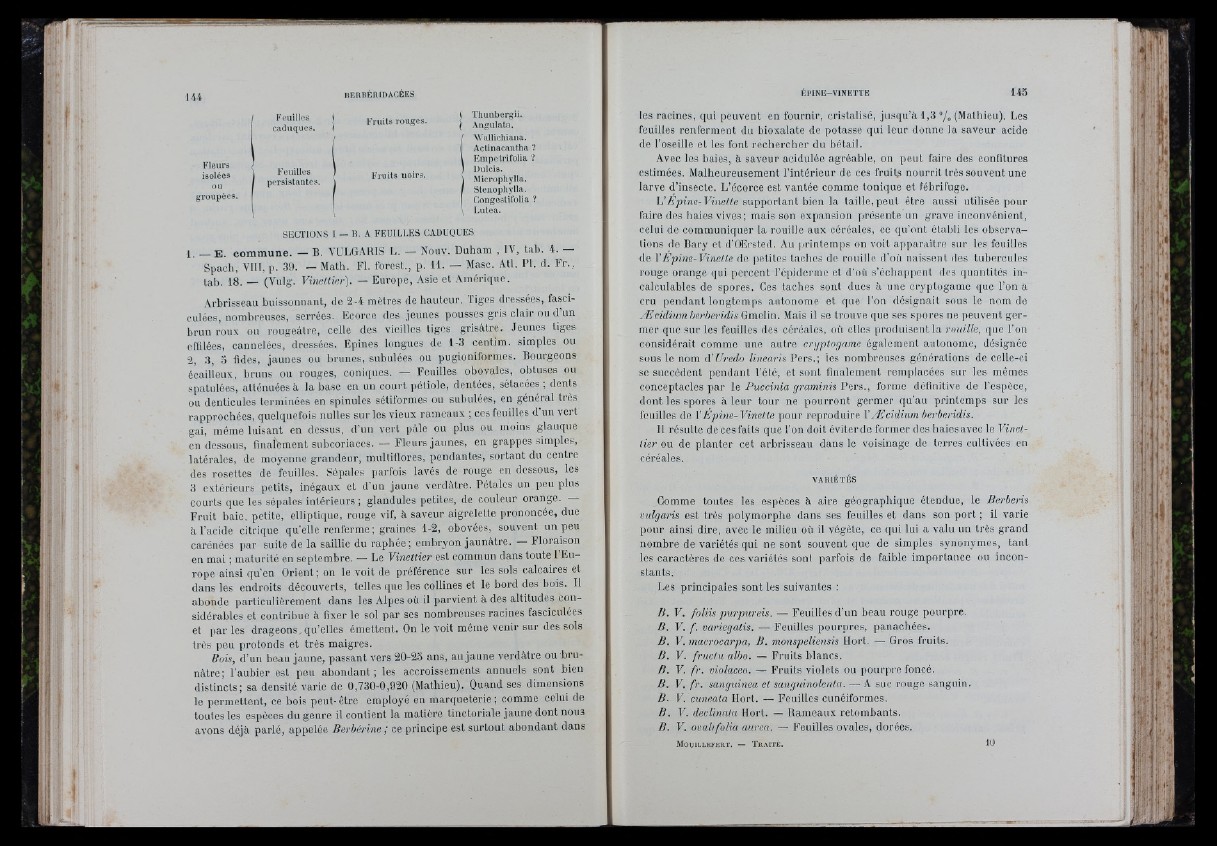
Fleurs
isolées
011
^n-oupécs.
Fi'uillcs \
caduques. Ì
Feuilles
persistantes.
F ru ils rouges.
F ru its uoirs.
Thunbergii.
Angulata.
\ \ ’allichiana.
Actinacautha ?
Kttipctrifolia ?
Dulcis.
•Microphylla.
Steiiophylla.
(àoügestifolia ?
Lutea.
SECTIONS 1 — li. A FEUILLES CADUQUES
1. — E . c om m u n e . — B. VULGARIS L. — Nouv. üuhcam , IV, tab. 4. —
Spach, Vni, p. 39. — Math. Fl. forest., p. 11. — Mase. Atl. Pl. d. Fr.,
lab. 18. — (Vulg. Vinettier). — Europe, Asie et Amérique.
Arbrisseau buissonuant, de 2-4 mètres de hauteur. Tiges drossées, fasci-
culées, nombreuses, serrées. Ecorce des jeunes pousses gris clair ou d ’un
brun roux ou rougeâtre, celle des vieilles tiges gr isâtre. Jeunes liges
cflilées, cannelées, dressées. Epines longues de 1-3 cenlim. simples ou
2, 3, 3 fides, jaunes ou brunes, subulées ou pugioniformes. Bourgeons
écailleux, bruns ou rouges, coniques. — Feuilles obovales, obtuses ou
spatnlées, atténuées à la base en un cour t pétiole, dentées, sétacées ; dents
on denliculos terminées en spinules sétiformes ou subulées, en général très
rapprochées, quelquefois nulles sur los vieux rame aux ; ces fouilles d'un ver t
gai, même luisant en dessus, d ’un vert pâle ou plus ou moins glauque
en dessous, finarement subcoriaccs. — Fleurs jaunes , en grappes simples,
latérales, de moyenne grandeur , muRillores, pendantes , sor tant du centre
des rosettes de feuilles. Sépales parfois lavés de rouge en dessous, les
3 extérieurs pclils, inégaux et d'un jaune verdâtre. Pétales un peu plus
courts que les sépales intérieurs ; glandules petites, de couleur orange. —
Fruit baie, petite, elliptique, rouge vif, à saveur aigrelette prononcée, due
à l'acide citrique q u e l le renferme; graines 1 -2 , obovées, souvent un peu
carénées pa r suite de la saillie du rap h é e ; embryon jaunât re. — Floraison
en mai ; matur ité en septembre. — Le Vinettier est commun dans toute I Europe
ainsi qu'en Orient; on le voit de préférence sur les sols calcaires et
dans les endroits découverts, telles que les collines et le bord des bois. Il
abonde par ticulièrement dans l e s A l p e s o ù il parvient à des altitudes considérables
el contribue à fixer lo sol pa r ses nombreuses racines fascieulées
et pa r les drageons , qu’elles émettent. On le voit même venir sur des sols
très peu protonds et très maigres.
Bois, d ’un beau jaune, pas sant vers 20-23 ans, au jau ne verdâtre ou b ru nâtre;
l'aubier est peu a b o n d a n t ; les accroissements annuels sont bien
distincts; sa densité varie de 0,730-0,920 (Mathieu). Quand ses dimensions
le permettent, ce bois peut-être employé en marqu e te r ie ; comme celui de
toutes les espèces du genre il contient la matière tinctoriale jaune dont nous
avons déjà parlé, appelée Berbérine ; ce pr incipe est sur tout abo nd ant dans
143
les racines, qni peuvent on fournir, cristalisé, jusqu ’à 1,3 ”/„ (Mathieu). Les
feuilles renferment du bioxalatc do potasse ([ui leur donne la saveur acide
de l’oseille et les font r e che rche r du bétail.
Avec les baies, à saveur acidulée agréable, on peut faire des confitures
estimées. Malheureusement l’intér ieur de ces fruits nour rit très souvent une
la rve d ’insecte. L’écorce est vantée comme tonique el fébrifuge.
V F p in e -V in e ite suppor tant bien la taille, peul être aussi utilisée pour
faire des liaies vives; mais son expansion présente nn grave inconvénient,
celui do communiquer la rouille aux céréales, ce qu’ont établi les obsorva-
Uons (le Bary et d'OErsted. Au printemps on voit apparailre sur les feuilles
de V /ip in e -V in e lte do petites taches de rouille d’oii naissent des tubercules
rouge orange qui percent rép id e rme et d'où s’écbapiicnt des quantités incalculables
de spores. Ces taches sont dues à uue cryptogame ([ue l ’on a
cru pendant longtemps autonome et que l’on désignait sons le nom do
.îic id ium hcrberidis Gmelin. Mais il se trouve que ses spores ne peuvent g e r mer
que sur les feuilles des céréales, où elles produisent la rouille, que l’on
considérait comme une antre cryptogame également autonome, désignée
sous le nom d'Uredo linearis Pers.; los nombreuses générations de celle-ci
se succèdent pendant l’été, et sont finalement remplacées sur les mêmes
conceptacles p a r le Puccinia graminis Pers., forme définitive de l’espèce,
dont les spores à leur tour ne pour ron t germer q u ’au printemps sur les
feuilles de VK p in e -V in e tte pour reproduire l’/Iic id ium hcrberidis.
Il résulte deces faits que l’on doit éviterdo former des baiesavec le Vinel-
tier ou de planter cet arbrisseau dans le voisinage de terres cultivées en
céréales.
Gomme toutes les espèces à aire géographique étendue, le Berberis
vulgaris est très polymo rp he dans ses feuilles et dans son por t ; il varie
pour ainsi dire, avec le milieu où il végète, ce qui lui a valu un très grand
nombre de variétés qui ne sont souvent que de simples synonymes, tant
les caractères do ces variélés sont parfois de faible importanc e ou inconstants.
Les principales sont les suivantes :
B . V. foliis p u rp u re is. — Feuilles d'un beau rouge pourpre.
B . V. f . variegatis. — Feuilles pourpres , panachées.
B . V. macrocarpa, B. monspeliensis Hort. — Gros fruits.
B . y. fru c ln albo. — Fruits blancs.
B . V. fr . violaceo. — Fruits violets ou pourpre foncé.
B . V. fr . sanguinea et sanguinolenta. — A suc rouge sanguin,
B. V. cuneata Hort. — Fouilles cunéiformes.
B . V. declinala Horl. — Rameaux retombants.
B . V. ovahfolia aurea. — Feuilles ovales, dorées.
M o C1LLK1.'F.RT. — T r . \ it k . 1 0
II
Cl
l l
!♦ •
r
I J
' i l
!
L •!
î-i, I ' 1
t '
'ri ^ .
''l 'J
;i ■
?
!'■' '•'J
1 "
ï ï ' A
l i , : . i "7'
i C k :