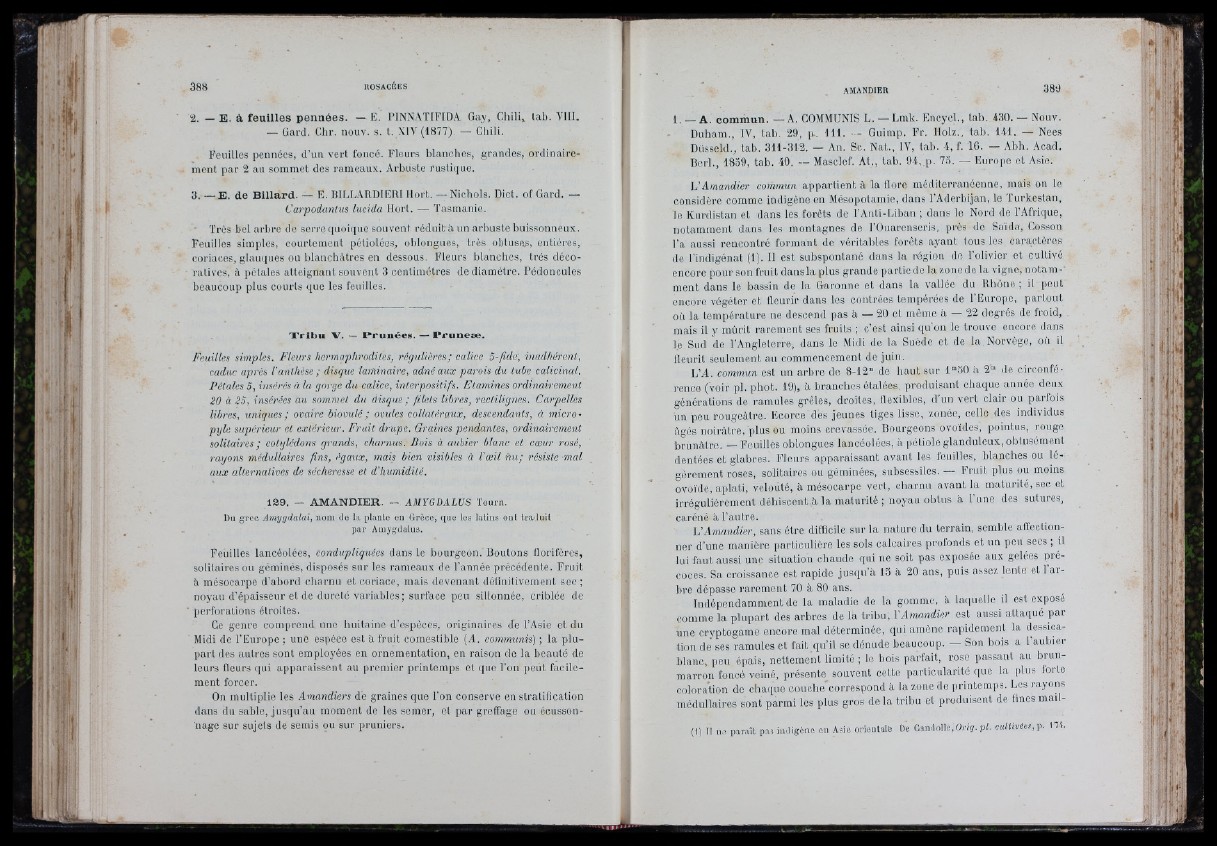
,, {
i '•
I ' 1
(
r ré
/
U:
2. — E . à f e u i l l e s p e u n é e s . — E. ITNNATIFIDA Gay, Chili, lab, YHI.
— Gard. Cbr. nouv. s. t. .\1V (1877). — Chili.
Feuilles pennées, d ’un ver t foncé. Fleurs blanches, grandes, ordinairement
p a r 2 au sommet des rameaux. Arbuste rustbiue.
3. — E . d e B i l l a r d .— E. BILLARUIEHI l l o r t .— Nichols. Diet, of Gard, —
Carpodantus lucida llort. — Tasmanie.
Très bel arhro de seri'e quoique souvent réduit à un arbuste buissonneux.
Feuilles simples, cour tement pétiolées, oblongues, très obtusp-s, entières,
coriaees, glauques ou blancliâtres en dessous. Fleurs blanches, très décoratives,
à pclales atteignant souvent 3 centimètres de diamètre. Pédoncules
beaucoup plus courts que les feuilles.
Xribu V. - I^runécs. — I*runea;.
Feuilles simples. Fleurs liermaphrodites, régulières; calice 5-ßde, iiiadhcrent,
caduc après I'anthèse ; disque laminaire, adné au x parois du tube caiicinal.
Pétales 5, insérés à la gorge du calice, inlerpositifs. Elamines ordinairement
20 il 25, insérées au sommet du disque ; filets libres, rectilignes. Carpelles
lihres, uniques; ovaire biovulé; ovules collatéraux, descendants, à micro-
p y le supérieur et extérieur. F ru it drupe. Graines pendanles, ordinairement
solitaires; cotylédons grands, charnus. Bois à aubier blanc ct coeur rosé,
rayons médullaires fins, égaux, mais bien visibles à l'oe il h u ; résiste mal
aux alternatives de sécheresse et d ’humidité.
1 2 9 . — A M A N D I E R . - AMYGD.iLVS Tourn.
Du grec Amyydalai, nom de la plante en Grèce, que les latins ont traduit
par Amygdalus.
Feuilles lancéolées, condupliqitées dans lo bourgeon. Boutons üorifèros,
solitaires ou géminés, disposés sur los rameaux de l ’année précédente. Fruit
à mésocarpe d’abord cbarnu ot coriace, mais devenant déliiiitivemont sec ;
noyau d'épaisseur el de dureté variables; surface pou sillonnée, criblée de
perforations étroites.
Cc genre comprend une huitaine d'espèces, originaires de l ’Asio el du
Midi de l’Europe ; uné espèce est à fruit comestible {A. communis) ; la p lu par
t des autres sont employées en ornementation, en raison do la beauté do
leurs (leurs (lui apparais sent au premier pr intemps et (pie l’on peut facilement
forcer.
On multiplie les Amandiers do graines que l'on conserve en slralificalion
dans du sable, ju squ’au moment de les semer, cl par greffage ou écussonnage
sur sujets de semis ou sur pruniers.
1. — A. c om m u n . — A. COMMUNIS L. — Emk. Encycl., tab, 430. — Nouv.
Dubam,, lY', tab. 29, p. 111. ■ - Guimp. Fr. Ilolz., tab. 141. — Nees
Düssobl., tab. 311-312. — An. Sc. Nat., 1\', tab. 4, f. 10. — Abb. Acad.
Bcrl., 1839, tab. 40. — Masclef. At., lab. 94, p. 73. — Europe ot Asie.
V Amandier commun appa r t ien t â la lloro médiler ranéenne, mais on le
considère comme indigène en Mésopotamie, dans l ’Aderltijan, lo Turkestan,
le Kurdistan et dans los forêts de l’Anti-Uban ; dans le Nord de l'Afri(iuo,
no tamment dans les montagnes de TOuarenseris, près do Suida, Cosson
Ta aussi rencontré formant de véritables forets ayant tous los caractères
de l’indigénat (1). 11 ost subsponlané dans la région de l'olivier et cultivé
encore pour son fruit dans la plus grande partie do la zono do la vigne, n o t am ment
dans le bassin de la Garonne et dans la vallée du Rhone ; il peut
encore végéter ot lleurir dans los contrées tempérées de l’Europe, pa r to ut
où la température no descend pas à — 20 et même à — 22 degrés do Iroid,
mais il y mûrit ra rement scs fruils ; c’est ainsi qu on le trouve encore dans
lo Sud de l’Augletorre, dans le Midi de la Suède cl de la Norvège, où il
llourit seulement au commencement (le juin.
L’A. commun est nn a rbre do 8-12” do h a u t sur 4“ 30 a 2" do circonfé-
renco (voir pl. pliot. 19), à branches étalées, produisant chaque année doux
générations de ramules grêles, droites, llexibles, d'un vert clair ou parfois
un peu rougeâtre. Ecorce des jeunes liges lisse, zonée, celle des individus
âgés noirâtre, plus ou moins crevassée. Bourgeons ovo'ides, pointus, rouge
brunâtre. — Feuilles oblongues lancéolées, ù pétiole glanduleux, oblusémont
dentées et glabres. Fleur s apparaissant avant les fouilles, blanches ou lé gèrement
roses, solitaires ou géminées, subsessiles. — Fruit plus ou moins
ovoïde, aplati, velouté, à mésocarpe vert, charnu avant la maturité, soc et
ir régulièrement déhiscent à l a ma tu r ité ; noyau obtus â l'une des sutures,
caréné à Tautro.
L ’Amandier, sans être diracile sur la nature du terrain, semble affectionner
d ’une manière particulière les sols calcaires profonds et un peu secs ; ü
lui faut aussi une situation chaude qui ne soit pas exposée aux gelées précoces.
Sa croissance est rapide ju sq u ’à 13 à 20 ans, puis assez lente et 1 a r bre
dépasse r a remen t 70 à 80 ans.
Indépendamment de la maladie de la gomme, à la(|uello il esl exposé
comme la plu pa r t des arbres de la tribu, Y Amandier est aussi attaqué pat-
une cryptogame encore mal déterminée, qui amène rapidemenl la dessication
do ses ramules et fait qu’il se dénude beaucoup. — Son bois a l’aubier
blanc, peu épais, nettement limité ; le bois parfait, rose pas sant au brun-
mar ron foncé veiné, présente souvent celte particularité (|ue la plus forlo
coloration de chatiue couche correspond à la zone de pr intemps . Les rayons
médullaires sont parmi los plus gros de la tribu et produisent do linos mail-
(I) TI 1 1 ,' p a ra ît pa-, iii-ligèiio cu Asie o rientale Ile CanJolIe,OWy. pl. cultivées, p. 174.
‘ l i J
: dii
' V ' I
- !