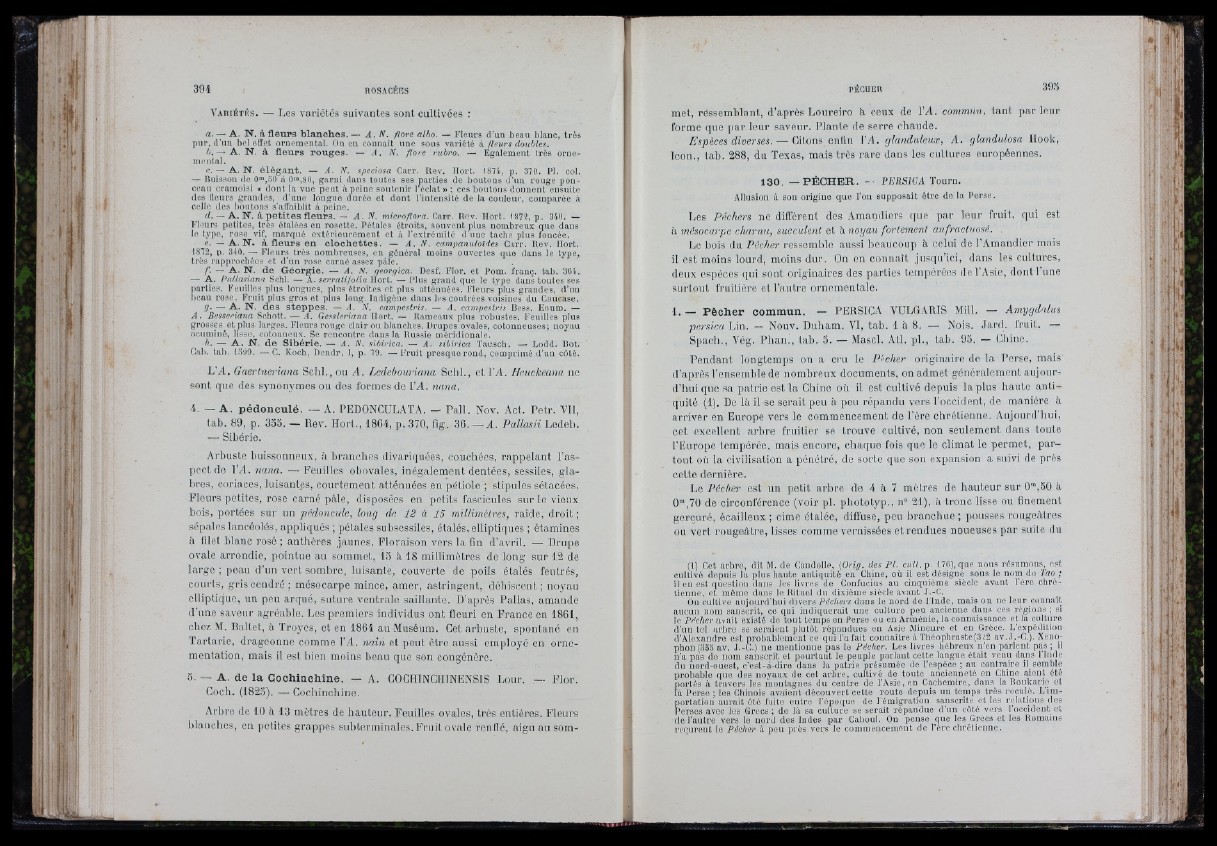
Y 'a r i é t é s . — Les variétés suivantes sont cultivées :
a. — A . N . à f l e u r s b l a n c h e s . — A . N. flore albo. — Fleurs d 'u n b eau blanc, trè s
p u r. d 'n n bel efïet o rn em en tal. On eu connaît u n e sons v ariété à fleurs doubles.
/). — A . N . à f l e u r s r o u g e s . — .1. N. flore rubro. — Egalement Irés o rn e men
tal.
c. — A . N . é l é g a n t . — A. N. speciosa Carr. liev. llo rt. iS74, p. 370. Pl. col.
— linisson lie Ore.ëO à 0“ ,80, g a rn i dans toutes ses parties do lioutous d 'u u rouge p o n ceau
cramoisi « d o n t la vue p eu t à peiue so u ten ir l’éclat » ; ces lioutons d o n n en t ensuite
des tleurs grandes, d ’nno longue d u ré e e t d o n t l'in tcu sité de la couleur, comparée à
celle des boutons s’atl'aiblit à peine.
<C — A .N . à p e t i t e s f l e u r s . — A . N. miernflora. Carr. Rev. Ilo rt. 187!, p . 340. —
Fleurs p elite s, trè s étalées en ro se tte . Pétales étro its, souvent plus nombreux q u e dans
le type, rose vif, m a rq u é e x té rie u rem e n t et à re x tré in ilc d ’nue tache pins foncée.
e. — A . N . à f l e u r s e n c l o c h e t t e s . — A. N. campanuloïdes Garr. Rev. Ilort.
1872, p. 340. — F ien rs trè s nombreuses, eu géné ra l moins o u v e rte s que d ans le type,
trè s rapproché es et d 'u u rose carné assez pàle,
f. — A . N . d e G é o r g ie . — .-t. IV. geórgica. Desf. Flor. et Pom. franc. lab . 364.
— A . Patla.siana Schl. — A. serratifolia llo rt. — Plus gran d que le type dans to n tes ses
p arties. Fenilles pins longues, plus étro ite s ct plus altén u ée s. F leu rs 'p lu s g ran d e s , d ’nn
beau ro se. F ru it pins gros et plus long. Indigène dan s les co c trécs voisines dn Caucase.
g. —■ A . N . d e s s t e p p e s . — A. N. campeslris. — A. cmnpeslris Ross. Enum. —
A . Besseriana Sclintt. — .l. Gessteriana llo rt. — Rameaux plus ro b u ste s. Feuilles plus
g ro sse s et plus la rg es. Fleurs rouge clair ou blanches. Drupes ovales, co to n n eu ses; noyau
acuminé, lisse, cotonneux. Se ren co u ire daus la Russie mérid io n a le.
b. — A . N . d e S ib é r i e . — A. N. sibirica. — A. sibirica Tar.sch. — Lodd. Rot.
Call. tall, l.’iàfl. — C. Koch, Doiidr. I, p. 79. — F ru it p re sq u e ro iid , comprimé d 'u n côté.
L’A. G a e r tn e r ia n a ScliL, ou A. L e d e h o u r ia n a Schi., ct l ’A. ¡ie.ucke.ana ne
sont que des synonymes ou dos formes de l ’A. n a n a .
4. — A . p é d o n c u l é . — A. PEDONCULATA. — Pall. Nov. Act. Petr. Y’II,
tab. S9, p. 3oo. — Rev. Hort., 18G4, p. 370, fig. 30. — A. Pallasix Ledeb.
— Sibérie.
Arbuste buissonneux, à branclies divariquées, couchées, rap p e lan t l’aspect
de l ’.-l. nana. — Feuilles obovales, inégalement dentées, sessiles, gla-
lires, coriaces, luisantes, conr tement alténuées en péliole ; stipules sétacées.
Fleurs petites, rose carné pàle, disposées en petits fascicules sur le vieux
bois, portées sur un pédoncule, long de 12 à 15 millimètres, raide, d ro i t;
sépales lancéolés, appliqués ; pétales subsessiles, élalés, elliptiques ; étamines
à filet blanc rosé ; anthères jaunes. Floraison vers la fm d ’avril. — Drupe
ovale ar rondie, pointue au sommet, 1,3 à 18 millimètres de long sur 12 de
la rge ; peau d ’im vert sombre, luisante, couverte de poils élalés feutrés,
courts, gris c en d r é ; mésocarpe mince, amer, astringent, déliisccnt ; noyau
elliptique, un peu arqué, suture ventrale saillante. D'après Pallas, amande
d'une saveur agréable. Les premiers individus ont fleuri en France en 1861,
chez M. Ballet, à Troyes, et en 1864 au Muséum. Cet arbuste, spontané en
Tartar ie, drageonne comme l'A. nain et peut être aussi employé on ornementation,
mais il est liien moins beau que son congénère.
g. — A. d e l a G o c h i a c h i n e . — A. COCHINCHINENSIS Lour. — Flor.
Coch. (1823). — Coclunchine.
Arbre de 10 à 13 mètres do liauteur. Feuilles ovales, très entières. Pleurs
lilanclies, en petites grappes snbterminales. Fruit ov.ale renflé, aigu au sommet,
ressemblant, d ’après Loureiro à ceux de l ’A. commun, tan t par leur
forme que pa r leur saveur. Plante de serre chaude.
Espèces diverses. — Citons enfin l’A. glanduleux, A . glandulosa Hook,
Icon., tab. 288, du Texas, m.ais très raro dans les cultures européennes.
, CI
Si "Il
1 3 0 . — P Ê C H E R . - • PERS ICA T o u r n .
Allusion à son origine q u e l’on su pposa it ôire do la P e rse .
Les Pêchers ne différent dos .Ymandiors que p.ar leur fruit, qui est
à mésocarpe charnu, succulent et à noyau fortement anfractuosé.
Le bois du Pêcher ressemble aussi bo.auconp à celui do l’Amandier mais
il est moins lourd, moins dur . On en connaît jusqu’ici, dans les cultures,
deux espèces qui sont origin,aires des parlies temperóos do l ’.Vsie, dont l'une
sur tout fruitière ot l’autre ornementale.
1. — P ê c h e r c om m u n . - PERSICA VULGARIS Mill. — Amygdalus
persica Lin. — Nouv. Duliam. VI, tab. I à 8. — Nois. Ja rd. fruit. —
Spach., Vég. Plian., tab. 5. — Mascl. AU. pl., lab. 9,3. — Chine.
Pendant longtemps on a cru le Pécher originaire de la Perse, mais
d'après l ’ensemble de nombreux documents, on admet généralement aujour d
’hui que sa patrie est la Chine où il est cultivé depuis la plus liante antiquité
(1). De là il se serait peu à peu répandu vers l’occident, do manière à
arriver en Europe vers le commencement do f è r e chrétienne. Aujourd'liui,
cet excellent arbre fruitier se trouve cultivé, non seulement dans toute
l’Europe tempérée, mais encore, chaque fois que le climat le permet, par tout
où la civilisation a pénétré, de sorte que son expansion a suivi de près
celte dernière.
Le Pêcher est un petit a rbre de 4 à 7 mètres de h auteur sur 0"',50 à
0“ ,70 de circonférence (voir pl. pliototyp., n” 21), à tronc lisse ou finement
gerçuré, écailleux; cime étalée, diffuse, peu bran cb u e ; pousses rougeâtres
ou vert rougeâtre, lisses comme vernissées ot rendues noueuses p.ar suite du
- i !
i1
(1) Cet a rb re , d it M. de Candolle, [Ong. des P L cw/Lp, 170), que nous résumons, est
cultivé depuis la plus h au te aiiLiquité en Chine, o-ù il e st désigné sous le nom de Tao ;
il en est question dans les livres de Confucius au cinquième siècle avant l’ère c h ré tien
n e , c t même daus le Rituel du dixième siècle avant J.-C.
Ou cultive au jo u rd 'h u i divers Pêchers dan s le no rd de l'Inde, mais o n ne le u r connaît
aucun nom sanscrit, ce qui in d iq u e ra it une cu ltu re peu ancienne d ans ces rég io n s ; si
le Pêcher ava it existé de to u t temps en Perse ou en Arménie, la connaissance e t la culture
d ’un te l a rb re se s e ra ien t plutôt rép an d u e s en Asie iMincure et en Grèce. L’expédition
d ’Alexandre est p ro b ab lem en t cc q ii il’a f a i t conna ître à Théophraste(3i'2 av .J.-C.). Xeno-
phon (355 av. J.-C.) n e men tio n n e pas le Pêcher. Les livres héb reu x iCeii p a rlen t pas ; il
n 'a pas de nom s an s c rit ct p o u rta n t le peu p le p arlan t c e tte langue é ta it venu dans rindo
d u iiord-ouest, c ’e s t-à -d ire dans la p a trie p résumé e île l’espèce ; au contraire il_semble
pro b ab le que des n o y au x de ce t a rb re , cultivé de to u te an c ien n eté en Chine a ien t été
portés à tra v e rs les montagnes d u cen tre de l’Asie, en Cachemire, dans la Boukarie et
fa Pe rse ; les Chinois ava ient d éco u v e rt c e tte ro u te d epuis un temps trè s reculé. L’im p
o rta tio n au ra it ôté faite en tre l’époque de l'émigratioii sanscrite et les re la tio n s des
Perses avec les Grecs ; de là sa culture se s erait rép an d u e d ’uu côté vers l’occident ct
de l’a u tre v ers le n o rd des Indes p a r Calioul. On pense q u e les Grecs et les Romains
re çu re n t le Pêcher à peu p rès vers 1e commencement de l’èrc ch ré tien n e .
' ë f
I li
G