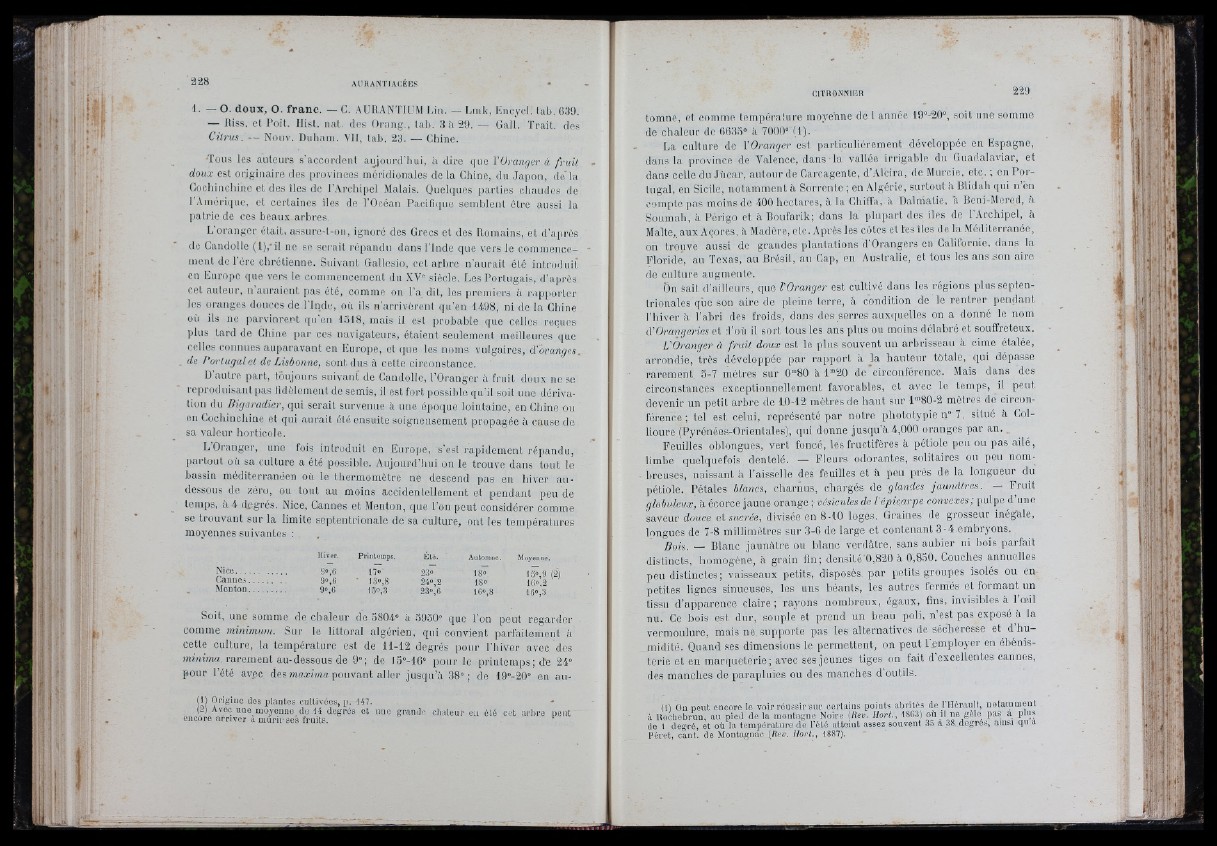
f
i l '
1. — O. d o u x . O. f r a n c . — C. .\UU.\NTU'.M Lin. — Liiik, Eiioycl. lab. (i3i).
— liiss. ol Poil. Ilisl. nal, dos Oraiig., lab. 3 à 21). — GalÎ. Trait, dos
Citrus. - - Nouv. Duham. VII, tali. 23. — C.luno.
•Tous les auteurs s'accordent aujourd'hui, à dire (|ue l ’Oranger à fru il
doux ost origiuairo des [irovinces méridionales do la Chine, du .lapon, de la
Cocliiiichinc et des iies do r.Vrchipel Malais. Queliiucs [larlies chaudes de
l',\méri(iue, cl certaines ilos de TOcéau Pacifiiiue semlileiil être aussi la
patrio do ccîî beaux arbres.
Lorani ic r était, assure-t-on, ignoré des Grecs ot des Romains, et d ’aprés
de Caudollo ( t),‘ il ne sc serait répandu dans l'indo que vers Je eommcn c r -
mcnl do l'èro chrétienne. Suivant Gallcsio, cet arbre n'anrnil élé introduil
en Euroiic ipie vers le commencement du \Y " siècle. Les l’orlugais, d'après
cet aulour, n'auraient [)as été, comme on l'a dit, les premiers à rapporlor
les oranges douces de l ’Inde, où ils n'ar rivèrent q u ’en 1498, ni de la Chine
oil ils ne parvinrent q u ’en 1318, mais il csl [irobahle ipie celles reçues
plus lard de Chine [lar ces navigateurs, étaient seulement meilleures (pie
celles connues auparavaiil eu Europe, ot ([ue les noms vulgaires, d'orunges.
de Portugal et de Lisbonne, sont dus à cette circonstance.
D aulro part, toujours suivani de Caiidolle, l'O ranger à fruit doux no so
i'e[)rodui.sant ¡las lldèlemenl de semis, il esl fort [lossililc q u ’il soit une dériva-
Uon du Bigaradier, qui serait survenue à une épo([ue lointaine, eu Chine ou
011 Cüchinciiine et qni aurait été ensuite soigneusement propagée à cause do
sa valeur horticole.
L Oranger, ime fois introduit en Europe, s'esl rapidement répandu,
liai'lout où sa culture a été possible. .Aujourd’hui on le trouve daus tout lo
bassin méditer ranéen où le Ihermomètrc ne descend pas en liiver au-
dessous do zéro, ou tout au moins accidentellement et pen dan t peu do
temps, a 4 degrés. Nice, Cannes ot Menton, que l ’on peut considérer comme
sc trouvant sur la limite septentrionale de sa culture, ont les tempéralures
moyennes suivantes :
-Nice..................
Canucô...........
McDtOD_____
«0,6
90.6
90.6
Priiit'juips. Étô. Automne. Moyenne.
170 23° 180 ISO,9 1
• 130,8 2-io,2 180 160,2
1o<>,3 230,6 160,8 160,3
Soit, une somme de chaleur de 3804“ à 3950“ que l'on peut regarder
comme minimum. Sur lo littoral algérien, qui convient parfaitement à
cette culture, la température est de 11-12 degrés pour r iiiver avec des
minima rarement au-dessous de 9“ ; do I3°-1G' pour le pr intemps ; cle 24“
pour l’été avec des mrcrimcr, pouvant aller ju sq u ’à 38“ ; do 19“-20“ en a u lì)
Origiue dos plantes cultivées, p. UT.
(2) Avec une moyenne de U degrés ot une grande elialeur eu été cet .arbre p eu t
encore a rriv e r a m û rir ses fruits.
C I T R O N N I E R 229
tomne, ot comme température moyenne de l année 19"-20", soit une somme
do chaleur de (ilTÎ,')“ à 7000“ (1).
Ea culture do l'Oranger est par ticulièrement développée en Espagne,
dans la province de Valence, dans la vallée irrigable du Guadalaviar, et
dans celle du Jùcar, autour de Carcagente, d’.Mcira, de Miircie, etc. ; en Portugal,
en Sicile, notammenl à Sorrento ; en .Algérie, surtout à Blidali cpii ii’én
compte pas moins do 400 hectares, à la Chiffa, a Dalmalie, a Bcni-.Mered, a
Soumah, à l’érigo ct à Boufarik; dans la plujiart des îles de l'Archiiiel, ii
Malte,^aux Açores, à Madère, etc. Après les ciMcs el les îles de la Méditerranée,
on trouve aussi de grandes plantations d ’Orangers en Californie, dans la
Floride, au Texas, au Brésil, au Cap, en Australie, ct tous los ans son aire
do cnltiire augmente.
Ôn sait d ’ailleurs, que l'Oranger est cultivé dans les régions pins septentrionales
([iie son aire de pleine terre, à condition do le r ent re r pondant
l’hiver à l ’abri des froids, dans des serres aux([uclles on a donné le nom
d ’Orangeries et d’où il sort lous les ans plus ou moins délabré et souffreteux.
L'àranger à fr u it doux est le plus souvent un arbris seau à cime étalée,
arrondie, très développée par rap po r t à la hauteur tùtale, qui dépasse
ra remen t 3-7 métros sur 0”80 à 1“ 20 do circonférence. Mais dans des
circonstances exceptionnellement favorables, et avec le temps, il peut
devenir un petit arbre de 10-12 mètres de h a u t sur l “80-2 mètres de circonférence
; tel est celui, représenté p a r notre phototypie n“ 7, situé à Col-
lioure (Pyrénées-Orienlales), qui donne jusqu'à 4,000 oranges par an. .
Feuilles oblongues, ver l foncé, les fructifères à pétiole pou ou pas ailé,
limbe quelquefois dentelé. — Fleurs odorantes, solitaires on peu n om breuses,
naissant à l’aisselle des feuilles el à peu près de la longueur du
pétiole. Pétales blancs, charnus, chargés de glandes ja u n â tre s . — Fruil
globuleux, à écorce jaune orange ; vésicules de l'épicarpe convexes; pulpe d une
saveur douce cl sucrée, divisée en 8-10 loges. Graines de grosseur inégale,
longues de 7-8 millimètres sur 3-C de large ct contenant 3-4 embryons.
Pois, _ Blanc jau nâ t re ou hlanc verdâtre, sans aubier ni bois parfait
dislincts, homogène, â grain fin; densité 0,820 à 0,830. Couches annuelles
peu distinctes; vaisseaux petits, disposés p a r petits groupes isolés ou en
petites lignes sinueuses, les uns béants, les autres fermés et formant un
tissu d ’apparence claire; rayons nombreux, égaux, fins, invisibles à 1 oeil
nu. Ge bois est dur, souple et prend un beau poli, n ’est pas exposé à la
vermoulure, mais ne supporte pas les alternatives de sécheresse et d h u midité.
Quand ses dimensions le permettent, on peut 1 employer en ébénis-
tcrie et en marqueter ie; avec ses jeunes tiges on fait d’excellentes cannes,
dos manches de parapluies ou des manches d’outils.
(l) Ou p eu t encore le vo ir réu ssir s u r c e rtain s points ab rité s de i’Hérault, uotarruneiit
à liochebruD, au pied de ta montagne Noire (liev. Hort., 18G3) où il ne gèle pas a pins
do 1 d eg ré , et où la tem p é ra tu re de l'été a ttein t assez souvent 33 à 38 deg rés, ainsi qn a
Péret, cant, de Montagnac (Itev. Hort.. 1887).
U