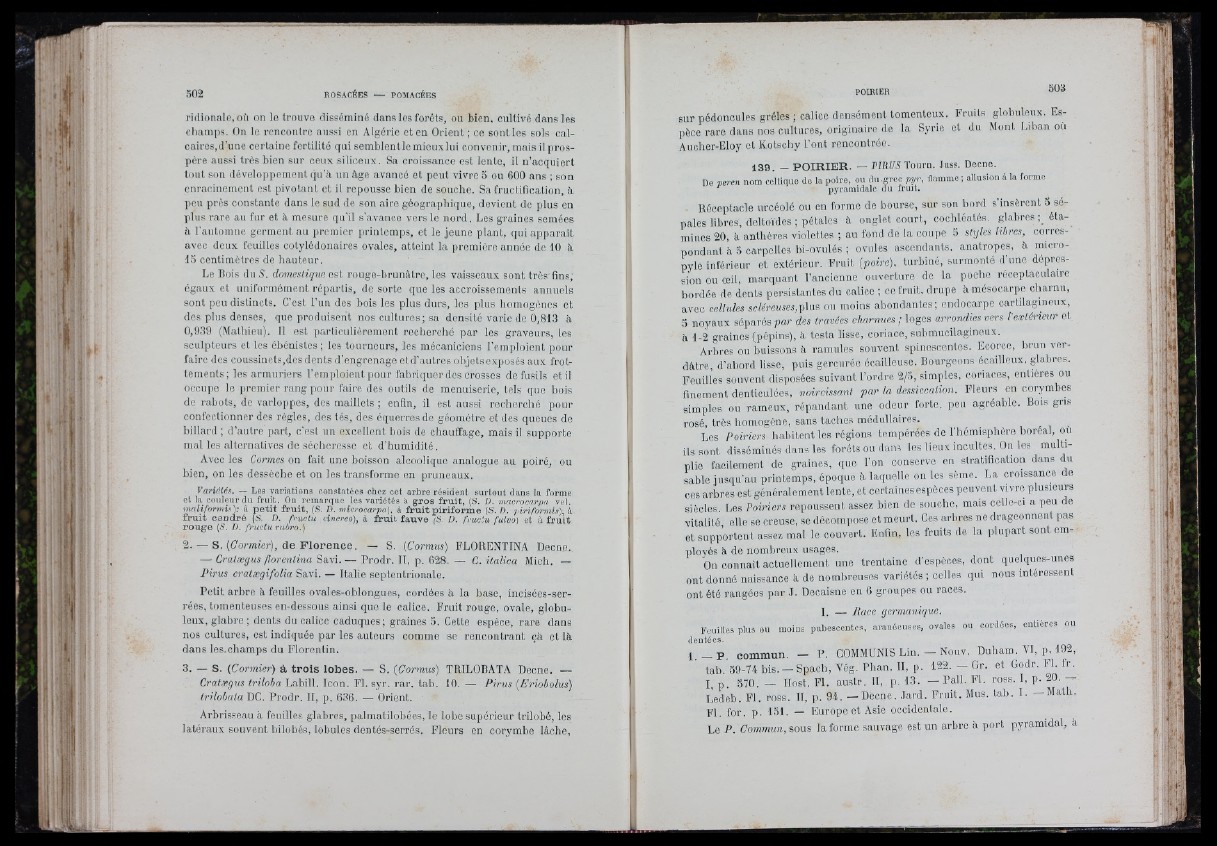
ï 1 li
i
J
IU
N 'i ■ '
ridionalc, où on le trouve disséminé dans les forêts, ou bien, cultive dans les
champs. On lo renoonlre aussi en Algérie ct en Orient ; co sont los sols calcaires,
d'une certaine fertilité ([ui semblen tic mieux lui convenir, mais il prospère
aussi très bien sur ceux siliceux. Sa croissance est lento, il n’acquiert
tout son développement (pTà un âge avancé et peut vivre 3 ou GOO ans ; son
enracinement est pivotant et il repousse bien de souche. Sa fructification, à
peu près constante dans le sud do son aire géographique, devient do plus on
plus rare au fur et ù mesure qu’il s'avance vers lo nord. Les graines semées
à Tautomnc germent au premier printemps, et le jeune plant, qui apparaît
avec doux feuilles colylédonaires ovaics, atteint la première année do 10 à
15 cenlimèiros de liauteur.
Le Bois du .9. domestique est rouge-brunâtre, les vaisseaux sont très fins,
égaux ot uniformément répartis, de sorte que los accroissements annuels
sont peu distincts. C’est l'un dos bois les plus durs, los plus homogènes et
des plus denses, que produisent nos cultures; sa densité varie de 0,813 à
0,939 (Mathieu). Il est particulièrement reclierclié par les graveurs, les
sculpteurs et les ébénistes ; les tourneurs, les mécaniciens remploient pour
faire des coussinets,dos dents d'engrenage otd'autros objotsoxposés aux frottements
; los armuriers remploient pour fabriquer dos crosses do fusils et il
occupe le premier rang pour faire des outils de menuiserie, tels que bois
de rabots, de varloppos, dos maillets ; enfin, il est aussi recherché pour
confectionner des règles, des tés, des équerres do géomètre et des queues de
billard ; d’autre part, c’est un excellent bois de chauffage, mais il supporte
mal les altornalives de sécheresse et d’humidité.
Avec les Cormes on fait une boisson alcoolique analogue au poiré, ou
bien, on le s dessèche et on les transforme en pruneaux.
V a n i té s . — Les yarintions constatées chez cet arhre résident surtout dans la forme
Irt /Nrsulctii«-* l“*» 1« 1L /Y *-v« 1 — „ V _____ — l a. r cy r\ \
rouge (S. D. f r u c tu ru b ro .)
2. — s . (é/orater), d e Florence. — S. (Cormus) FLORENTINA Decnc.
— Cratægus fiorentina Savi. - Prodr. II, p. 628. — C. italica Mich. —
Pirus cralægifolia Savi. — Italie septentrionale.
Petit arbre â feuilles ovales-oblongues, cordées à la base, incisées-ser-
rées, tomenteuses en-dessous ainsi que le calice. Fruit rouge, ovale, globuleux,
glabre ; dents du calice caduques; graines 3. Cette espèce, rare dans
nos cultures, est indiquée par les auteurs comme se rencontrant çà et là
dans les. champs du Florentin.
3. — S. (Cormier) à trois lobes. — S. (Cormus) TRILOBATA Decne. —
Cratægus triloba Labill. Icon. Fl. syr. rar. tab. 10. — P iru s [Eriobolus)
Irilobata DC. Prodr. II, p. 636. — Orient.
Arbrisseau à fouilles glabres, palmatilobées, le lobe supérieur trilobé, les
latéraux souvent bilobés, lobules dentés-serrés. Fleurs en corymbe lâche.
sur pédoncules grêles ; calice densément tomenteux. Fruits globuleux. Espèce
rare dans nos cultures, originaire de la Syrie et du Mont Liban oii
Aucher-Eloy ct Kotscby l'ont ronoonlréo.
139. — P O I R I E R . — T IR U S Tourn. Juss. Oecne.
De peren nom celtique de la poire, ou du-grec p y r , flamme ; allusion à la forme
pyramidale du fruit.
Réceptacle urcéolé ou en forme de bourse, sur son bord s’insèrent 5 sép
a l e s libres, deltoïdes ; pétales â onglet court, cocbléatés. glabres ;_ élamines
20, à anthères violettes ; au fond do la coupe .3 styles libres, correspondant
à 5 carpelles bi-ovulés ; ovules ascendants, anatropes, à micro-
pyle inférieur ot extérieur. Fruit (poire), turbiné, surmonté (l’une dépression
ou oeil, marquant l ’ancienne ouverture do la poche réceptaculaire
bordée de dents persistantes du calice ; ce fruit, drupe à mésocarpe cbarnu,
avec cellules sc/êreiiS(;s,plus ou moins abondantes; endocarpe cartilagineux,
5 noyaux séparés par des travées charnues; loges arrondies vers l'extérieur ot
à 1 -2 graines (pépins), à tesla lisse, coriace, aubiniicilagineux.
Arbres ou baissons à ramules souvent spinescentes. Ecorce, brun verdâtre,
d'abord lisse, puis gercurée écailleuse. Bourgeons écailleux, glabres.
Fouilles souvent disposées suivani l’ordre 2/.3, simples, coriaces, entières ou
f in eme n t denticulées, noircissant p a r la dessiccation. Fleurs on corymbes
simples ou rameux, répandant une odeur forte, peu agréable. Bois gris
rosé, très homogène, sans taches médullaires.
Les Poiriers habitent les régions tempérées de l'Iicmisphère boréal, ou
Us sont disséminés dans les forêts ou dans les lieux incultes. On les multiplie
facilement de graines, que l’on conserve en stratification dans (lu
sable jusqu'au printemps, époque à laquelle on les sème. La croissance de
ces arbres est généralement lente, ct cerlaines espèces peuvent vivre plusieurs
siècles Les Poiriers repoussent assez bien de souche, mais celle-ci a peu de
vitalité, elle se creuse, se décompose et meurt. Ces arbres ne drageonnent pas
et supportent assez mal lo couvert. Enfin, los fruits de la plupart sont employés
à de nombreux usages.
b n c o n n a i t actuellement une trentaine d'espèces, dont quelques-unes
ont donné naissance à de nombreuses variétés ; celles qui nous intéressent
onl été rangées par .1. Decaisne en G groupes ou races.
]. — Pace germanique.
Feuilles plus ou moius pubescentes, aranécuscs, ovales ou cordées, cnlièrcs ou
dentées.
1 — p c om m u n . — P. COMMUNIS Lin. — Nouv. Duham. VI, p, 192,
’ tab. 39-74 b i s . - S p a c h , Vég. Pban. II, p. 122. - Gr. el Godr. Fl. fr.
I, p . 570. — Host. F l. austr. II, p. 13. — Pall. Fl. ross. L P- 20.
Ledeb. F l. ross. II, p. 94. — Decne. Jard. Fruit. Mus. tab. 1. — Math.
F l. for. p. 131. — Europe et Asie occidentale.
Le P . Commun, sous la forme sauvage est un arbro à port pyramidal, a