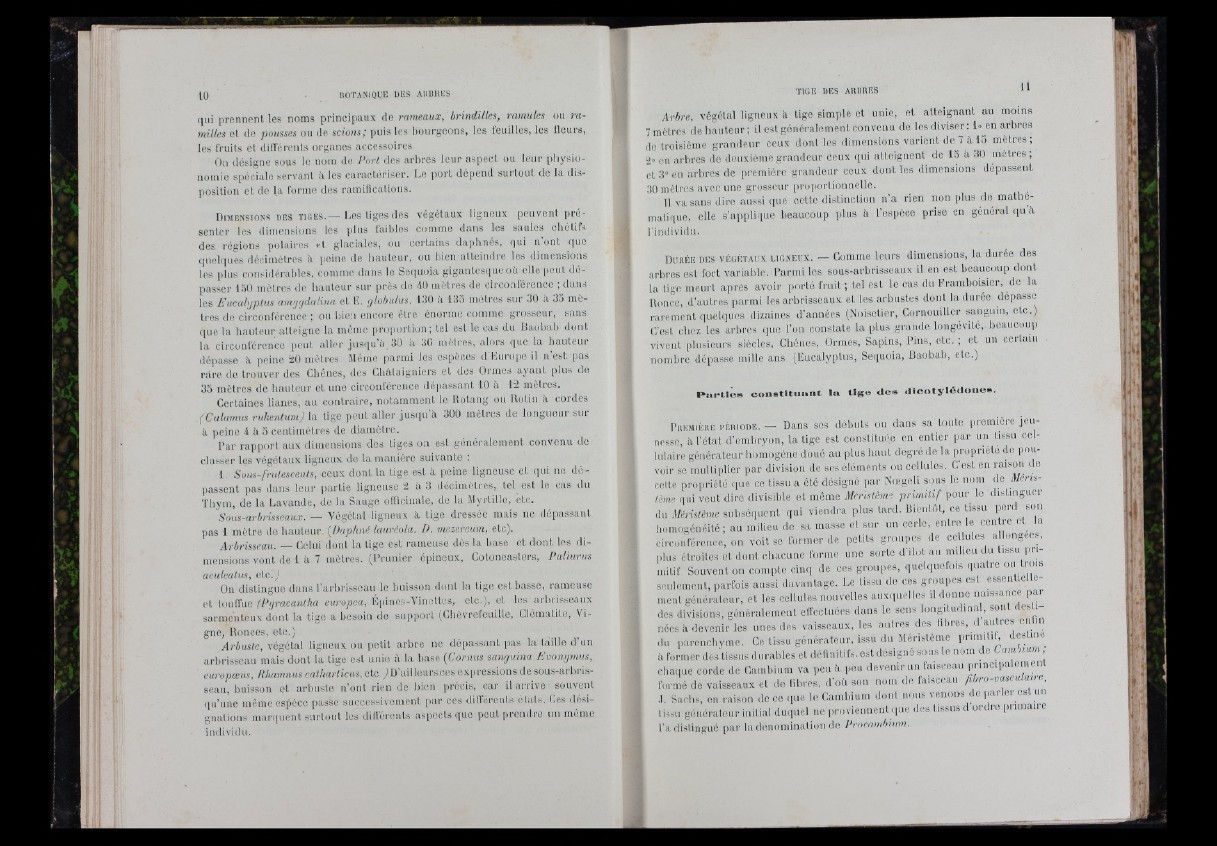
lü liOTANIOUK DES AIlllHWS TIGE DES AllIillES U
qui prennent les noms principaux do rameaux, brindilles, rnmules ou ramilles
ct de pousses ou de scions; puis Les bourgeons, les feuilles, les Hours,
les fruits ct dinêrents organes accessoires
Dn désigne sous lo nom de J‘ori des arlires leur aspect ou leur physionomie
si)éciulo servant à les caractér iser. Le port dépend sur tout de la disposition
el do la l'orme des romilications.
D im e n s io n s iie s t i g e s .— Les tiges dns végétaux ligneux peuvent prô-
senlor les dimensions les plus laihles comme dans les saules chétifs
des régions polaires r i glaciales, ou certains daphnes , ipii n'ont (|iio
quelques décimètres à peine de liaulciir, ou liien alteiiulro les diiuoiisions
les plus coiisideral)les, comme dans lo Soipioia gigautesiiuo où elle peut dépasser
lot) mètres de luuilour sur près do it) mètres de circonfèi-eiico ; dans
les E ucalyptus ami/ydalina cl lî. ylobulus. 1311 à 133 mètres sur 30 à 33 mètres
de circonfèreuce ; ou bien encore être énorme comme grosseur, sans
(|iic la liauteur atteigne la même |)roportiun; tel est le cas du baobab dont
la circoul'éivnce peut aller jusiiu'à 30 à 30 moires, alors (pic la hauteur
dopasse à peine 20 mètres iMêmo iianni les csiiécos d'Iiuropc il n ’est ¡las
rare de trouver des Cliénes, des Châtaigniers ol des Ormes ayant i>lus de
33 métros de liauteur ot une circonl'érciico déliassant 10 à 12 métros.
Certaines lianes, au contraire, notammenl lo Rotang on Roliii a cordes
(Calamus rukenUun) la tige peut aller ju sq u ’à 300 mètres de longueur sur
à peine i à 3 centimètres de diamètre.
l'ar rapport aux diuicnsious dos tiges oa est généraloinont convenu de
classer les végétaux ligneux do la manière suivante :
1. Soas-fnUescents, ceux dont la lige osl a peine ligneuse ot qui no d é passent
pas dans leur partie ligneuse 2 a 3 déciinctros, tel est Lo cas du
Thym, de la luivande, de la Sauge olliciuale, do la .Myrtille, etc.
'Sous-arbrisseaux. — Végétal ligueux à tige drossée mais ne dépassant
pas 1 métro do liauteur [Dapkné lauréola. D. mezereum, oie).
Arbrisseau. — Celui dont la lige est ramciiso dès la base el dont 1rs di mensions
vont do 1 à 7 métrés, ( l’ruuier épineux, Colotioaslcrs, P aliurus
uculealus, otc.j
On distingue dans l’arlirisscau lo buisson dont la tige est basse, rameuse
el tiHilfue (Pi/racunlha europea. Epines-Viiieltes, etc.), et les arbrisseaux
sarmenleux dont la tige a besoin do suppor t (Chèvrefeuille, Cloinalile, Vigne,
Ronces, otc.)
Arbuste, végétal ligneux ou petit arliro ne déliassant pas la taille d’un
arbrisseau mais dont la lige est unie à la base {Cornus sanyuina Eoonymus,
europoeus, Utiamnus catkariicus. etc J ü ’ailleursces expressions de sous-arbris-
seaii, luiisson et arlnislo n’ont rien do bien précis, car il arrive souvent
([n’iino même espèce passe successivemonl par ces dilférents états. Ces dési-
gnalioiis marquent surluiit les dilférents aspects que poul [ircndro un inêiuo
individu.
Arbre, végétal ligneux à tige simple et unie, el atteignant au moins
7 métros de hauteur ; il est généralement convenu de les diviser: U en arbres
do troisième g r and eur ceux dont les ilinioiisions varient de 7 à 13 métrés;
oo enar liros do deuxième grandeur ceux ipii atteignent de 13 à 30 mèt res ;
cl 3“ en arbres de première grandeur ceux dont Los dimensions dépassent
30 mètres avec une grosseur proportionnelle.
11 va sans dire aussi (lue cette (lislinction n'a rien non plus do malhc-
maliiiuo, elle s’applique beaucoup plus à l’espèce prise en général (¡u à
l'individu.
D lu ié e d e s v é g é t a u x l i g n e u x . - Comme leurs dimensions, la durée des
arbres est fort variable, l 'a rmi les sous-arbrisseaux il on est beaucoup dont
la lige meur t après avoir porté fruit ; tel est le cas du Framboisier, de la
Ronce, d ’autres parmi les arbris seaux ot les arbustes dont la durée dépasse
rarement (piebiues dizaines d’années (Noisetier, Cornouillor sanguin, etc.)
C’est cliez les arbres iiiic l’on constate la plus grande longévité,, beaucoup
vivent plusieurs siècles. Chênes, Ormes, Sapins, Fins, etc. ; ot un corlain
nombre dépasse mille ans (Eucalyptus, Sequoia, Raobab, etc.)
H a i 't i e s e o i i e t i t u a i i t l a t i g « <les a i c o t y l é i l o i i e n .
PiUCMiÙHii DÉulûDii:. — Dans sos débuts uu dans sa toute itrcniièi'O jeu-
ncsse, à l’étal d ’embryon, la tige est constituée en entier par un tissu cellulaire
générateur homogène doué an plus h aut degré do la p ropriété do pouvoir
se multiplier par division de ses éloinoiils ou cellules. C'est on raison do
celte propriété que ce tissu a été désigné [lar Nicgoli sous le nom de iWcris-
lème (uii veut dire divisible et même Mérislème p r im itif pour lo (lislmgiicr
du Méristèmc subséiiucnl ([ui viendra plus tard. Bientôt, ce tissu perd son
homogénéité ; au milieu de sa masse ct sur un cerlo, entre le cou re cl la
cirr.ml'éronce, on voit se former de petits grouiics do coUiilcs a longees,
plus étroites el doiil chacune forme une sorte d'iiot au inilioii du tissu pi i-
inilif Souvent on compte cimi do ces groupes, .|uel(iiicl'ois quatre ou trois
seulement, parfois aussi davantage. Le tissu do ces groupes est esseii le e
ment générateur, ct les cellules nouvelles auxquelles il donne naissance pai
des divisions, généralement ell'ccluées dans lo sens longitudinal, sont des i
nées à devenir les unes dos vaisseaux, les antres dos libres, d autres enlm
du parenchyme. Ce tissu générateur, issu dn Mcristéme primit. , destine
il furiner des tissus dnral.los el (lélinitifs. est désigné sous lo nom do Camnum
cliaque corde do Camliium va pou à |ieu devenir un faisceau priiicipaleinenl
formé (le vaisseaux cl do libres, d'oi'i son nom de faisceau f b r o - v a s e u t a i j e .
.1. Sachs, 011 raison de ce ipio le Cambium dont nous venons de parler est un
tissu générateur initial diuiiiel ne provieniicnl que des tissus d ’ordre primaire
l'a distingué par ladénoininalion de Pmcamlnum.
l . | i,
Ff
^•1
é -
I
') Qc
r i