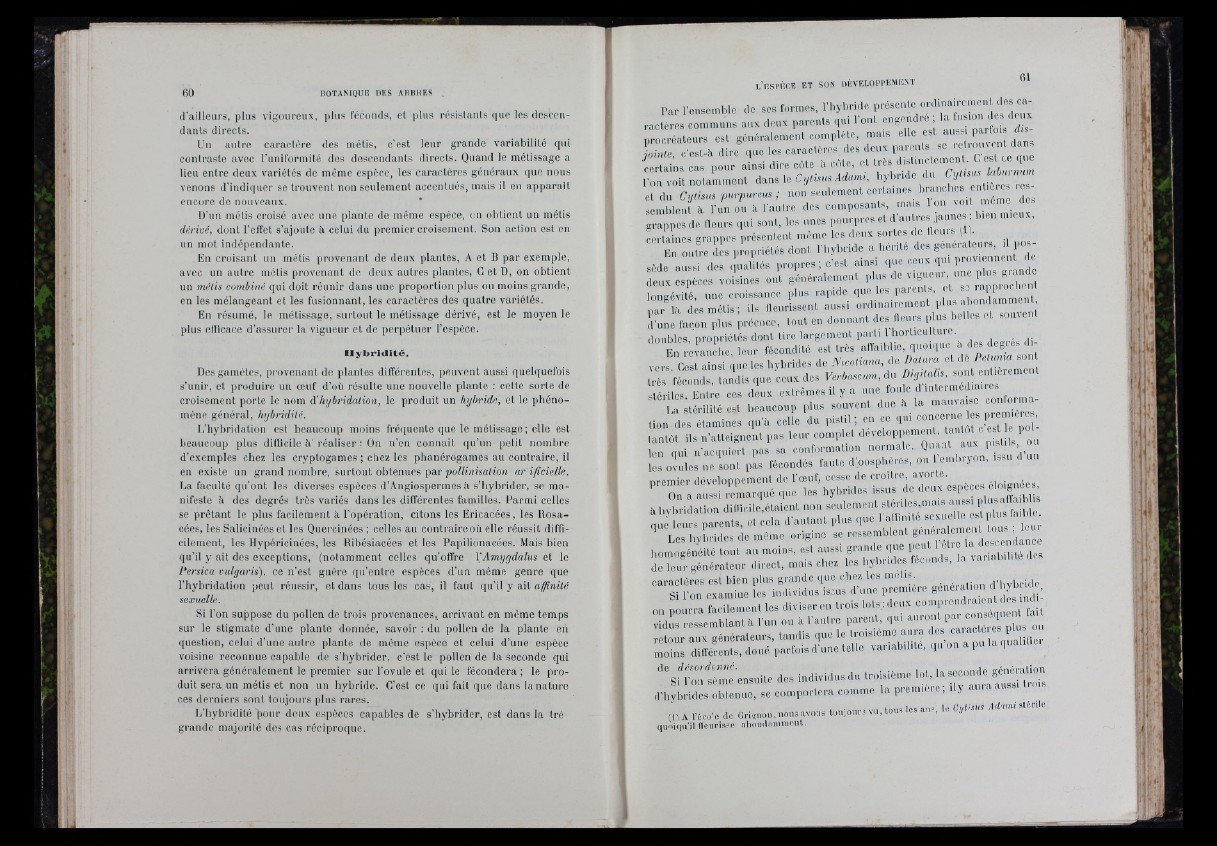
(U
iraüleiirs, plus vigoureux, [ilus féconds, ct plus résistanis (|ue les descendants
directs.
Uu aulrc caraclére des métis, c’esl leur grande variabilité qui
contraste avec runiformilé des desccudants directs. Quand lo métissage a
lieu entre deux variétés de même espèce, les earaclères généraux que nous
venons d'iudiipier se trouvenl non seulement accentués, mais il en appa ra i t
encore do nouveaux.
D'un métis croise avec une idanto de même espèce, on obtient un métis
dérivé, doul l’elTet s’ajoute à celui du premier croisement. Son action est en
un mot indépendante.
Fil croisant uu métis provenant de deux plantes, A ct B par exemple,
avec uu autre métis provenant de deux autres plantes, C et D, on obtient
un métis combiné ijui doit réunir dans une proportion plus ou moins grande,
en les mélangeant ct les fusionnant, les caractères des quatre variétés.
En résumé, le métissage, surtout le métissage dérivé, est le moyen le
plus ellicace d ’assurer la vigueur ct de perpétuer l’espèce.
I l y b r l d i l é .
Des gamètes, provenant de plantes différentes, peuvent aussi quelquefois
s'unir, et produire un oeuf d ’où résulte uue nouvelle plante : celte sorte de
croisement porte lo nom d'hybridation, le produit un hybride, et le p hén omène
général, hybridité.
I /hybridation est beaucoup moins fréquente que le métissage; elle est
beaucoup plus diilicilc à ' réaliser : On n'en connaît q u ’un petit nombre
d’exemples chez les cryptogames ; chez les plianérogames au contraire, il
en existe un grand nombre, sur tout obtenues par poWiuîsaG’ou ar i/icielle.
La faculté qu'ont les diverses espèces d ’Angiospermes à s’hybrider, se ma nifeste
à des degrés très variés dans les différentes familles. Parmi celles
se prêtant le pins facilement à l'opération, citons les Ericacées, les Rosacées,
les Salicinées et les Qnercinées ; celles au cont rai reoù elle réussit difficilement,
les llypéricinées, les Uibésiacées et les Papilionacées. Mais bien
qu’il y ait des exceptions, (notamment celles qu'ofl're VAmyydalus et lo
Persica vulgaris). ce u'est guère qu'entre espèces d'un mémo genre que
r i iybr idation peut réussir, et d ans tous les cas, il faut q u 'û y ail affinité
sexuelle.
Si l'on suppose du pollen de trois provenances,, ar r ivant en même temps
sur le stigmate d ’une plante donnée, savoir : du pollen de la plante en
question, celui d ’une aulre plante de même espèce et celui d ’une espèce
voisine reconnue capable de s'hybrider, c'est le pollen de la.seconde qui
ar r ivera généralement le premier sur l’ovule et qui le fécondera ; le p roduit
sera un métis et non un hybride. C’est ce qui fait que dans la nature
ces derniers sonl toujours plus rares.
L’iiybridité pour deux espèces capaldes do s ’hybr ider, est dans la trè
grande majorité des cas réciproque.
P a r l 'e n s e m b l e d e s e s f o rm e s . P h y b r i d e p r c s c u t e o r d i u a i r e m e u U l e s
r a e l è r c s c o m m u n s a u x d e u x p a r e n t s q u i l 'o n t e n g e n d r e ;
n r o c r é a t e u r s c s l g é n c r a lo m c n t c o m p l è t e , m a i s e l le c s l ausM p a i fo is d is
ï Z e ^ Z - a d i r e q u e le s c a r a c t è r e s d e s d e u x p a r c u l s s e r c l r o u v e n t d a n s
c e r t a in s c a s p o u r a in s i d i r e c ô t e à c è l e , e t t r è s d isU u c l c m c n l . L e s t t e q u e
l ’o n v o il n o t a m m e n t d a n s \a C y tis u s A d a m i. h y b r i d e d u C yU s iis a /m n n n
s e m b l e n t à l 'u u o u .à l 'a u l r o d e s c o m p o s n i ils , m a is I o n NOit m tm c
g r a i . p e s d e l l e u r s q u i s o n t, lo s u n e s p o u r p r e s e t d 'a u l r e s .,o u n r e ; b ie n m i e u x ,
c o r l a in e s g r a p p e s p r é s e n t e n t m êm e l e s d e u x s o r t e s d o H o u rs [i).
ë ë m iëoe s ,, o p r i é l é s d o n t l ’h y b r id e a h é r i t é d e s g é n é r a t e u r s , .1 p u s -
lo n u c v i l é u n e e r o i s s a u e e p lu s r a p i d e (p ie le s p a r e n l s , e t s l a p p . o r h o n l
, r u l à d e s m é t i s - ils l lo u r i s s e n l a u s s i o r d i i i a i r e m e n t p lu s a lm n d a r a m e n l ,
! r „ n e f a ç o n p lu s p r é c o c e , t o u t e n d o n n a n t d e s l l e u r s p lu s b e l le s e t s o u v e n
d o u b l e s , p r o p r i é t é s d o n t t i r e l a r g e m e n t h o r t i c u l l u i o .
F n r c v a n e h o l e u r f é c o n d i t é e s l t r è s a f l a ib l io , q u o iq u e a d e s d e g i t s u i
v e r c ë s î a i ë s i q u e le s h y b r i d e s d e N .e o t ia n a , d e D a tu r a e t d e P e tn m a s o n
t r è s 'f é c o n d s , t a n d i s q u e c e u x d e s V e r b a s e u m ,d a D ig ita lis , ^ '(u e n U e r cm c n t
stérile-« E n i r e c e s d e u x e x t r ê m e s il y a u u e f o u le d i n t c rm t d i a i i 0 =
I a s t é r i l i t é e s t b e a u c o u p p lu s s o u v e n t d u e h l a m a u v a i s e e o n fo i m a
tio n d e ; é t a m i n e s q u ’à c e lle d u p i s t i l ; e n c e q u i
t a u l ô t il s n ’a t l e i g u e n t p a s l e u r c o m p l e t ^
l e n n u i n 'a r q u i e r t p a s s a r o u f o rm a l io i i n o rm a l e . Q u a .i t a u x p ism , ,
l . m . « ’. . . . pi» » . . « . - • ™
n r e m i e r d é v e lo p p e m e n t d e l ’oe u f , c e s s e d e c r o î t r e , a v o r t e . _
" I . .,«« 1 « h ïk 'W » 1 « ”> •" ' » “ > ,1;
L e s liy b r iô f is f i e s e r e s s em b l e n i g e a e i a l c m e n ,
c a r a c t è r e s c s l b i e n p lu s g r a n d e q u e e b o z le s m c l i s . d ’b v b r id e
Si l ’o n e x a m in e le s in d i v id u s is s u s d ’u n e p r em i e r e
d 'i i y b r i d e s o b l e m i c , s e c o m p o r l e r a c o m m e l a p i e m u i c , i j
7 A .-Or„-o do G n .n o „ , nous avons to u jo u rs vu, tous . . . an s. .0 Cg taus Acinmi stérile
quniiiii’il n eu rissc nlimiihiuuiii'iit.
' y
i i
«wi
i.
L i