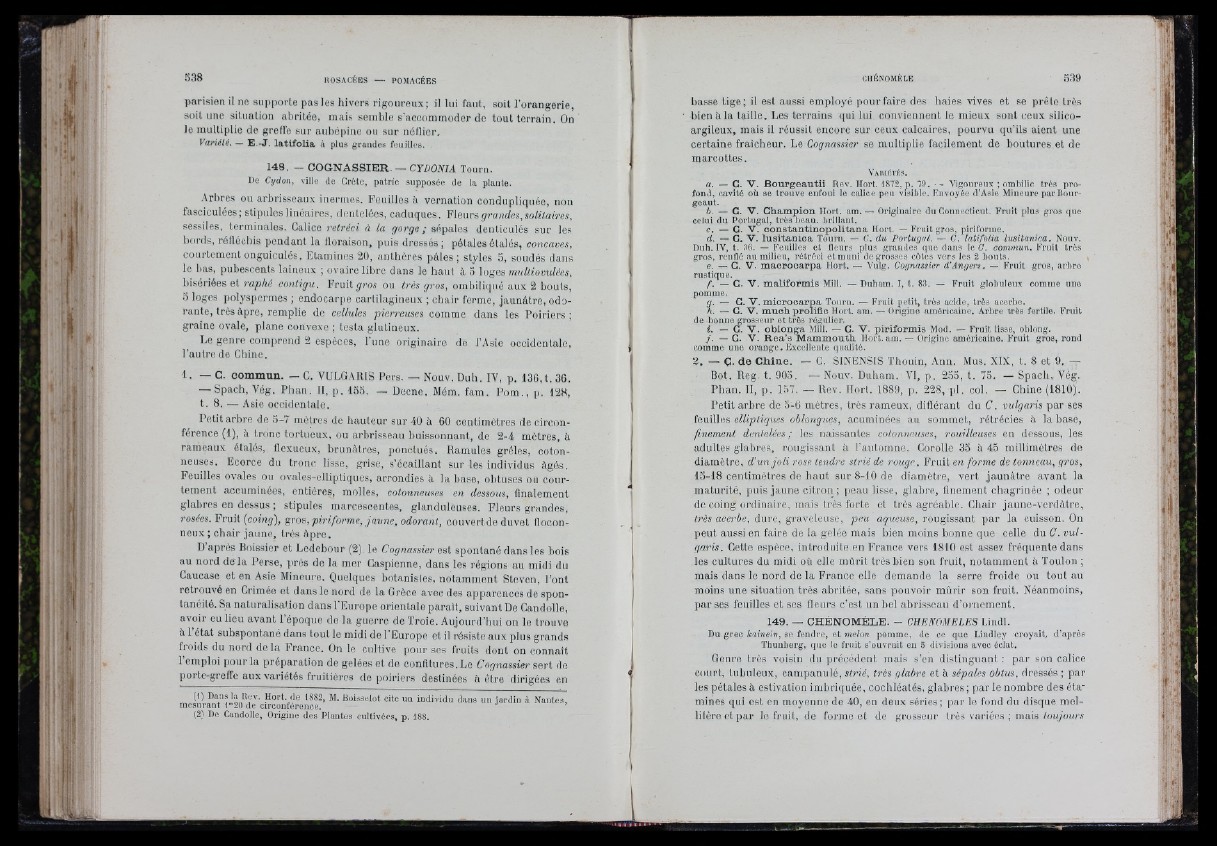
¡ f
parisien il nn siipporle pas les hivers rigoureux ; il lui faut, soit l ’orangerie,
soit une situation aliritée, mais semble s'accommoder de tout terrain. On
le multiplie de greffe sur aubopiiio ou sur ncllier.
V a riété . — E -J. la tifo lia à plus grandes feuillt's.
148. - C O G N A S S IE R . — CYDONIA Tourn.
De Cÿd o n , ville de Crète, patrie supposée de la planle.
.Arbres ou arbrisseaux inermes. Fouilles à vernation condupliquée, non
fascieulées; stipules linéaires, dentelées, caduques. Yleuvagrandes,solitaires,
sessiles, terminales. Galice rétréci à la g o rg e ; sépales denticulés sur les
bords, rétléchis pendant la lloraison, [ïiiis dressés ; pétales étalés, concaves,
conrtement onguiculés. Etamines 20, anthères pâles ; styles o, soudés dans
lo bas, pubescents laineux ; ovaire libre dans le haut à o loges multiovulées.
bisériées et rapAd contigu. Fruit i/ro.s’ ou très ÿros, ombiliqué aux 2 bouts,
o loges polyspermes ; endocarpe cartilagineux ; chair forme, jaunâtre, odorante,
très âpre, remplie de cellules pierreuses comme dans les Poiriers;
graine ovale, plane convexe ; testa glutineux.
Lo genre comprend 2 espèces, l ’une originaire de l'Asie occidentale,
l'autre de Cliine.
1. — C. c om m u n . — C. VULGARIS Pers. — Nouv. Duli. IV, p. 130, t. 36.
— Spach, Vég. Phan. II, p . 133, — Decne. Mém. fam. P om ., [i. 128,
t. 8. — Asie occidentale.
Petit arbre de 3 -7 mètres de hauteur sur 40 à 60 centimètres de circonférence
(1 ), à tronc tortueux, ou arbrisseau buissonnant, de 2 -4 mètres, à
rameaux étalés, flexueux, brunâtres, ponctués. Ramules grêles, cotonneuses.
Ecorce du tronc lisse, grise, s’écaillant sur les individus âgés.
Feuilles ovales ou ovales-elliptiques, arrondies à la base, obtuses ou courtcment
accuminées, entières, molles, cotonneuses en dessous, finalement
glabres en dessus ; stipules marcescentos, glanduleuses. Fleurs grandes,
rosées. Fruit (coing), gro%, piriforme, ja u n e , odorant, couvert de duvet floconneux;
chairjaune , très âpre.
D’après Boissier et Lodebmir (2), le Cognassier est spontané dans les bois
au nord de là Perse, près de la mer Caspienne, dans les régions au midi du
Caucase et en Asie Mineure. Quelques botanisles, notamment Steven, l ’ont
retrouvé en Grimée et dans le nord do la Grèce aveo des apparences do spontanéité.
Sa naturalisation dans l'Europe orientale paraît, suivant De Candolle,
avoir eu lieu avant l ’époque do la guerre de Troie. Aujourd’hui on le trouve
a l ’état subspontané dans tout le midi de l'Europe et il résiste aux plus grands
froids du nord de la France. On le cultive pour ses fruits dont on connaît
l ’emploi pour la préparation de gelées et de confitures.Le Cognassier sert de
porte-greffe aux variétés fruitières de poiriers destinées à être dirigées en
(I) Drais 1,1 nov. Hort. .le 1882, M. Boisselot cite un individu dans un jardin à Nantes,
mesurant l ” 20 de circonférence.
(2} 1)0 Candolle, Origine des Plantes cultivées, p. 188,
basse lig e ; il est aussi employé pour faire des liaies vives et se prête très
bien à la taille . Les terrains qui lui conviennent le mieux sont ceux silico-
argileux, mais il réussit encore sur ceux calcaires, pourvu qu'ils aient une
certaine fraîcheur. Le C o g n a s s i e r se multiplie facilement de boutures et de
marcottes.
V a r i é t é s .
a . — G. V . Bourgeautii Rev. Hort. 1872, p. 79. - Vigoureux ; omJnlic très profond,
cavité où se trouve enfoui le calice pou visible. Knvoyéo d’Asie Mineure parBour-
geaiit.
b. — G. V . Ghampion Hort. am. — Originaire du Connecticut. Fruit plus gros que
celui du Portugal, très lieau. iirülant.
c . — G. V . constantinopolitana Ilort. — Fruit gros, piriforme.
d . — G. V . lusitanica Tourn. — C. d u P o r tu g a l. — C. la tifo lia lu s i ta n i c a . Nouv.
Duh. IV, t. 86. — Feuilles et fleurs plus grandes que dans le C. c om m u n . Fruit trô.s
gros, renflé au milieu, rétréci et muni de grosses côtes vers ies 2 bouts.
e. — G. V. macrocarpa llort. — Vulg. C o g n a ssier d ’A n g e r s . — Fruit gros, arbre
rustique.
f . — G. V . maliformis Mill. — Duham. I, t. 83. — Fruit globuleux comme une
pomme.
g . — G. V . microcarpa Tourn. — Fruit petit, très acide, très acerbe.
/i. — G. V . much prolific Hort. am. — Origine américaine. Arbre très fertile. Fruit
de bonne grosseur et très régulier.
i. — G. V . obionga Mill. — G. V . piriformis Mod. — Fruit lisse, oblong.
/. — G. V . R e a ’s Mammouth Hort. am. — Origine américaine. Fruit gros, rond
comme une orange. Excellente qualité.
2 . — G. de C h in e . — C. SINENSIS Thouin, Ann. Mus. XIX, t, 8 et 9. —
Bot. Reg, t. 903. — Nouv. Duliam. VI, p. 253, t. 73. — Spacli, Vég.
Plian. H, p . 137. — Rev. llort, 1889, p. 228, p l. col, — Chine (1810).
Petil arbre de 3-6 mètres, très rameux, différant du C . v u l g a r i s par ses
feuilles e l l i p t i q u e s o b l o n g u e s , acuminées au sommet, rétrécies â la base,
f i n e m e n t d e n t e l é e s ; les naissantes c o to n n e u s e s , r o u i i l e u s e s en dessous, les
adultes glabres, rougissant à l’automne. Corolle 33 à 45 millimètres de
diamètre, d 'u n j o l i r o s e t e n d r e s t r i é d e r o u g e . Fruit e n f o r m e d e t o n n e a u , g r o s ,
13-18 centimètres de haut sur 8-10 de diamèti'e, vert jaunâtre avant la
maturité, puis jaune citron ; jieau lisse, glabre, finement chagrinée ; odeur
de coing ordinaire, mais très forte et très agréable. Cliair jaune-verdâtre,
t r è s a c e r b e , dure, graveleuse, p e u a q u e u s e , rougissant par la cuisson. On
peut aussi en faire, de la gelée mais bien moins bonne que celle du C. v u l g
a r i s . Cette espèce, introduite.en France vers 1810 est assez fréquente dans
les cultures du midi où elle mûrit très bien son fruit, notamment à Toulon ;
mais dans le nord de la France elle demande la serre froide ou tout au
moins une situation très abritée, sans pouvoir mûrir son fruit. Néanmoins,
par ses feuilles ct ses fleurs c’est un bel abrisseau d’ornement.
149. — C H É N O M È L E . - C H E N O M E L E S Lindl.
Du grec k a in e iv , se fendre, et m e lo n pomme, de ce que Lindley croyait, d’après
Thunberg, que le fruit s’ouvrait en 5 divisions avec éclat.
Genre très voisin du précédent mais s ’cn distinguant : par son calice
court, tubuleux, campanulé, strié, très glabre et à sépales obtus, dressés ; par
les pétales à estivation imbriquée, cocbléatés, glabres ; par le nombre des éta"
mines qui est en moyenne de 40, en deux séries; par le fond du disque mel-
lilè r e e tp a r ie fruil, de forme el de grosseur très variées ; mais/oq/om's
ai • ■ i
.'»a
[.ill
K
-,
< " '^ '1
y I
* v |
l y \
i- ’’ I
u * '
' î
'lil