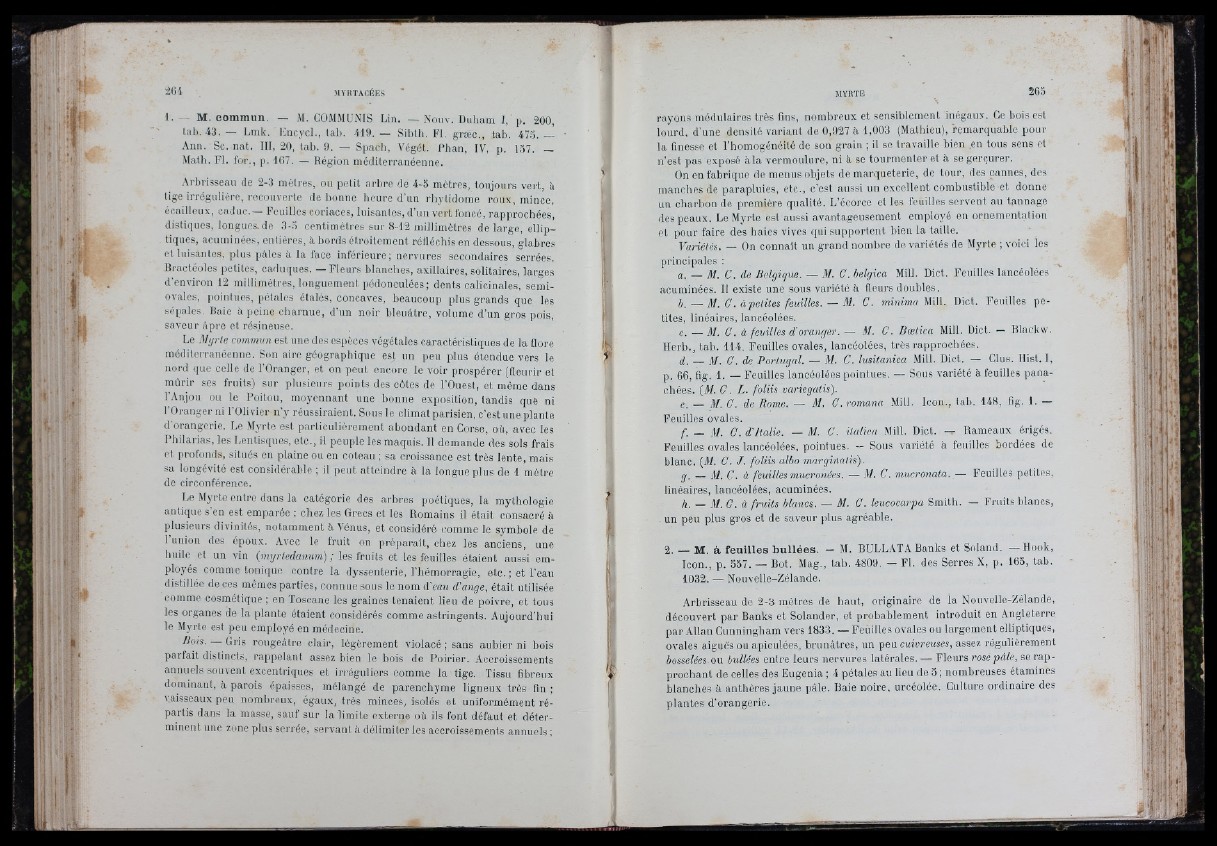
]'■• r i lÇ' A
r u : i ' !
i '
1. - M. c om m u n . — M. CO.\IML’.\IS Lin. — Nouv. Duham I, p. 2Ü0,
tab. 4 3 .— Lmk. KiicycL, tab. .419.— Sibth. Fl. græc., tab. 4 7 3 .—
.\nu. Sc. nat. lit, 20, tab. 9. — Spach, Végét. Fhan, IV, p. 137. —
Math. Fl. for., p. 167. — Région méditerranéenne.
.Arbrisseau de 2-3 inélres, ou petit a rbre de 4-5 mètres, toujours vei't, à
lige irréguliéro, recouverte de bonne h eure d'un rhytidome roux, mince,
écailleux, caduc .— FeuiUes coriaces, Inisanles, d 'un vert foncé, rapprochées,
distiiincs. longues.de 3-.3 centimètres sur 8-12 millimètres de large, ellip-
tifiucs, acuminées, entières, à bords étroitement réllécliis en dessous, glabres
ct luisantes, plus pâles à la face iiiférieuro; nervures secondaires serrées.
Bractéolés petites, cadmiues. — Fleurs blanches, axillaires, solitaires, larges
d'environ 1 2 millimètres, longueraeal pédonculées; dents calicinales, semi-
ovales, pointues, pétales étalés, concaves, beaucoup plus grands que les
sépales. Baie à peine cha rnue , d'un noir bleuâtre, volume d ’un gros pois,
saveur âp re ct résineuse.
Le Mi/rte commun est une des espèces végétales caractéristiques de la flore
méditerranéenne. Son aire géographique est un peu plus étendue vers le
nord ([lie celle de l ’Oranger, et on peut encore le voir prospérer (fleurir el
mûr ir ses fruits) sur plusieurs points des côtes de l ’Ouest, et même dans
r.Anjou ou le Poitou, moyennant une bonne exposition, tandis que ni
l'Oranger ni l'Olivier n ’y réussiraient. Sous le climat parisien, c’est une plante
d'orangerie. Le Myrte est par ticuliè rement ab ond ant en Corse, où, avec les
Philarias, les Lentisques, etc., il peuple les maquis. Il demande des sols frais
et profonds, situés en plaine on en coteau ; sa croissance est très lente, mais
sa longévité est considérable ; il peut atteindre à la longue plus de l mètre
de circonférence.
Le Myrte entre dans la catégorie des arbres poétiques, la mythologie
antique s'en est emparée ; chez les Grecs et les Romains il était consacré à
plusieurs divinités, notammen t cà Vénus, et considéré comme le symbole de
1 union des époux. Avec le fruit on préparait, chez les anciens, une
huile et un vin {myr(edanum) ; les fruits et les feuilles étaient aussi employés
comme tonique contre la dyssenterie, l'hémorragie, etc. ; et l'eau
distillée de ces mêmes parties, connue sous le nom d'eau d'ange, était utilisée
comme cosmétique ; en Toscane les graines tenaient lieu de poivre, et tous
les organes de la plante étaient considérés comme astringents. Aujourd'hui
le Myrte est peu employé en médecine.
Bots. — Gris rougeâtre clair, légèrement violacé ; sans aubier ni bois
par fait distincts, rappelant assez bien le bois de Poirier. .Accroissements
annuels souvent excentriques et irréguliers comme la tige. Tissu fibreux
dominant, à parois épaisses, mélangé de parenchyme ligneux très fm ;
vaisseaux peu nombreux, égaux, très minces, isolés et uniformément répartis
dans la masse, sauf sur la limite externe où ils font défaut et déter minent
une zone plus serrée, servant à délimiter les accroissements annuels ;
|K
i ’
rayons médulaires très fins, nombreux et sensiblement inégaux. Ce bois est
lourd, d ’une densité var iant do 0,927 à 1,003 (Mathieu), r emarquable pour
la finesse et l ’homogénéité de son grain ; il se travaille bien en tous sens et
n ’est pas exposé à l a vermoulure, ni à se tourmenter et à se geriiurer.
On en fabrique de menus objets de marqueterie, de tour, des cannes, des
manches de parapluies, etc., c’est aussi un excellent combustible et donne
un charbon de première qualité. L’écorce e l le s feuilles servent au tannage
des peaux. Le Myrte est aussi avantageusement employé en ornementation
et pour faire des haies vives qui suppor tent bien la taille.
Variétés. — On connaît un grand nombre de variétés de Myrte ; voici les
principales :
a. — M. C. de Belgique. — M. G. belgica Mill. Diet. Fenilles lancéolées
acuminées. Il existe une sous variété à fleurs doubles.
i , _ M. G. à petites feuilles. — M. C. minima Mill. Diet. Feuilles p e tites,
linéaires, lancéolées.
_ M, G. à feuilles d'oranger. — M. G. Boetica Mill. Diet. - Blackw.
Herb., tab, 114. Feuilles ovales, lancéolées, très rapprochées.
_ ,[/, G. de Porhtgal. — M. C. lusitanica Mill. Diet. — Glus. Tlist. I,
p. 6 6 , flg. 1. — Feuilles lancéolées pointues. — Sous variété à feuilles p an a chées.
{M. G . L . foliis variegatis).
e, — M. G. de Borne. — M. G.romana Mill. Icon., lab. 148, fig. 1. —
Feuilles ovales.
f. — M. G. d'Italie. — M. G. italica Mill. Diet. — Rameaux érigés.
Feuilles ovales lancéolées, poinlues. — Sous variété à feuiUes bordées de
blanc, (il/. G. J. fo liis albo marginatis).
— M, C. à feuilles mucronées. — M. C. mucronata. — Feuilles petites,
linéaires, lancéolées, acuminées.
h, - M .G . à fru its blancs. — M. G. leucocarpa Smith. — Fruits blancs,
un peu plus gros et de saveur plus agréable.
2. — M. â fe u ille s h u ilé e s . - M. BULLATA Banks et Soland. — Hook,
Icon., p. 357. — Bot. Mag., tab. 4809. — Fl. des Serres X, p. 163, tab,
1032. — Nouvelle-Zélande.
.Arbrisseau de 2-3 mètres de liaut, originaire de la Nouvelle-Zélande,
découvert p a r Banks et Solander, et p robablement introduit en Angleterre
p a r Allan Cunningham vers 1833. — Feuilles ovales ou largement elliptiques,
ovales aiguës ou apiculées, brunâtres , un peu cuivreuses, assez régulièrement
bosselées ou huilées enire leurs nervures latérales. — Fleurs rose pàle, se r a p prochant
de celles des Eugenia ; 4 pétales au lieu de 3 ; nombreuses étamines
blanches à anthères jaune pàle. Baie noire, urcéolée. Culture ordinaire des
plantes d'orangerie.
!.