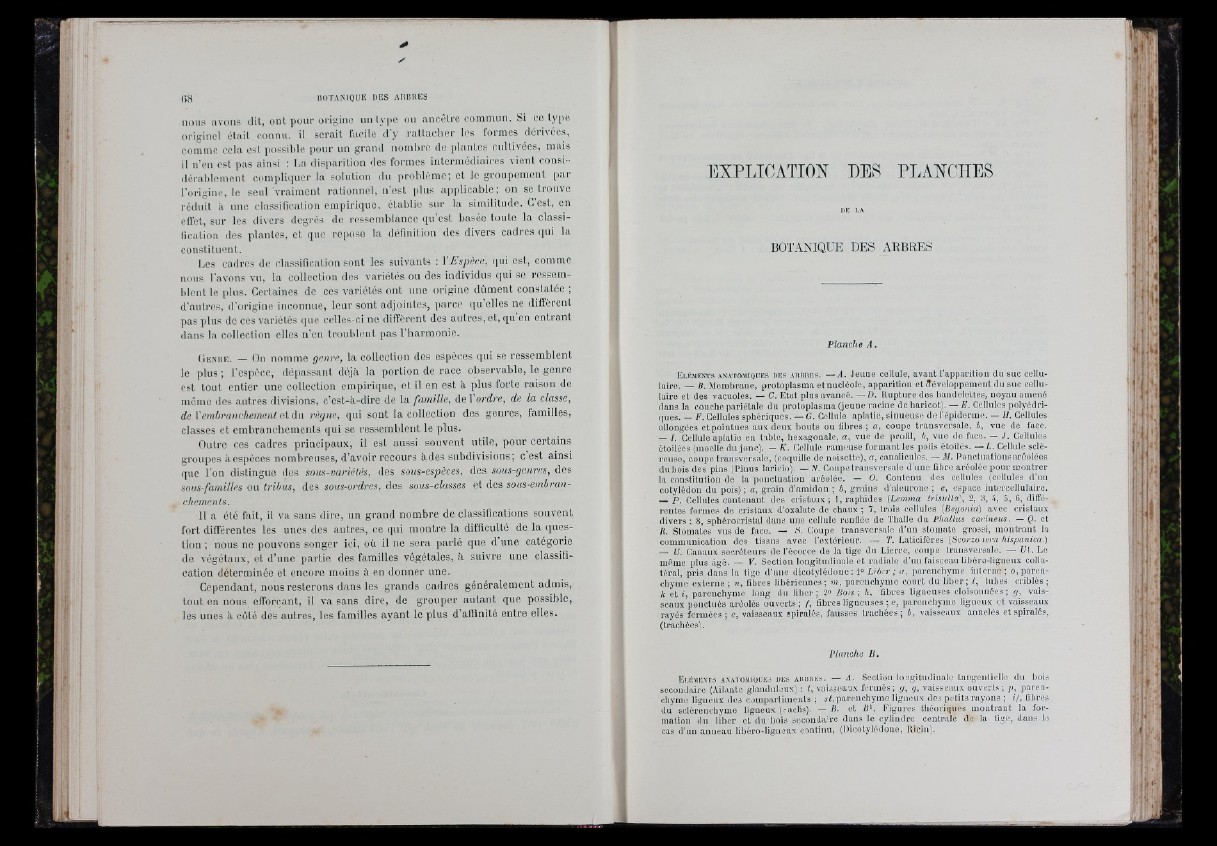
Ii8 l iOTANlQUE DES Al l l ì l lE S
nous avons dit, oui pour origine unlyi>e ou aucêlro commun. Si ce lype
originel était, connu, il serait facile d'y ratlaclicr les formes dérivées,
eommo cola est possible pour un grand nomlire de plantes euUivées, mais
il n’en est pas ainsi : La dis|iarition îles formes intermédiaires vient eonsi-
dérahlement eimi|iUi[ucr la solution du problème; ot le groupement par
l'o rigine, le senl vraiment rationnel, n ’est plus applicable; on se trouve
réduit il une elassilication ompiriiiuo, établie sur la siinililudc. C esl, en
eifet, sur les divers degrés de ressemblance qn’esl basée louto la classilicalion
des plantes, et une reiiose la défmilion des divers cadres iiui la
consliliicnt.
Les cadres de rlassiiicalion sont les suivants ; Y E s p è c e , qui est, comme
nous l'avons vu, la collection des variétés ou des individus qui so ressemblent
le iilus. Certaines do ces variétés ont une origine dûment constatée ;
d’antres, d'o rigine inconnue, leur sont adjointes, parce ([u’elles ne diffèrent
pas plus do ces variétés que celles-ci ne diffèrent des autres, ct, qu'en entrant
dans la colleclion elles n'en Iroiildent pas rh a rmo nie .
(ÎENiiE. — On nomme g e n r e , la collection des espèces qui se ressemblent
le plus ; respccc, dépassant déjà la portion de race observable, le genre
est tout entier une collection empirique, et il en est à plus forte raison de
même des autres divisions, c’est-à-dire de la fa m i l l e , de Y o r d r e , d e la c la sse ,
d e Y em b r a n c h em e n l n l d i i r è g n e , qui sont la collection des genres, familles,
classes et embranchements qui se resscmblonl le plus.
Outre ces cadres principaux, il est aussi souvent utile, pour certains
groupes àespèces nombreuses, d ’avoir recours àdes subdivisions; c’esl ainsi
([lie l ’on distingue des s o u s - v a r ié té s , dos so u s -e sp è c e s , des s o u s -g e n r e s , des
so u s -fa in ille s ou tr ib u s , des so u s -o rd r e s , des so u s -c la s se s et des s o u s - em b r a n c
h em e n ts .
Il a été fait, il va sans dire, un grand nombre de classiricalions souvent
fort différentes les unes des autres, ce qui montre la difficulté de la question
; nous ne pouvons songer ici, où il ne sera par lé que d une catégorie
(le végétaux, et d’une partie des familles végétales, à suivre une classifi-
eation déterminée et encore moins à en donner une.
Cependant, nous resterons dans les grands cadres généralement admis,
tout en nous efforçant, il va sans dire, do grouper autant que possible,
les unes à côté des autres, les familles ayant le plus d ’affinité entre elles.
l ê X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S
BOTANIQUE DES ARBRES
Pla n ch e A .
Ei.khexts .«.ITOMIQUES DES ahiiiius. — A. .Tenne cellule, avant l’ap p a ritio n du suc cellulaire.
— D. Membrane, protoplasma etn u c lèo lc , app.arition e t iTévcloppement du suc cellulaire
e t des vacuoles. — C. E ta t plus avancé. — D. Ru p tu re des bande lettes, noyau amené
d ans la couche p ariétale du pro lo p lasma (jeune racine de haricot). — E. Cellules polyédriques.
— F. Cellules sp h é riq u e s. — G. Cellule aplatie, s in u eu se de l’ép id crin c. — 11. Cellules
allongées e tp o in tiie s aux deux b o u ts ou libres ; a, coupe tran sv e rsa le , 6, vue de face.
— I. Cellule aplatie en table, hexagonale, n, vue de profil, é, vue de face. — J. Cellules
étoilées (moelle du joue). — K. Cellule ram eu se formant les poils étoilés. — L. Ceibilc sclé-
reiise, coupe tran sve rsale, (coquille de noisette), a, canalicules. — M. Ponctuations aréolées
d u b o is dos pins (Pinus laricio). — .V. Coupe tran sv e rsale il'uue libre aréoléc p o u r mo n trer
la constitution de la po n ctu atio n aréoléc. — 0 . Contenu des cellules (cellules d'un
cotylédon du pois) ; a, g ra in d ’am id o n ; b, g ra in s d 'alcurone ; e, espace, intercellula ire.
— P. Cellules contenant des c ris ta u x ; f, raphidcs [Lemma trisu lla ', 2, 3, -4, 5, 6, dilté-
ren tes formes do cristaux d'oxalate de chaux ; 7, tro is cellules [Begonia) avec cristaux
dive rs ; 8, sph éro cristal dans une cellule reullée de Thalle du Phallus carineus. — Q. ct
/î. Slomates vus de face, — -S. Coupe tra n sv e rs a le d’un stoma te grossi, m o n lran t la
communication des tissu s avec L’ex té rieu r. ~ T. l.aticifôres (Scorzo lera hispánica.)
— U. Canaux sé c ré teu rs de l'écorce de la tige du Lierre, coupe transve rsale. — Í/I. Le
même plus âgé. — V. Section lougitiuHuale et radiale d ’un faisceaulibéro-ligiiciix collaté
ra l, p ris d ans la tige d ’imc d ic o ty lé d o n e :! “ L ib e r; a, parenchyme iu lc rn c ; o, p a ren chyme
e x te rn e ; n, fibres lib é rien n e s; m, p arenchyme court du iib c r; I, tu b e s c rib lé s ;
k e t i, parenchyme long du liber ; 2“ Bois ; h. lib res ligueuses cloisonnées ; g, vaisseaux
ponctués aréolés o uverts ; f, libres ligneuses ; e, paren ch yme ligneux ct vaisseaux
rayés ferm ées ; c, vaisseaux spiralés, fausses tra chées ; b, vaisseaux annelés et spiralés,
(trachées!.
m
Planche D.
Ei.éhexts AXATomouiii des aiuiiies. — A. Section longitudinale tangciifielle du bois
secondaire (Ail.uilo glanduleux) ; t, vaisseaux fe rm é s; g, g, vaisseaux o uverts ; p, p a re n chyme
ligueux des com p artimen ts ; si, paren ch yme ligneux des p e tits ray o n s ; if, libres
du sclérenehyme ligneux (,-achs). — II. e t B'. Figures théoriques m o n tran t la fo rmation
du lib e r ct d u bois sccondah-c dans le cy lin d re centrale de la tige, d an s le
cas d'nn an n e au libéro-ligueiix continu, (Dicotylédone, Ricin).