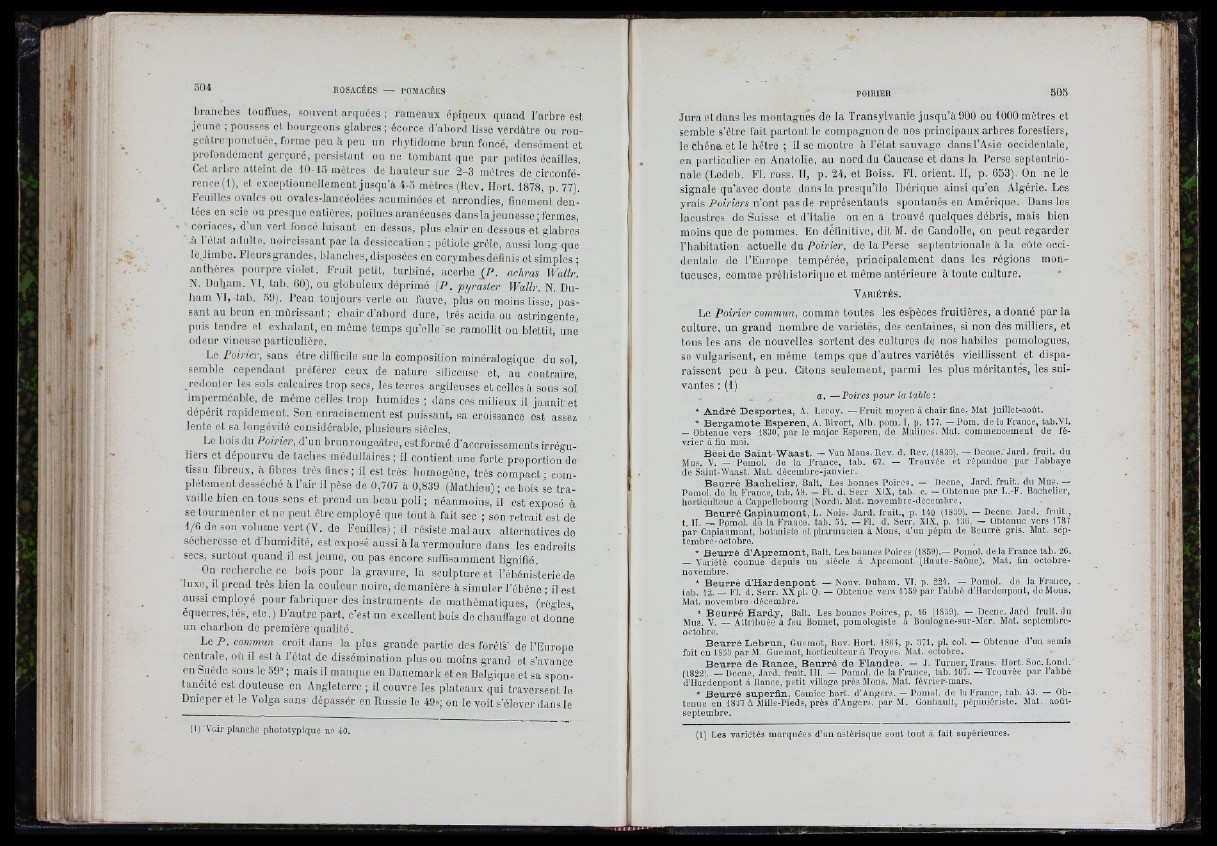
branches toiiffnes, souvent arquées ; rameaux épineux quand l ’arbre est
jeune ; pousses et bourgeons glabres ; écorce d’abord lisse verdâtre ou rougeâtre
ponctuée, forme peu à peu un rhytidome bnm foncé, densément et
profondément gerçuré, persistant ou ne tombant que par petites écailles.
Cot arbro alteint de 1 0 1 3 mètres do hauteur sur 2 -3 mètres do circonférence
(1), ct e.vceplionncllemont jusqu’à 4-3 mètres (Hev. Ilort. 1878, p. 77).
Feuilles ovales ou ovales-lancéolées acuminées et arrondies, finement dentées
en scie ou presque entières, poilues aranéeuses dans la jeunesse; fermes,
« coriaees, d'un vert foncé luisant en dessus, plus clair en dessous et glabres
•à l'élat adulte, noircissant par la dessiccation ; péliole grêle, aussi long que
lo.Jimbe. Fleurs grandos, blanches, disposées en corymbes définis et simples ;
anthères pourpre violet. Fruit petit, turbiné, acerbe {P. achras Wallr.
N. Duljam. A’I, lab. (iO), ou globuleux déprimé [P . p y ra ste r Wallr. N. Duliam
AI, tab. ,30i. Peau toujours verte ou fauve, plus ou moins lisse, passant
au brun en mûrissant; chair d’abord dure, très acide ou astringente,
puis tendre ct exhalant, en même temps qu’e lle 'so ramollit ou blettit, une
odeur vineuse particulière.
Le Poirier, sans être difficile sur la composition minéralogique du sol,
semble cependant préférer ceux de nature siliceuse et, au oontrairei
redouter les sols calcaires trop secs, les terres argileuses el celles à sous sol
imperméable, de même celles trop humides ; dans ces milieux il jaunit et
dépérit raiiidcment. Son enracinement est puissant, sa croissance est assez
lente et sa longévité considérable, plusieurs siècles.
Le bois du Poirier, d’un brun rougeâtre, ost formé d'accroissements irréguliers
et dépourvu de taches médullaires ; il contient une forte proportion de
tissu fibreux, à fibres très fines ; il est très homogène, très compact; complètement
desséché à l’air il pèse de 0,707 à 0,839 (Mathieu! ; ce bois le travaille
bien eu tous sens et prend un beau poli ; néanmoins,' il est exposé à
se tourmenter et ne peut être employé que tout à fait sec ; son retrait est de
1/6 de son volume v e r t(V . de Fenilles) ; il ré.siste mal aux alternatives de
sécheresse et d'humidité, est exposé aussi à la vermoulure dans les endroits
secs, surtout quand il est jeune, ou pas encore suffisamment lignifié.
On recherche ce bois pour la gravure, la sculpture et l ’ébénisterie de
luxe, il prend très bien la couleur noire, demanière à simuler l ’ébène ; il est
aussi employé pour fabriquer des instruments de mathématiques, (règles,
équerres, tés, etc.) D'autre part, c’est un excellent bois de chauffage et donne
un charbon de première qualité.
Le P . commun croît dans la plus grande partie dos forêts de l’Europe
centrale, où il est à l’état de dissémination plus ou moins grand et s’avance
en Suède sous le 39“ ; mais il manque en Danemark et en Belgique et sa spontanéité
est douteuse en Angleterre ; il couvre les plateaux qui traversent le
Dnieper et le Volga sans dépasser en Russie le 49»; on le voit s’élever dans le
(I) Voir planche phototypique no 40.
.Iiira et dans les montagnes de la Transylvanie jusqu’à 900 ou 1000 mètres et
semble s’être fait partout le compagnon do nos principaux arbres forestiers,
le Chêne, et le hêtre ; il se montre à l’état sauvage dans l’Asie occidentale,
en particulier en Anatolie, au nord du Caucase et dans ia Perse septentrionale
(Ledeb. Fl. ross. Il, p. 24, et Boiss. Fl. orient. II, p. 653). On ne lo
.signale qu’avec doute dans la presqu’île Ibérique ainsi qu’en Algérie. Les
yrais Poiriers n’ont pas de représentants spontanés en Amérique. Dans les
lacustres de Suisse ct d’Italie on en a trouvé quelques débris, mais bien
moins que de pommes. En définitive, dit M. de Candolle, on peut regarder
l’habitation actuelle d u / ’oiri'er, de la Perse septentrionale à la oêjte occidentale
de l ’Europe tempérée, principalement dans los régions mon-
tueuses, comme préhistorique et même antérieure à toute culture.
A'a r ié t é s .
Le Poirier commun, comme toutes les espèces fruitières, adonné par la
culture, un grand nombre de variétés, des centaines, si non des milliers, et
tous les ans de nouvelles sortent des cultures de nos habiles pomologues,
se vulgarisent, en même temps que d’autres variétés vieillissent ot disparaissent
peu à peu. Citons seulement, parmi les plus méritantes, les suivantes
: (1 )
a. — Poires pour la table :
* André Desportes, A. Leroy. — Fruit moyen à chair fine. Mat. juillet-août.
* Bergamote Esperen, A. Bivort, Alb. pom. I, p. 177. — Pom. de la France, tab.Vt.
— Obtenue vers 1830, par le major Esperen, de Malines. Mat, commencement de février
à fin mai.
B é side Saint-AVaast, - - Van Mons. Rev. d. Rev. (1830). — Decne. Jard. fruit, du
Mus. V. — Pomol. de la France, tah. 67. — Trouvée et répandue par l'abbaye
de Saiut-Waast. Mat. décembre-janvier.
Beurré Bachelier, Balt. Les bonnes Poires. — Decne, Jard. fruit, du Mus. —
Pomol. de la France, tab. 49. - Fl. d. Serr XIX, tab. c. — Obtenue par L.-F. Bachelier,
horticulteur à Cappellehourg (Nord'I. Mat. novembie-décembrc.
Beurré Gapiaumont, L. Nois. Jard. fruit., p. 140 (1839). — Decne. Jard. frmt.,
t. IL — Pomol. de la France, tab. 54. — Fl, d. Serr. XIX, p. 136. — Obtenue vers 1787
par Gapiaumont, botaniste ct pharmacien à Mons, ci'im pépin de Beurré gris. Mat. septembre
octobre.
* Beurré d’Apremont, Balt. Les bonnes Poires (1859).— Pomol. de la France tab. 26.
— Variété connue depuis uu siècle à Apremoiit (tIaute-Saône). Mat. fin octobre-
novembre.
* Beurré d'Hardenpont. — Xouv. Duham. Vf, p, 224. — Pomol. de la France,
tah. 12. — Fl. d. Serr. XX pl. Q. — Obtenue vers 1759 par l’abbé d’Hardenpont, de Mous.
Mat. novembre-décembre.
* Beurré Hardy, Balt. Les bonnes Poires, p. 16 (1859). — Decne. Jard fruit, du
Mus. V. — Attribuée à feu Bonnet, pomologiste à Boulogne-sur-Mer. Mat. septembre-
octobre.
Beurré Lebrun, Guemot, Rev. Hort. 1864, p. 371, pl. col. — Obtenue d’un semis
fait en 1853 par .M. Guemot, horticulteur à Troyes. Mat. octobre.
Beurré de Rance, Beurré de Flandre. — J. Turner, Traus. Ilort. Soc. Lond.'
(1822;. — Decne, .Tard, fruit. IH. — Pomol. de la France, tab. 107. — Trouvée par l’abbé
d'Hardenpont à Rance, petit village prés Mons. Mat. février-mars.
* Beurré superfin, Comice hort. d'Angers. — Pomol. de la France, tab. 43. .— Obtenue
en 1837 à Mille-Pieds, près d’Angers, par M. Gonbault, pépiniériste. Mat. août-
septembre.
(1) Les variétés marquées d’un astérisque sont tout à. fait supérieures.
1 '
' :• Al
îi .
' U