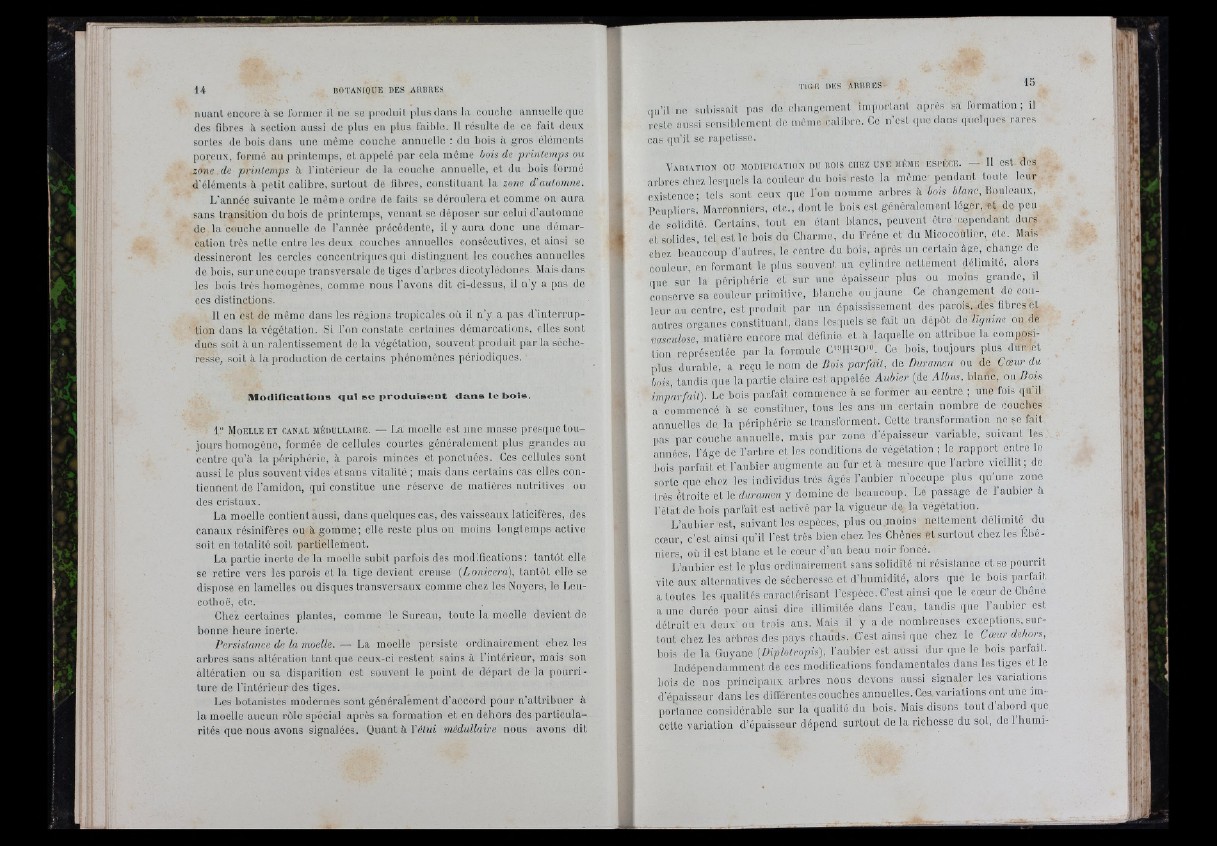
u B OTANIQUE B E S ABBBE S T IG E DES M iB U l îS 13
luianl oncurc à so former il im se produit plus dans la couclio annuelle que
dos fibres à section aussi de plus eu plus faible. 11 résulte do ce fait deux
sortes do bois dans une même concho anmiello : dn bois à gros éléments
poreux, formé au printemps, et appelé |iar cela même bois do p rin tem p s ou
zone de p rin tem p s à riiitcrieiir de la conclie annuelle, et du bois formé
d'éléments à iiclit calibre, surloiit de libres, constituant la zone d'automne.
L'année suivante le même ordre de faits se déroulera et comme on aura
sans transition du bois de p r iiitom [ )S , venant so déposer sur celui d'automne,
de la couche annuelle do rannéo précédente, il y au ra donc une d éma r cation
très nette entro les deux couches annuelles consécutives, et ainsi so
dessineront les cercles eonccnlr iqnesqui distinguent les couches annuelles
do bois, sur .unccüupe transversale de tiges d ’arbres dicotylédones Mais dans
les bois très homogènes, comme nous l’avons dit ci-dcssus, il n ’y a p a s de
CCS distinctions.
Il en est do même dans les régions Iropicalos où il n ’y a pas d'intcr rup-
' lion dans la végétation. Si l'on constate certaines démarcations, elles sont
duos soit à un ralentissement de la végétation, souvent produit pa r la sécheresse,
soit à la production de certains phénomènes pcriodi(|ucs.
M o d i f l c a t io i i s q u i s e p r o d u i s e n t d a n s le b o l s .
1" M o e l l e ET c a n a l m é i iu l l a i r e . — La moelle est une masse presque toujours
homogène, formée do cellules courtes géncralomcnl plus grandes au
centre qu’à la périphérie, à parois minces ot ponctuées. Ces cellules sont
aussi le plus souvent vides et sans vitalité ; mais dans certains cas elles contiennent
de l’amidon, qui constitue une réserve do matières nutritives ou
des cristaux.
La moelle contient aussi, dans quelques cas, des vaisseaux lalicifères, des
canaux résinifères ou à gomme; elle reste plus ou moins longtemps active
soit en totalité soit partiellement.
La partie inerte de la moelle subit parfois des modifications; tantôt elle
se retire vers les parois et la tige devient creuse {Lonicera), tantôt elle se
dispose en lamelles on disques transversaux comme chez les Noyers, le Leu-
cütboc, etc.
Chez certaines plantes, comme le Sureau, toute la moelle devient de
bonne heure inerte.
Persistance de la moelle. — La moelle persiste ordinairement cliez les
arbres sans altération tant (pio ceux-ci res tent sains à l’intérieur, mais son
altération ou sa disparition est souvent le point de dépai't de la p o u r r i ture
de l ’intérieur des tiges.
Les botanistes modernes sont généralement d ’accord pour n'attr ibuer à
la moelle aucun rôle spécial après sa formation ct en deliors des par ticularités
que nous avons signalées. Quant à Vétui médullaire nous avons dit
(Hi’il ne subissait |)as de changement imporlaut après sa formalion; il
reste aussi sensiblemenl do même ealibro. Ce n ’est que dans (piobpies rares
cas qu’il se rapetisse.
V a r i a t i o n ou m o d i f i c a t io n d u b o is c h e z u n e même e s p è c e . — Il osl dos
arbres clicz lesquels la couleur du bois reste la mémo pen dan t toute leur
existence; tels sont ceux que l'on nomme arbres à bois àfanc. Bouleaux,
Peupliers, Marronniers, etc., dont le bois est généralement léger, et de peu
de solidité. Certains, tout en étant blancs, |)euvenl être cependant durs
et solides, tel est lo bois du Charme, du Frêne cl du Micocoulier, etc. Mais
chez beaucoup d’aulrcs, le rent re du bois, après un certain ,ége, change de
couleur, en formant le plus souvent un cylindre nettement délimité, alors
(|ue sur la pér iphérie el sur une épaisseur plus ou moins grande, il
conserve sa couleur pr imilive, blanche ou jaune Ce changement de couleur
au centre, est produit p a r un épaississement des parois, des fibres el
autres organes conslitnanl, dans lesquels se fait un dépôt do lignine ou de
vasculose, matière encore mal définie cl à laiiuolle on attribue la composi-
üon représentée p a r la formule C'MP^’O'». Ce bois, toujours plus d ur ct
plus durable, a reçu le nom de /lois p a r fa it, de Duramen ou de Coeur du
bois, tandis que la partie claire est appelée Aubier (de Albus. blanc, ou Bois
imp arfait). Le bois pa r /a i t commence à so former au centre ; une fois qu'il
a commencé à sc constituer, tous les ans un certain nombre de couches
annuelles de la pér iphérie sc transforment. Cette transformation ne so fait
])as p a r couche aunuelle. mais par zone d'épaisseur variable, suivant les
années, l'âge de l ’arbre ct les conditions de végétation ; lo rap p o r t entre le
bois pa’rfait ot l'aubier augmente au fur ot à mesure que l'arbre vieillit; do
sorte que chez les individus très âgés l’aubier n'occupe plus qu’une zone
très étroite et le duramen y domino de beaucoup. Le passage do l’aubier à
l’élat do bois parfait est activé p a r la vigueur de la végétation.
L’aubier est, suivant les espèces, plus ou moins nettement délimité du
coeur, c’est ainsi qu’il l'est très bien chez les Chênes et surtout chez les Ebé-
niers, où il est blanc el lo coeur d ’un beau noir foncé.
L’aubier est le plus ordinairement sans solidité ni résistance cl se pourrit
vile aux alternatives de sécheresse ot d'humidité, alors que lo bois par fait
a tontes les qualités caraolérisant l’espèce, C’est ainsi que le coeur de Chêne
a u n e durée p o u r ainsi dire illimitée dans l'eau, tandis que l ’aubier est
détruit oa deux ou trois ans. Mais il y a de nombreuses exceptions, su r tout
chez les arbres des pays chauds . C’est ainsi que chez le Coeur dehors,
bois do la Guyane {Diplotropis), l'aubier est aussi dur que le liois parfait.
In d ép en d ammen t de ces modifications fondamentales dans les liges ot le
bois de nos pr incipaux arbres nous devons aussi signaler les variations
d'épaisseur dans les différentes couches annuelles. Ces var iations ont une importance
considérable sur la qualité du bois. Mais disons tout d ’abord que
cette variation d ’épaisseur dépend sur tout de la richesse du sol, de l’humi-
*‘ ’‘>i l1
"Il
; <1 ;l
l î : '
T'I