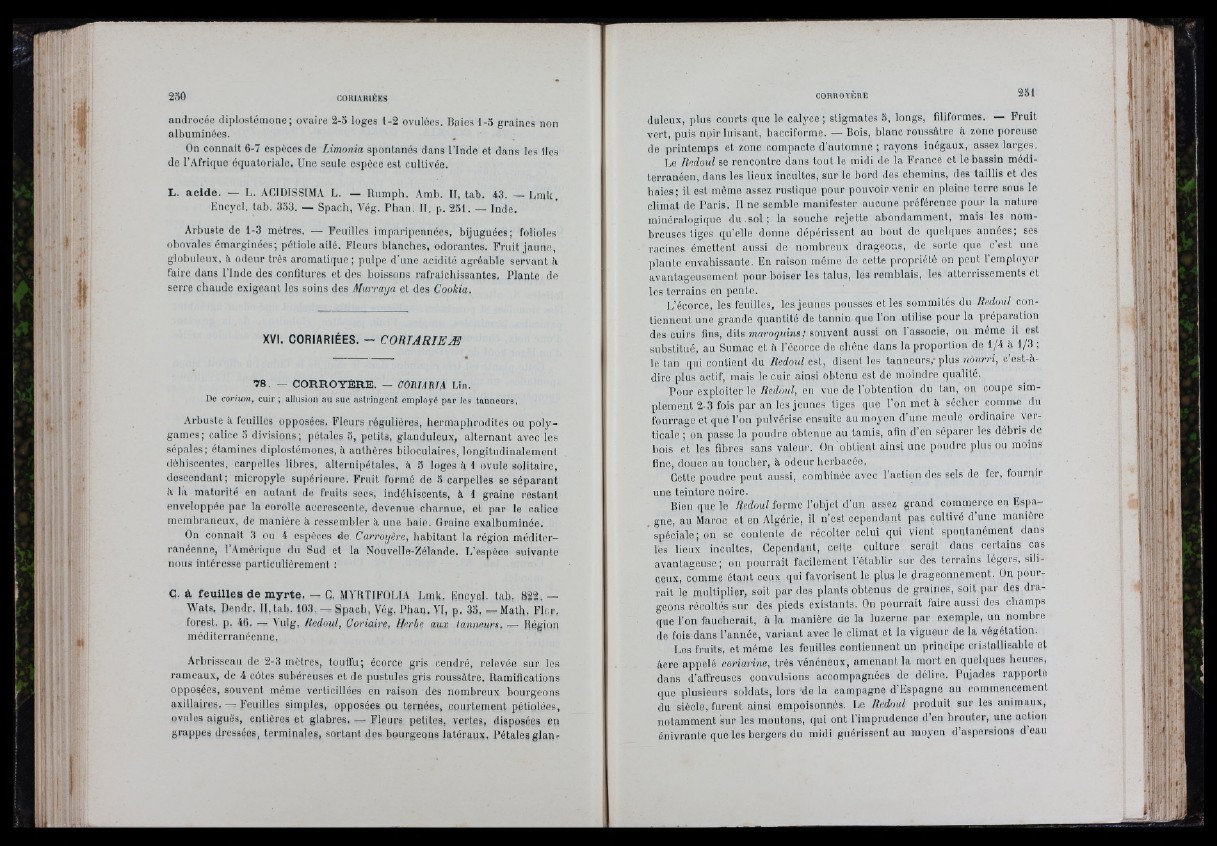
M ‘
1
I
• i "
1 % '
I
»< k
230 CORIARIEES
androcée diplostémone ; ovaire 2-3 loges 1-2 ovnlées. Baies 1-3 graines non
albuminées.
On connait 6-7 espèces de L i m o n i a spontanés dans ITnde et dans les îles
de r.Africpie équatoriale. Une seule espèce est cultivée.
L. a c i d e . — L. .VCIDISSIM.V L. — Rumph. .\mb. 11, tab. 43. — Lmk.
Encycl. tab. 3,33. — Spach, A’ég. Ph an. II, p. 231. — Inde.
Arlmste de 1-3 mètres. — Penilles impari[)ennées, bijuguées; folioles
obovales émarginéos; pétiole ailé. Fleurs blanches, odorantes. Fruit jau ne ,
globuleux, à odeur très aromatique ; pulpe d'une acidité agréable servant à
faire dans l ’Inde des confitures et des boissons rafraichissantes, Plante de
serre chaude exigeant les soins des M u r r a y a et des C o o k i a .
XVI, CORIARIÉES. - C O R T A R I E Æ
78 . — CO R RO Y È R E . — CORIAR/A Lin.
De corium, c u i r ; allusion nu suc a s trin g en t employé p a r les ta n n eu rs .
Arbuste à feuilles opposées. Fleurs régulières, hermaiihroditos ou polygames
; calice 3 divisions; pétales o, petits, glanduleux, a l ternant avec les
sépales; étamines diplostémones, à anthères biloculaires, longitudinalement
déhiscentes, carpelles libres, alternipétales, k 3 loges à 1 ovule solitaire,
descendant; micropylo supérieure. Fruit formé de 3 carpelles se sé p a ra n t
à la matur ité en autant de fruits secs, indéhiscents, à 1 graine res tant
enveloppée p a r la corolle acorescenle, devenue charnue, et p a r le calice
membraneux, de manière à ressembler à une baie. Graine exalbuminée.
On connaît 3 ou 4 espèces de Carroyère, hab i tant la région méditerranéenne,
1 .Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L’espèce suivante
nous intéresse particulièrement ;
C. à fe u ille s de m y r te . — C. MA RTIFOLIA Lmk. Encycl. tab. 822, —
AVals. Dendr. H, tab. 103. — Spach, Vég. Ph an. VI, p. 33. — Math. Fier,
forest, p. 46. — Vulg, /tedoul, Goriaire, fjcrhe aux tanneurs. — Hegiun
méditerranéenne.
Arbrisseau de 2-3 mètres, touffu; écorce gris cendré, relevée sur les
rameaux, de 4 côtes subéreuses et de pustules gris roussâtre. Ramifications
opposées, souvent même verticillées en raison des nombreux bourgeons
axillaires. — Feuilles simples, opposées ou ternées, cour temenl pétiolées,
ovales algues, entières et glabres. — Fleurs petites, vertes, disposées en
grappes dressées, terminales, sortant des bourgeons latéraux. Pétales g l a n C
O R RO Y È R E 231
duleux, plus courts que le calj-ce ; stigmates o, longs, filiformes. — Fruit
vert, puis noir luisant, bacciforme. — Bois, blanc roussâtre â zone poreuse
de pr in temps et zone compacte d ’automne ; rayons inégaux, assez larges.
Lo Itedoul se rencontre dans tout le midi de la Franco et le bassin méditerranéen,
dans les lieux incultes, sur le bord des chemins, des taillis et des
baies; il est mémo assez rustique pour pouvoir venir en pleine ter re sous le
climat de Paris. Il no semble manifester aucune préférence pour la nature
minéralogiquo d u . s o l ; la souche rejette abondamment, mais les nombreuses
liges qu’elle donne dépérissent au bout do ([uebiues années ; ses
racines émettent aussi de nombreux drageons, do sorte que c’est une
plante envahissante. En raison même de cotte propriété on peut l’employer
avantageusement pour boiser les tains, les remblais, los atterrissements cl
les ter rains on pente.
E’écorce, les feuilles, los jeunes pousses e l l e s sommités du lledoul contiennent
une grande quantité de tannin que l’on utilise p our la préparation
des cuirs fins, dits maroquins; souvent aussi on l'associe, ou mémo il est
substitue, au Sumac et â l’écorce de chêne dans la proportion de 1/4 à 1/3 ;
lo tan qui contient du Redoul est, disent les lanneur.s,- p lus nourri, c ost-â-
dire plus actif, mais le cuir ainsi obtenu est de moindre qualité.
Pour exploiter le Redoul, eu vue de l’obtention du tan, on coupe simplement
2 - 3 fois par an les jeunes liges que l ’on met à sécher comme du
fourrage et que l ’on pulvérise ensuite au moyen d ’uno meule ordinaire ve r ticale
; on passe la poudre obtenue au tamis, afin d ’en séparer les débris de
bois et les fibres sans valeur. On'o bt ien t ainsi une poudre plus ou moins
fine, douce au toucher , à odeur herbacée.
Cotte poudre peut aussi, combinée avec l ’acUon des sels de fer, fournir
une teinture noire.
Bien que le //edou/forme l’objet d'uu assez grand commerce en Espagne,
au Maroc et en Algérie, il n ’est cependant pas cultivé d ’une manière
spéciale; on se contente de récolter celui qui vient spontanément dans
les lieux incultes. Cependant, cette culture serait dans certains cas
avantageuse; on pour rait facilement l'établir sur des ter rains légers, siliceux,
comme étant ceux qui favorisent le plus le cjrageonneinent. On pour rail
le multiplier, soit pa r des plants obtenus de graines, soit pa r des d r a geons
récoltés sur des pieds existants. On pour rait faire aussi des champs
que l’on faucherait, à la manière de la luzerne p a r exemple, un nombre
do fois dans l'année, v a r ian t avec le climat ot la vigueur de la végétation.
Les fruits, et même les feuilles contiennent un principe cri.stallisable ot
âcre appelé coriarine, très vénéneux, amenant la mor t en quelques heures,
dans d ’affreuses convulsions accompagnées de délire. Pujades rappor te
que plusieurs soldats, lors de la campagne d'Espagne au commencement
du siècle, furent ainsi empoisonnés. Le Redoul produit sur les animaux,
notammen t sur les moutons, qui ont l’imprudence d ’en brouter, une action
énivrante que les b ergers du midi guérissent au moyen d ’aspersions d ’eau
l ! '
I l
i j
i 'i |
' ' 4
" i i
f e
i
“'•I
n i
n
! < I
■I’