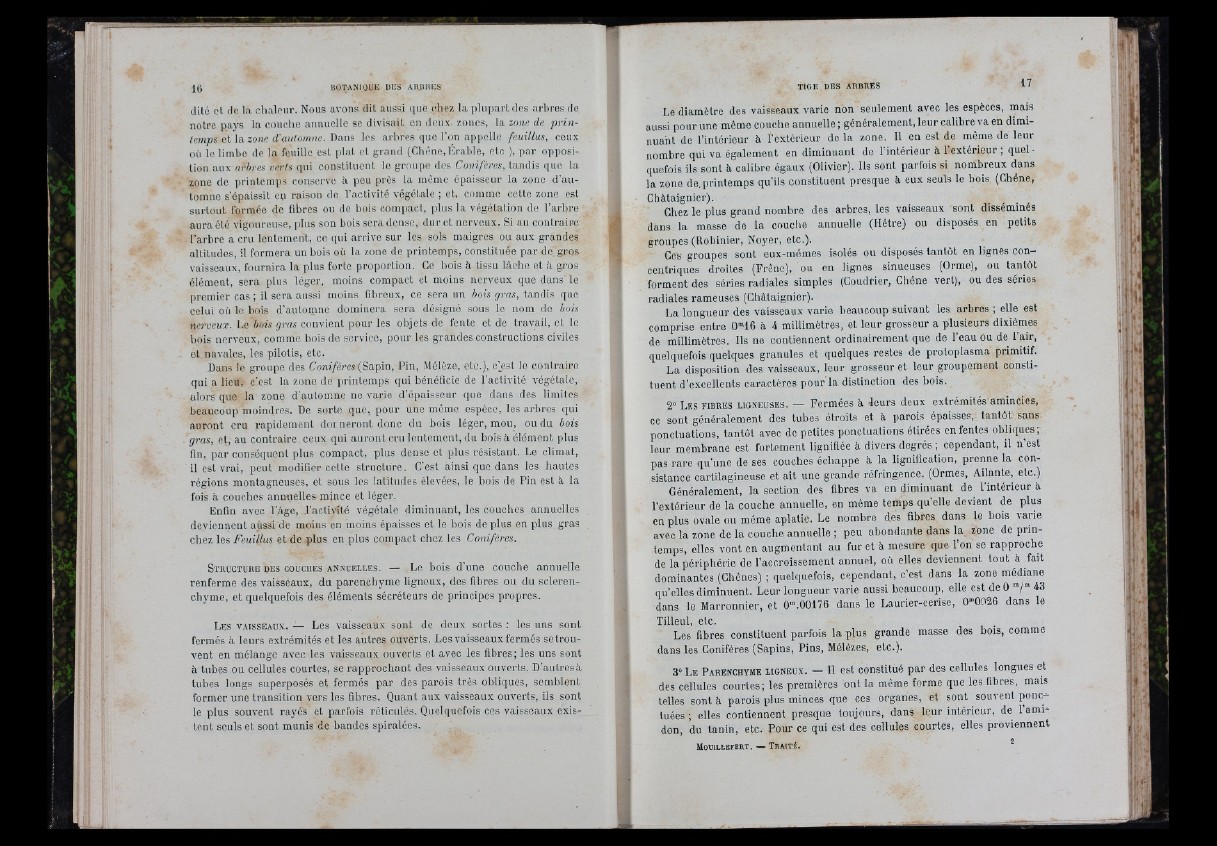
K) BOTANIQUE DES ABBBES
dite ct de la clialciir. Nous avons dit aussi (¡ue chez la plup a r t dos arbres do
notre pays la concbe annuelle se divisait en deux zones, la zone de p r in temps
et la zone d'automne. Dans les arbres (lue l’on apiicllo feuillus, ceux
où le limbe de la feuille est plat et grand (Cbêno, Érable, etc ), p a r opposition
aux arbres verts qui consliluont le groupe des Conifères, tandis que la
zone de pr intemps conserve à peu près la même épaisseur la zone d ’au tomne
s’épaissit on raison de l'activité végétale ; et, comme celte zone est
surtout formée de fibres ou de bois compact, plus la végétation do l’arbre
aura élé vigoureuse, plus son bois sera dense, du r et nerveux. Si au contraire
l’arbre a cru lentement, ce qui arrive sur les sols maigres ou aux grandes
altiludes, il formera un bois où la zone de pr intemps , constituée p a r do gros
vaisseaux, fournira la plus forte proportion. Ce bois à tissu lâche et à gros
clément, sera plus léger, moins compact et moins nerveux que dans le
premier cas ; il sera aussi moins fibreux, ce sera un bois gras, tandis que
celui où le bois d’automne dominera sera désigné sous lo nom de bois
nerveux. Le bois gras convient pour les objets de fonte et de travail, ot lo
bois nerveux, comme bois de service, pour les grandes constructions civiles
et navales, les pilotis, etc.
Dans lo groupe des Cont/èrcs (Sapin, Pin, Mélèze, etc.), c'_ost le contraire
qui a lieu, c’est la zone de pr intemps qui bénéficie de l’activité végétale,
alors que la zone d’automne ne varie d ’épaisseur que dans dos limites
beaucoup moindres. De sorte que, pour une même espèce, les arbres qui
auront cru rapidement d o rn e ro nt donc dn bois léger, mou, ou du bois
gras, et, au contraire, ceux qui au ro n t cru lentement, du bois à élément plus
fin, p a r conséquent plus compact, plus dense ot plus résistant. Le climat,
il est vrai, peut modifier cette s tructure. C'est ainsi que dans les hautes
régions montagneuses, et sous les latitudes élevées, le bois do Pin est à la
fois à couches annuelles mince et léger.
Enfin avec l'âge, raclivité végétale diminuant, les couches annuelles
deviennent aussi de moins en moins épaisses et le bois de plus en plus gras
chez les Feuillus et do plus en plus compact chez les Conifères.
S t r u c t u r e d e s c o u c h e s a n n u e l l e s . — Le bois d ’une couche annuelle
renferme des vaisseaux, du parench yme ligneux, des fibres ou du scleren-
chyme, et quelquefois des éléments sécréteurs de principes propres.
L e s v a i s s e a u x . — Les vaisseaux sont de deux sortes : les uns sont
fermés à leurs extrémités ot les autres ouverts. Les vaisseaux fermés se trouvent
en mélange avec les vaisseaux ouverts et avec les fibres; les uns sont
à tubes ou cellules courtes, se r ap p ro c h an t des vaisseaux ouverts. D’autres à
tubes longs superposés et fermés p a r des parois très obliques, semblent
former une transition vers les fibres. Quant aux vaisseaux ouverts, ils sont
le plus souvent rayés ct parfois réticulés. Quelquefois ces vaisseaux existent
seuls et sont munis de bandes spiralées.
Le diamètre des vaisseaux varie non seulement avec les espèces, mais
aussi pour une même couche annuelle ; généralement, leur calibre va en diminuant
de l’intérieur â l'extérieur do la zone. Il on est de même de leur
nombre qui va également en diminuant de l'intérieur à l’extérieur ; q u e l quefois
ils sont à calibre égaux (Olivier). Ils sont parfois si nombreux dans
la zone de.pr intemps q u ’ils constituent presque à eux seuls le bois (Chêne,
Châtaignier).
Chez le plus grand nombre des arbres, les vaisseaux sont disséminés
dans la masse de la couche annuelle (Hêtre) ou disposés en petits
groupes (Robinier, Noyer, etc.).
Ces groupes sont eux-mêmes isolés ou disposés tantôt en lignes concentriques
droites (Frêne), ou en lignes sinueuses (Orme), ou tantôt
forment des séries radiales simples (Coudrier, Chêne vert), ou des séries
radiales rameuses (Châtaignier).
La longueur des vaisseaux varie beaucoup suivant les arbres ; elle est
comprise entre O-^lô à 4 millimètres, et leur grosseur a plusieurs dixièmes
de millimètres. Ils ne contiennent ordinairement que de l’eau ou de l’air,
quelquefois quelques granules et quelques restes de protoplasma primitif.
La disposition des vaisseaux, leur grosseur et leur groupement constituent
d ’excellents caractères pour la distinction des bois.
2° L e s f i b r e s l i g n e u s e s . — Fermées à leur s deux extrémités amincies,
ce sont généralement des tubes étroits ot à parois épaisses, tantôt sans
ponctuations, tantôt avec de petites ponctuations étirées en fentes obliques;
leur membrane est fortement lignifiée à divers degrés ; cependant, il n ’est
pas ra re qu’une de ses couches échappe â la lignification, prenne la consistance
cartilagineuse et ait une grande réfringence. (Ormes, Allante, etc.)
Généralement, la section des fibres va en diminuant de l ’intérieur à
l’extérieur de la couche annuelle, en même temps q ue l le devient de plus
en plus ovale ou même aplatie. Le nombre dos fibres dans le bois varie
avec la zone de la couche annuelle ; peu abondante dans la zone de pr intemps,
elles vont en augmentant au fur ct à mesure que l’on se rapproche
do la pér iphérie de l’accroissement annuel, où elles deviennent tout à fait
dominantes (Chênes) ; quelquefois, cependant, c’est dans la zone médiane
qu’elles diminuent. Leur longueur varie aussi beaucoup, elle est de 0 “ / “ 43
dans lo Marronnier, et 0“ .00176 dans le Laurier-cerise, 0”0026 dans le
Tilleul, etc.
Les fibres constituent parfois la plus grande masse des bois, comme
dans les Conifères (Sapins, Pins, Mélèzes, etc.).
3" Le P a r e n c h y m e l i g n e u x . — Il est constitué p a r des cellules longues et
des cellules courtes; les premières ont la même forme que les fibres, mais
telles sont à parois plus minces que ces organes, et sont souvent ponctuées
; elles contiennent presque toujours, dans leur intérieur, de 1 ami^
don, du tanin, etc. Pour ce qui est des cellules courtes, elles proviennent
M o ü i l l e f e r t . — T r a i t é . ^
iM.l
) il
I:
M' ‘^1
i