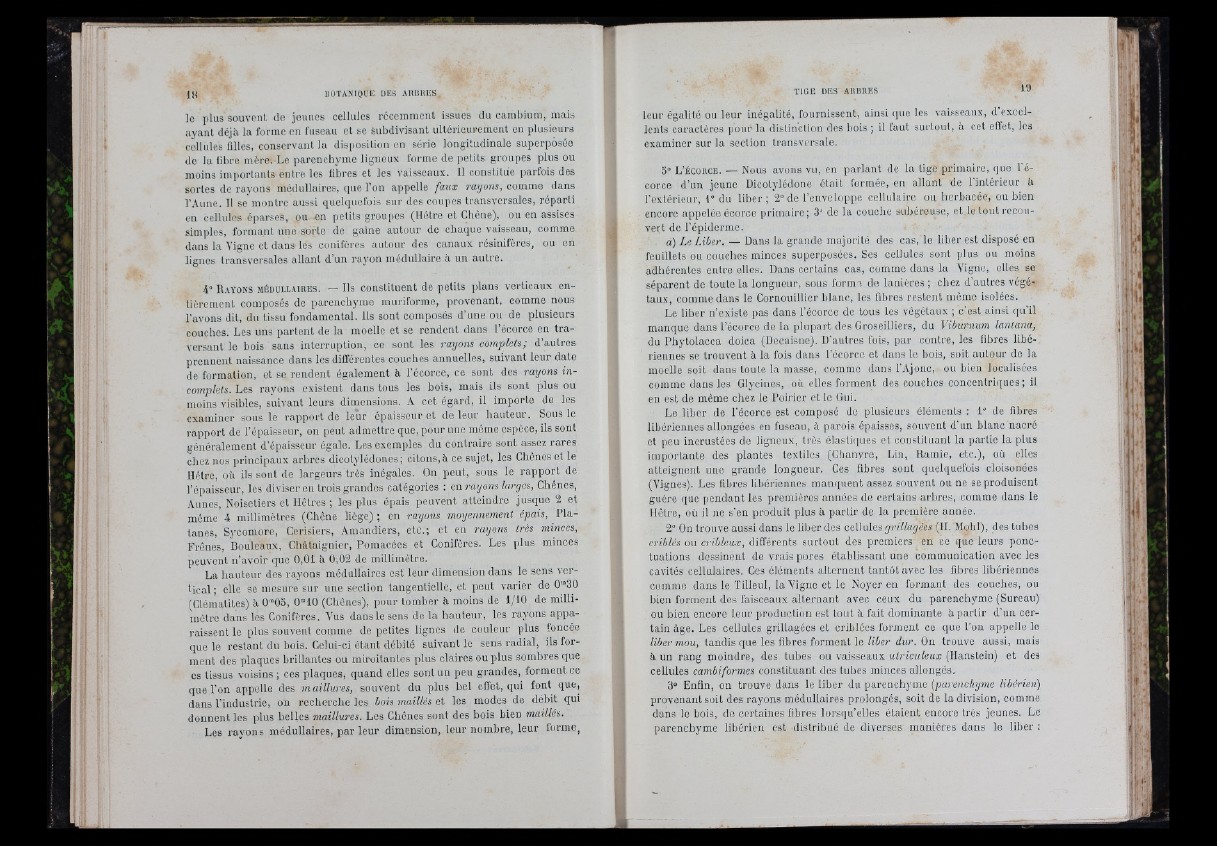
lo plus souvent do jeunes cellules récemment issues du cambium, mais
ayant déjà la forme en fuseau et se subdivisant iiltériourenient en plusieurs
cellules lillcs, conservant la disposition en série longitudinale superposée
do la libre mòro. Le parenchyme ligneux forme de petits groupes plus ou
moins imiiortanls entre les libres ot les vaisseaux. 11 constitue parfois des
sortes de rayons médullaires, que l’on appelle fa u x rayons, comme dans
l’Aune. Il so montre aussi quelquefois sur des coupes transversales, répar ti
en celbilos éparses, ou en petits groupes (Hêtre et Chêne), ou en assises
simples, formant uno sorte do gaine autour do chaque vaisseau, comme
dans la Yiguo ct dans les conifères autour dos canaux résinifères, ou en
lignes transversales allant d ’un rayon médullaire à un autre.
4» R a ï o n s m é d u u a i r e s . — Ils constituent de petits plans verticaux entièrement
composés de parenchyme muriforme, provenant, comme nous
l'avons dit, du tissu fondamental. Ils sont composés d ’une ou de plusieurs
couches. Los uns par tent de la moelle et se rendent dans l’écorce en t r a versant
le bois sans interruption, ce sont les rayons complets; d ’autres
prennent naissance dans les différentes couches annuelles, suivant leur date
de formalion, el se r endent également à l’écorce, ce sont des rayons in complets.
Les rayons existent dans tous les bois, mais ils sont plus ou
moins visibles, suivant leurs dimensions. .A cet égard, il importe de les
examiner sous le rap por t de leur épaisseur et de leur h au teu r . Sous le
rap p o r t de l’épaisseur, on peut admettre que, pour une môme espèce, ils sont
généralement d ’épaisseur égale. Les exemples du contraire sont assez rare s
chez nos pr incipaux arbres dicotylédones; citons,à ce sujet, les Chênes et le
Hêtre, où ils sont de largeurs très inégales. On peut, sous le rap p o r t de
l ’épaisseur, les diviser en trois g randes catégories : e n ra y o n s larges, Chênes,
Aunes, Noisetiers ct Hêtres ; les plus épais peuvent atteindre jusque 2 et
même 4 millimètres (Chêne liège) ; en rayons moyennement épais, P la tanes,
Sycomore, Cerisiers, Amandiers, etc.; et en rayons très minces,
Frênes, Bouleaux, Châtaignier, Pomacécs et Conifères. Les plus minces
peuvent n ’avoir que 0,01 à 0,02 de millimètre.
La h au teu r des rayons médullaires est leur dimension dans lo sens v e r tical
; elle se mesure sur une section tangenlielle, et peut var ier de 0'“30
(Clématites) à 0'“0o, 0 ” 10 (Chênes), pour tombe r à moins de 1/10 de millimètre
dans les Conifères. Vus dans le sens do la hauteur , les rayons app a raissent
le plus souvent comme de petites lignes do couleur pins foncée
que le restant du bois. Celui-ci étant débité suivant le sens radial, ils forment
des plaques brillantes on miroitantes plus claires ou plus sombres que
es tissus voisins ; ces plaques, quand elles sont un peu grandes, forment ce
que l’on appelle des maillures, souvent du plus bel effet, qui font que,
dans rinduslr ie, on reche rch e les bois maillés ot les modes de débit qui
donnent les plus belles maillures. Les Chênes sont des bois bien maillés.
Les r ay on s médullaires, p a r leur dimension, leur nombre, leur iorme,
leur égalité ou leur inégalité, fournissent, ainsi que les vaisseaux, d excellents
caractères pour la (lislinction des bois ; il faut surtout, à cet effet, les
examiner sur la section transversale.
o" L ’é c o r c e . — Nous avons vu, en par lan t de la Lige primaire, que 1 é-
corce d ’un jeune Dicotylédono était formée, en allant de l'inléricur à
l'extérieur, t° du liber ; 2“ de l'enveloppe cellulaire ou herbacée, ou bien
encore appelée écorce primaire; S-" de la couche subéreuse, ot le tout recouvert
de l ’épidermc.
a) Le Liber. — Dans la grande major ité des cas, lo liber est disposé en
feuillets ou couches minces superposées. Ses cellules sont plus ou moins
adhérentes entre elles. Dans certains cas, comme dans lu Vigne, elles so
séparent do toute la longueur, sous forme do lanières ; chez d ’autres végétaux,
comme dans lo Cornouillier blanc, les fibres restent mémo isolées.
Le liber n ’existe pas dans l ’écorce de tous les végétaux ; c'est ainsi qu'il
manque d a n s l ’écorce de la plupar t des Groseilliers, du Viburnum lantana,
du Pbytolacca doica (Decaisne). D'autres fois, p a r contre, les fibres libériennes
sc trouvent à la fois dans l ’écorce et dans lo bois, soit autour do la
moelle soit dans toute la masse, comme dans l’Ajonc, ou bleu localisées
comme dans les Glycines, où elles forment des couches concenlriques ; il
en est de même chez le Poirier et lo Gui.
Le liber de fécorce est composé de plusieurs éléments : l ” do fibres
libériennes allongées en fuseau, â parois épaisses, souvent d'un blanc nacré
ot peu incrustées do ligneux, très élastiques ct constituant la partie la plus
impor tante des plantes textiles (Chanvre, Lin, Ramie, etc.), où elles
atteignent une grande longueur. Ces fibres sont quelquefois cloisonées
(Vignes). Les fibres libériennes manquent assez souvent ou ne se produisent
guère que pendant les premières années de certains arbres, comme dans le
Hêtre, où il no s'en produit plus à partir de la première année.
2° On trouve aussi dans le liber dos cellules grillagées (II. Mohl), des tubes
criblés ou cribleux, différents sur tout des premiers en ce que leurs ponctuations
dessinent de vrais porcs établissant une communication avec les
cavités cellulaires. Ces éléments alternent tantôt avec les libres libériennes
comme dans lo Tilleul, la Vigne et le Noyer en formant des couches, ou
bien forment des faisceaux a l ternant avec ceux du parenchyme (Sureau)
ou bien encore leur production est tout à fait dominante à p ar tir d’un certain
âge. Les cellules grillagées et criblées forment ce que l ’on appelle le
liber mou, tandis que les fibres forment le liber dur. On trouve aussi, mais
à un rang moindre, des tubés ou vaisseaux u lricu leu x (Hanstein) et des
cellules cambiformes constituant des tubes minces allongés.
3“ Enfin, on trouve dans le liber du parenchyme [parenchyme libérien)
provenant soit des rayons médullaires prolongés, soit de ladivis ion, comme
dans le bois, do certaines libres lor squ’elles étaient encore très jeunes. Le
parenchyme libérien est distribué de diverses manières dans le liber :
'l i. I. *
i.
*1
n!t I
11]
:w l
i' ) <1
Ii!
f