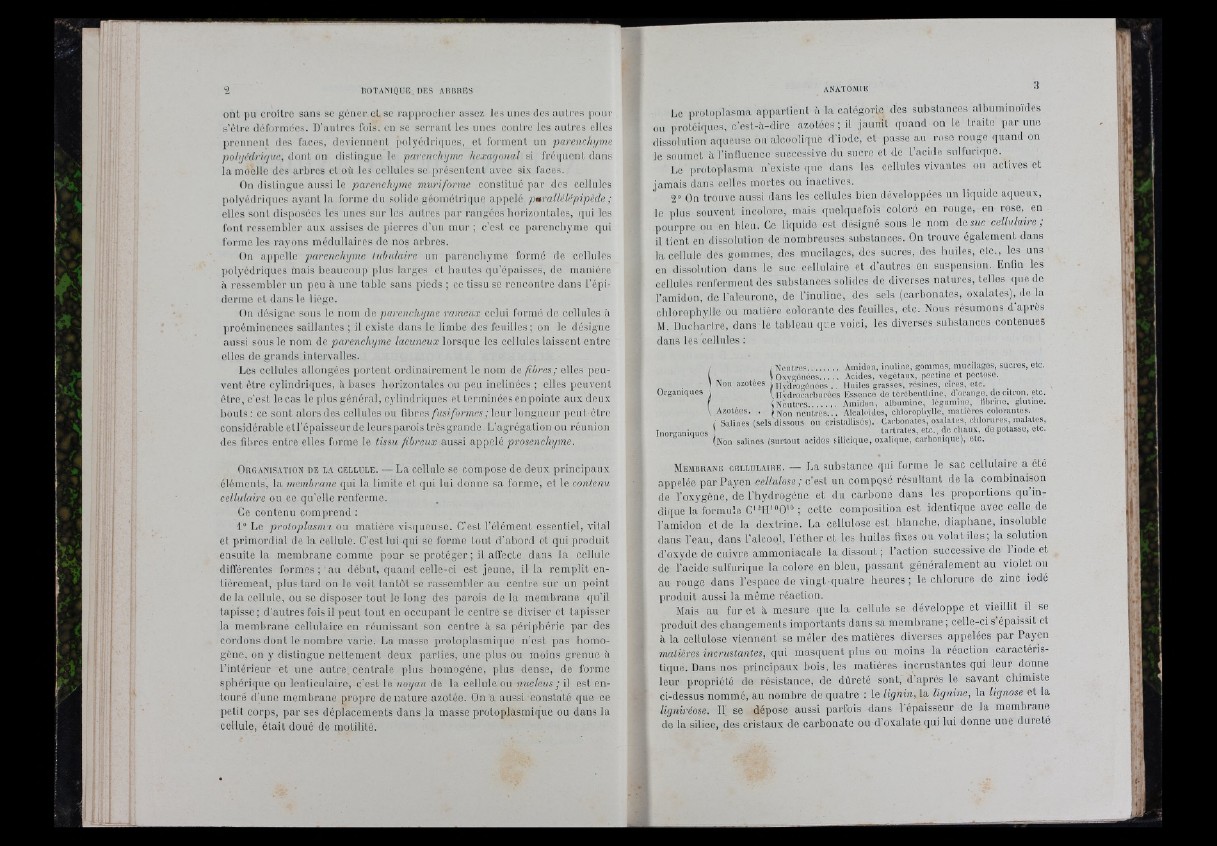
üiil pu croître sans so gciirr et sc ra]i|>i'orlicr assez Jes unes îles aulres iimir
s’clro (léfornircs. D'aiilrcs fois, en se serrant les unes conlro les autres elles
prennent des faces, deviennent polyédriipies, et foriuent un parcnclnjme
poliji'diiqiic, dont on dislinguo le pareiif/ujine hexagonal si fréquent dans
la moelle des arbres el où les cellules se.présentent avec six faces.
On distingue aussi le parenchyme muriforme constitué par des cellules
|)olyédri([ues ayant la forme du solide géométrique a|)pclé 'parallélépipède ;
elles sont disposées les nncs sur les aulres par rangées liorizonlales, qui les
font ressembler aux assises de pierres d'uu mur ; c’est ce pnrencliymo (pii
forme les rayons médullaires do nos arbres.
Du appelle parenchyme lahahnre un parenchyme formé do cellules
jHilyédriques mais beaucoup |)lus larges ol liaulcs (pécpaisses, do manière
il ressembler un peu à une lablc sans pieds ; ce tissu se rcnconlre dans l’épi-
dcrmc el dans le liège.
On désigne sous le nom de parenchyme ramenx celui formé do cellules à
proéminences saillantes ; il existe dans le limbe des feuilles; on le désigne
aussi sons le nom do parenchyme /«cimcuat lorsque les cellules laissent entre
elles de grands intervalles.
Los cellules allongées portent ordlnairemenl le nom de fibres; elles p euvent
être cylindriques, à bases hor izontales ou peu inclinées ; elles peuvent
être, c'est lecas le ¡ ilusgénéral, cylindrii|ucs el lcrmiiiécscnpointe aux deux
bouts : ce sont alors des cellules ou lilires fusiformes; leur longueur peut èlre
considérable cU’épais seurde leur sparois lrèsgrandc. L’agrégation ou réunion
des libres entre elles forme le lissa fibreux aus.si appelé prosenchyme.
O r g am s .i t io n d e l a c e l l u l e . — La cellule ae compose de deux principaux
cléments, la membrane qui la limite el qui lui douiio sa forme, ol le contenu
cellulaire ou ce qu'elle renferme.
Ce contenu comprend :
1“ Le proloplasnvi ou matière vis([ueuso. C'est ré lémen t essentiel, vital
et primordial do la cellule. C'est lui (|ui se forme tout d'abord et qui produit
ensuite la membrane comme pour se protéger ; il aiïcclo dans la cellule
did'érenlos formes ; au début, quand celle-ci est jeune, i l i a remp l it entièrement,
plus lard on le voit tantôt se rassembler au contre sur un point
de la cellule, ou se disposer tout le long des parois de la membrane qu'il
tapisse; d'autres fois il jieut tout on occupant lo centre se diviser ct tapisser
la membrane cellulaire en réunissant son centre à sa périphérie p a r des
cordons dont le nombre varie. La masse protoplasmiquo n'est pas lionio-
gène, on y distingue ne t temen t deux parlies, uno plus ou moins grenue à
l ’intérieur cl une autre centrale plus lioinogèno, plus dense, de forme
sphérique ou lenticulaire, c’est le noyau de la cellule ou nucleus ; il est entouré
d'une membrane propre d e n a tu r e azotée. On a aussi constaté que ce
petit corps, p a r ses déplacements dans la masse proloplasmique ou dans la
cellule, était doué de raolilité.
IjO protoplasma appar tient à la oatcgorio dos subs tances albumiiio'ides
ou protéiques, c’est-ii-diro azotées ; il jaunit ([uand on le traite par une
dissolution aqueuse ou alcooliiiue d'iode, ct passe au rose rouge (¡uand on
le soumet à l’iiillucnce successive du siirrc ol do l'acide sulfuriqno.
Le ¡u’otoplasma n'existe i[uc dans les cellules vivantes ou actives et
jaiTiais dans celles mortes ou inactives.
2» On trouve aussi dans les cellules bien développées nu liquide aqueux,
10 ¡iliis souvent incolore, mais (¡uoliiuefois coloré en rouge, en rose, en
pourpre ou en bleu. Ce liquide est désigné sous le nom do suc cellulaire ;
11 fient en dissolution de nombreuses substances. On trouve également dans
la cclUilc des gommes, des mucilages, des sucres, dos huiles, etc., les uns
en dissolution dans lo sue cellulaire ct d ’autres ou susiionsion. lintin les
cellules renferment des substances solides de diverses natures, telles que do
l'amidon, de l'alourone, do l’inuline, des sels (carbonates, oxalates), de la
chlorophylle ou matière colorante des feuilles, etc. Nous résumons d'après
M. Ducliarlre, dans lo tableau que voici, les diverses substances contenues
dans les cellules :
Organiques
Inorganiques
, Neutres.............. Amidon, inuline, gommes, mucilages, sucres, etc.
^OxYgcnées Acides, végétaux, pectine et pectose.
I Non azotées i Uydpogcnées .. Huiles grasses, résines, cires, etc.
I Ulydrocarbnrées Essence de térébentliinc, d'orange, do citron, etc.
(Neutres Amidon, albumine, Icgnmine, fibrine, gliuine.
Azotées. . ( Non n e u tre s ... Alcaloïdes, cliloropliylle, matières colorantes,
( S.iliiies (sels'dissous ou cristallisés), llarbonates, oxidates, chlorures, mal.itcs,
' ta rtrate s, etc., de cliaux, de potasse, etc.
(nou salines (surtout acides silicique, oxalique, carbonique), etc.
M em b ra n e c e l l u l a i r e . — La substance qui forme le sac cellulaire a été
appelée p a rP a y e n cellulose; c’est uu compQsé résultant de la combinaison
de l’oxygène, de l'hydrogène et du carbone dans les proportions q n ’in-
diqiie liï formule C'-H'OO'» ; celte composition est identique avec celle de
l’amidon et de la dextrine. La cellulose est blanclie, diaphane, insoluble
dans l’eau, dans l'alcool, l'é tlier et les bulles fixes ou v o la t i le s ; la solution
d ’oxyde do enivre ammoniacale la dissout ; l’action successive do 1 iode et
de i’acide sulfurique la colore en bleu, pas sant généralement au violet ou
au rouge dans l’espace de vingt-quatre h e u r e s ; le chlorure de zinc iodé
produit aussi la même réaction.
Mais an fur ot à mesure que la cellule se développe et vieillit il se
produit des changements importants dans sa m embran e ; celle-ci s’épaissit et
à la cellulose viennent se mêler des matières diverses appelées p a r Paycn
matières incrustantes, qui masquent plus ou moins la réaction caractéristique.
Dans nos principaux bois, les matières incrustantes qui leur donne
leur propriété de résistance, de dûreté sont, d ’après le savant chimiste
ci-dessus nommé, au nombre de quatre : le ligniti, la lignine, la tignose el la
ligniréose. Il se dépose aussi parfois dans l'épaisseur de la membrane
de la silice, des cristaux de carbonate ou d'oxalale qui lui donne une dureté