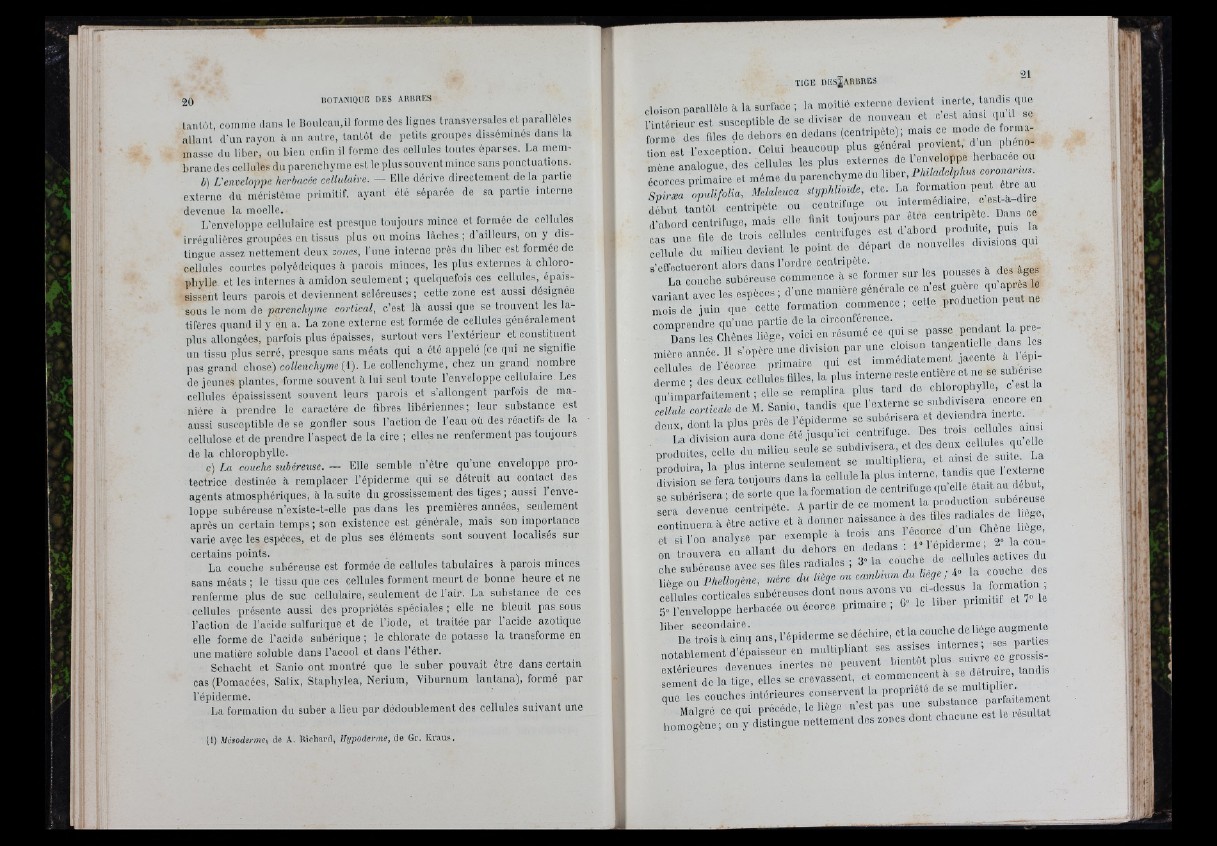
TlGlî IJ llESÏARimES
20 IIOTANIOI'E DES ARRHES
lanl.'.t, CD.IIIIIO dans le iioulran,il l'onne des lignes transversales cl iinrallèlcs
allant d'mi ravon à nn autre, tantôt do petits grimpes disseluunés dans la
masse dn liber, ou bien cniin il l'orme des cellules toulos éparses. La membrane
des cellules du parcuchymo est le plus souvent mince sans ponctuations.
b) L'enveloppe herbacée cellulaire. — Elle dérive directement do la parlio
externe dn méristème primitir, ayant été séparée do sa partie interne
devenue la moelle.
L’enveloppe cellulaire est presque toujours mince el formée do cellules
irrégulières groupées en tissus ¡ilus ou moins lâche s ; d ’ailleurs, on y distingue
assez nettement deux zones, l'nne interne près du liber est formée do
cellules courtes polyédriiiuos à parois minces, les plus externes â chlorophylle
et les internes à amidon seulement ; quelipiefois ces cellules, épaississent
leurs parois et deviennent scicreuses; cette zone est aussi désignée
sous le nom de parenchyme cortical, c’est là aussi que se trouvent les la-
tifères quand il y en a. La zone externe est formée do cellules généralement
plus allongées, parfois plus épaisses, surtout vers l’extérieur et coiistiliicnt
1111 tissu plus serré, presque sans méats qui a élé appelé (ce qui ne signilie
pas grand chose) collenchyme{l). Lo colloncbynio, chez un grand nombre
de jeunes iilaiites, forme souvent à lui seul toute l’enveloppe colUilairo, Los
cellules épaississent souvent leurs parois et s 'allongent parfois do ma nière
il prendre lo earactèro do fibres liliériennes; leur substance est
aussi susceptible do se gonfler sous l ’action de l’eau où des réactifs de la
cellulose et do prendre l ’aspect de la cire ; elles ne renferment pas toujours
de la chlorophylle.
c) La couche subéreuse. — Elle semble n ’être q u ’une enveloppe p ro tectrice
destinée à remplacer l’épiderme qui so délruil au contact des
agents atmosphériques, à la suite du grossissement des tiges ; aussi l’enveloppe
subéreuse n ’existe-t-elle pas dans les premières années, seulement
après un cer tain temps ; son existence est générale, mais son importance
varie avec les espèces, et de plus ses éléments sont souvent localisés sur
certains points.
La couche subéreuse est formée de cellules tabulaires k parois minces
sans méats ; le tissu que ces cellules forment meur t de bonne heure et ne
renferme plus do suc cellulaire, seulement de l'a ir. La substance do ces
cellules présente aussi dos propriétés spéciales ; elle ne bleuit pas sous
l ’action de l ’acide sulfurique et de l’iode, et traitée pa r l’acide azotique
elle forme de l ’acide subérique ; le chlorate de potasse la transforme en
une matière soluble dans l ’acool ct dans 1 éther.
Schacbt el Sanio ont montré que le suber pouvait être dans certain
cas (Pomacées, Salix, Staphylea, Nerium, Viburnum lantana) , formé p a r
l'épidorme.
La formation dn suber a lieu p a r dédoublement des cellules suivant une
(1) SIcsoderme, de A. Richard, Ihjpodenne, de Gr. Kraus,
cloison parallèle à la surface ; la moitié externe devient inerte, tandis que
l'inlorieur est susceptible de se diviser do nouveau cl c est ainsi qn d so
forme des Mes de dehors en dedans {centripète); mais ce mode do foi ma-
I st ’exception. Celui beaucoup plus général provient, d u n pheno-
I n l b i im e des cellules les plus externes de l ’enveloppe horbacee ou
mene °; ' du parenchyme du Vdmy Philadelphus coronarius.
c ^ L m M l m i l i e u devient le point de départ de nouvelles divisions qui
«'effectueront alors dans l’ordre centripète.
La couche suborouso commence à so former sur les pousses à dos âges
r iant avec les espèces ; d ’une manière générale ce n est guère qu après le
i S f i r c .i™ a iU™ » P-i- ‘ 7 , ' “
w im m m r n
' nruduitos celle du milieu seule so subdivisera, et dos deux cellules qu e le
DeT ro ë S Mim ans, l’épidorme se déchire, et la couche de liège augmente
no tablement d’épaisseur en multipliant
,|„c k . coutil», iolicloore. comorïcol » Srt.lioniont
*1
I i!
J :l
Ii I i , I
i î |
j ’
< h . '<1
p .
ù '-.,1