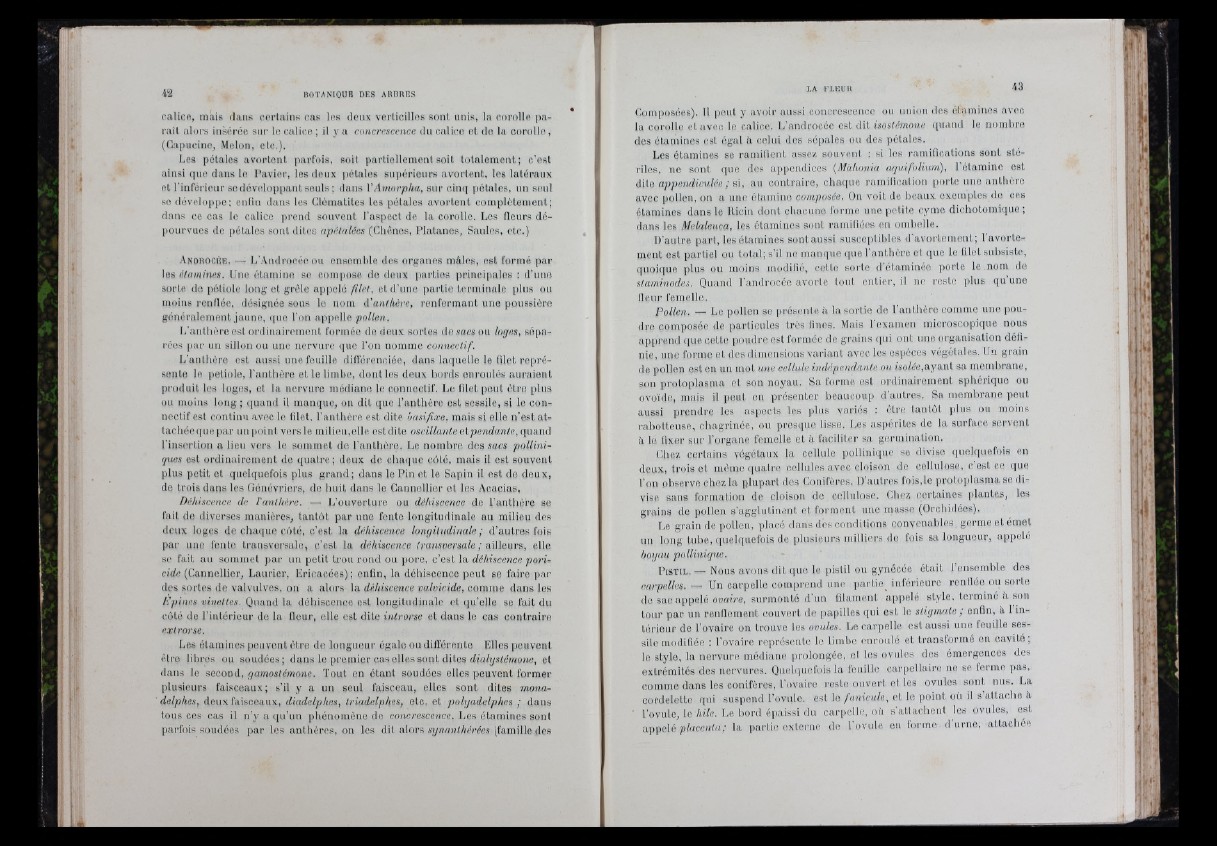
Vi nOTANlQUR niìS AHIÌIIRS
l'alice, mais clans cer tains cas les deux verlicilles sonl unis, la corolle ¡m-
rail alors insérée sur le calice ; il y a c o n c re s c e n c e du calice el de la co rn i le ,
(Ga|meiiie, Melon, etc.).
Les pétales avortent parfois, soit parliollemeiil soit totalement; c'est
ainsi (|oe dans le l'avier, les deux iiiHales supérieurs avorlent, los latéraux
el l'iiifei-leur so développant seuls ; dans VAninrpha, sur cini| pétales, uu seul
KO (lévclo|)pe; eidiu dans les Clématites los pélalos avortent complètement;
dans ce cas lo calice lu-eud souvent l'aspocl de la corolle. Les lleurs dé-
liourvuos de [létales soul dites iipéfiilécs (Chênes, l’iatanos, Saules, oie.)
.\NOiiociiii. — L'.Audi'océe ou onsouililo des organes mâles, est formé [lar
los liliimines. Uue étamine se eomiiose do doux parties [irincipules : d ’uiio
sorte do pétiole long et grêle aiqielé /ìlei, et d ’ime partie terminale plus ou
muius roullée, désignée sous le uciiu d'nulltère, l'eiiferiuaul uue poussière
géiiéralemeut jaune, ipie l'on a|ipelle pollen.
l /ai i thère est oi'd inairement formée de cioux sortes de .sncs ou loge s, séparées
par uu sillon ou uue nervure i|ue l'on nomme c o n n e e lif .
L’unlhèro est aussi une fouille dillëreueico, dans laquelle le liloL roprè-
suiile lo |iotiole, l 'authère et lo liiulie, dont les doux liords oiiroiilès auraient
pruduit les loges, ot la nervure médiane le eonuoclif. Le lilet peut être [dus
ou iiioius long ; c|iuuid il mamiue, ou dil ([iio l’authère est sessile, si le coii-
neclif est coiiliim avec le lilet. l'aullière est dite h a s i/i.re . mais si elle u ’osl at-
laclié(M|uepar iiiipoinl verslo milieu,elle esLdile o s c il la n te oA p c n d o n l e , eywimd
l’iuserlioii a lieu vers le sommet de l'antlièro. Lo nombre des sa c s p o l l i n i -
i/ues est ürdiuaircmoiit de ([iiatre; doux de cliai|uo cûlè, mais il est souvent
[ibis petit ot ([uelquefois [dus gran d; dans le l’iii et lo Supin il est do deux,
de trois dans los (¡eiièvriers, de huit dans le Gannellier et les Acacias.
Déhiscence de l'anthère. — l/ouvortnre. ou déhiscence de raulbèi'e se
fait de diverses manières, tantôt par uue fente loiigiludinalo au milieu des
deux luges de. eliai|ue côté, c’est la déhiscence longitudinale ; d ’aulres fois
par une foute transversale, c’est la déhiscence ailleurs, elle
se fait au sommet jiar un pelit trou rond ou [loro, c’est la déhiscence pori-
(.'¡¿c (Caiiuellior, Laurier, llrieaeéos); eiilìii, la débisoenee [leut so faire [lar
des sortes de valvulves, ou a alors la déhiscence vahieide, comme dans los
h'pines oineltes. (Juaud la dcbiseciieo est bmgiludinale ef i|u’cllo so fuit du
côté de r iuté r iour de la Heur, elle esl dite inlrorsc et dans le cas contraire
extror.se.
I.es étamines ¡leuvent éire de lungiieur égale ou diH'éi’eiite Liles peuvent
être lilu'os ou soudées; dans lo [iroiuior cas elles simt dites (/¿«/i/.sièmo».«, ot
dans lo second, gamoslémone. Tout eu étant soudées elles peuvent former
[ilusieurs faiscouux ; s’il y a uu soul faisceau, elles soul dites mona-
delphos, deux faisceaux, diadelphes, triadelphes, oie. ct polgadelphes ; dans
tous ces cas il n ’y a ([u’un pliéiiomèno de concrescence. Los étaminns soul
[larfois soudées |iai' les autbèi’es, on les dil idors sgiianlhérées (famille des
U
I.A KLlîUll 43
Composées). Il peut y avoir aussi concrescence ou union des èlamiucs aveo
la cocollo et avec le calice. L'anilroc.éc est dit isostémnne i[uand le luimlirc
des étamines est égal â eehii dos sépales ou dos pétales.
Les étamiiios so l'amilioiit asse/, soiivcul : si les ramilicalions soul sle-
rilos, uo sont que des a[q)niidiccs {Màlumia ai/iiifolium), ré lamiu e est
d'dc appendieulée; si, au cimlraire, chaque rumilicatioii porte une aullière
avec [lüUeii, on a une étaïuiiio composée. Ou voil de lieaux oxeiu|iles de ces
étamines dans le Ricin dont cbacmio fucme une petite cymo diclioloiuique ;
dans les Melaleuca, les étamines sont ramiliéos en omlicllo.
D’autre pari, losélamiiies sonl aussi suscoplihios d'avortemeiil; l'avorl.e-
meiit csl [larliel ou lolal; s’il ne maïujiie iiuo raul l iè re ct ([uo le lilet sulisislc,
i|uoii|ue plus ou moins modilié, celle sorte d'élamiuée porte lo nom de
staininodes. Quand l'aiulrocéo avorlo loiil entier, il iic rcsle [»lus qu une
Heur femelle.
Pollen. — Le pollen so |irésciileii la sortie de l'anfbère comme uue |»ou-
dce composée de [»articules très linos. Mais l'cxamcu microsc.i»|)ii|ue nous
apprend (|ue celle poudre est fo rmée de grains ijui (»ul une organisation déli-
nie, une forme el des dimousioiis var iant avec les es|»èccs végétales. Un grain
de pollen osl en uu mol une cellide. indépendante ou isolée,ayiuù sa meml»rane,
S(»ii |»r(»to[»lasuia ct sou noyau. Sa f(»rme osl ordinairement s|»lieriquo ou
(»voïdc, mais il [»eut ou préseiilnr lioauc(»ii[» d ’autres. Sa mombraue peut
aussi [»rendre los us|»ecls les [»lus variés : être laulôl [dus ou moins
rabotteuse, chagrinée, ou presque lisse. Les usperiles do la surface sorveiil
il le lixcr sur rorgiuie tcmcllo cl à fucilitor sa germiiialiou,
Clio/. certains végétaux la cellule |»(»lliiiii[iie sc divise quelquefois en
deux, trois ct même quatre cellules avec cloison do ecibilose, c'est ce que
l'on i>hservo chez la [¡lu|iart des Conifères. D’aufros lois,lo [ii'olo|»lasma se divise
sans formation do cloison de cellulose. Chez certaines plantes, les
grains do pollen s'aggluLiuout ct formcul une masse (Orchidées).
Lo grain (le pollen, placé dans dos «»udilions convcualilcs, germe cl émet
uu long tube, (|Uolquefi»is de [»lusieurs milliers do fois su longueur, appelé
hoyau p o llin iq u e .
l ’ i S T i L . — Nous avons dit que lo [listil ou gynécée élait rcusomblc des
carpelles. — Un carpelle cmui»reiul une [»arlie_ inférieure rcniléo ou sorle
do. sue appelé oüuM'e, surmonté d'uu ülamoul appelé stylo, lormiué a son
tour p a r uu reuHomout couvert do papilles <[ui esl le stigmate. ; cnliii, à 1 intérieur
de l’(»vaire on trouve les ovules. Le carpelle est aussi uue leuille sessile
modiliéc : l ’ovaire représenle le limbe eiiroulc et traiis lonuc en cavité;
lo stylo, la nervure médiuiic pr(»lougéo, el les (»voies des éiuo.rgo.nces des
extrémités des nervures. Queliiuofuis la fouille cai'[»elluire ne se lermo, |»a.s,
comme dans les C(»uifères, l'(»vaire reste (»uverl el les ovules sonl nus. La
curdelcltn ([ui suspend l’i»vulc. est le funicule., el le point où il s ’alluolie à
r(»vulo, lo hilc. Le bord ô[»aissi du car|)olle, (»ii s'allacbeul los ovules, est
appelé ¡»/«ceubi,- la parlio, oxtomo do l'(»vule eu forme d ’uriic, attacbco
II
'M i
I U l
^ il
1: ' I
•i'
'!i
Y '