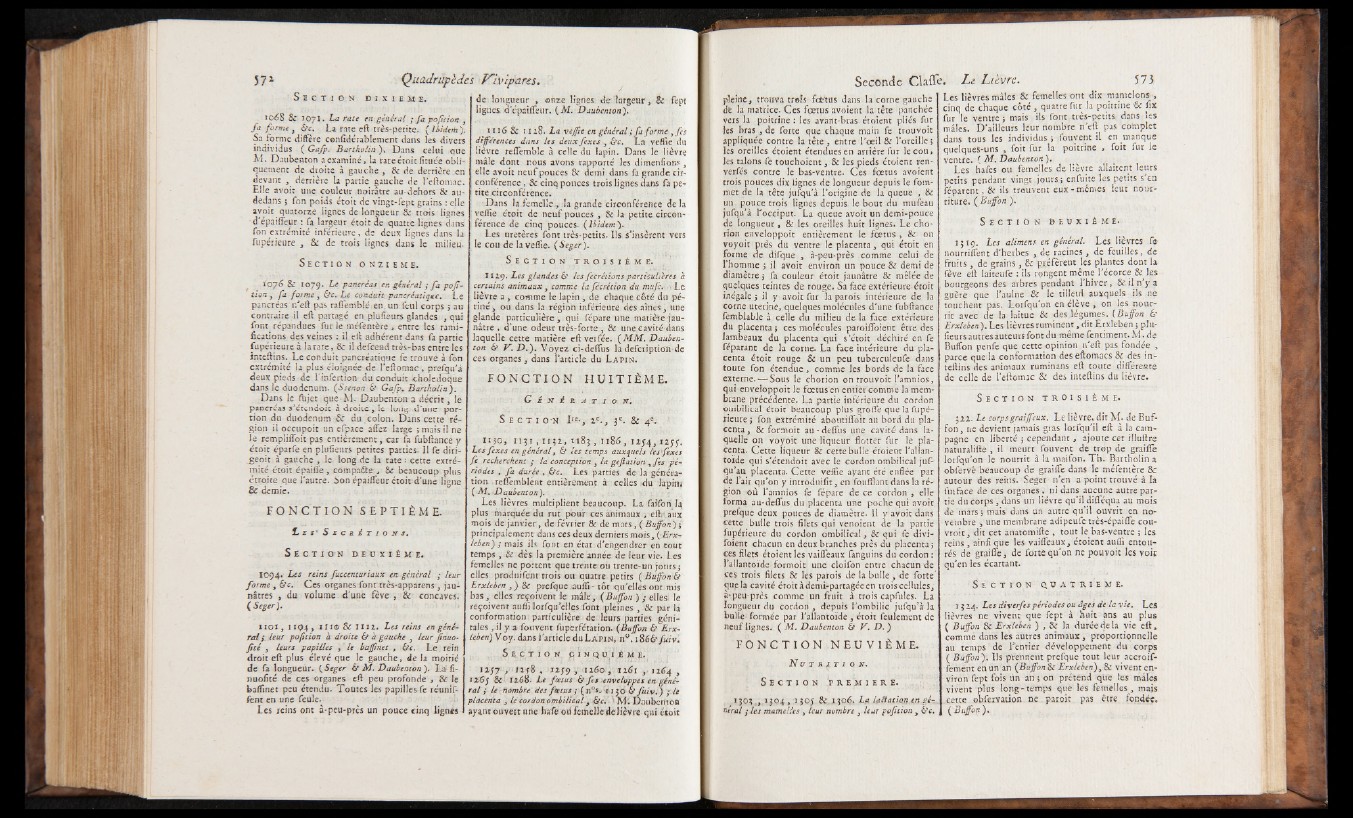
Quadrupèdes
S e c t i o n d i x i è m e .
1068 & i O71 • La rate en général y fz position ,
fa forme , &c. La rate eft très-petite. ( Ibidem'),
via forme diffère confidérablement dans les divers
individus ( Gafp. Bartkolin )» Dans celui que
A4 . Daubenton a examiné, la rate étoit fîtuéè obliquement
de droite à gauche , 8c de derrière en
devant , derrière la partie gauche de l'eftomac.
Elle avoir une couleur noirâtre au-dehors & au-
dedans j fon poids étoit de vingt-fept grains : elle
avoir quatorze lignes de longueur & trois lignes
d’épaifleur : fa largeur étoit de quatre lignes dans
fon extrémité inférieure, de deux lignes dans la
fupérieure , 8c de trois lignes dans le milieu.
S ect i on on z i ème .
1076 & 1079. Le pancréas en général y fa pofi-
tisn y fa forme 3 &c. Le conduit pancréatique. Le
pancréas r.’eft pas raflfembléen. un feul corps j au
contraire il eft partagé en plufîeurs glandes , qui !
font répandues fur le méfentère » entre les ramifications
des veines : il eft adhérent dans fa partie
fupérieure à la rate, 8c il defeead très-bas entre les
inteftins. Le conduit pancréatique fe trouve à fon
extrémité la plus éloignée de l'eftomac -, prefqu'à
deux pieds de l'infertion- du conduit cholédoque
dans le duodénum. (Stenon & Gafp. Bartkolin).
Dans le füjet queM. Daubenton a décrit, le
pancréas s'éfendoit à droite, le long d’une portion
du duodénum 8c du.colon. Dans cette région
il occupoit un efpace aflez large ; mais il ne
le remplilfoit pas entièrement, car fa fubftance y
étoit éparfe en plufîeurs petites parties. Il fe diri-
,geoit à gauche , le long de la rate : cette extrémité
étoit épaiife, compare , 8c beaucoup plus
étroite que l'autre. Son épaiifeur étoit d’une ligne
8c demie.
F O N C T I O N S E P T I ÈM E .
£ z s' S e c r é t i o n s .
S e c t i o n d e u x i è m e .
IO94. Les reins fuccenturiaux en général y leur
forme y &c. Ces organes font très-apparens, jaunâtres
, du volume d’une fève , & concaves.
( Seger).
1101, 1 194 , 1 1 1® & 1 112. Les reins en générai
y. leur pofition à droite & a gauche , leur finuo-
f t é y leurs papilles , le bafmet , &c. Le. rein
droit eft plus élevé que le gauche, de la moitié
de fa longueur. ( Seger & M. Daubenton ). La fî-
nuofîté de ces organes eft peu profonde » 8c le
baflînet peu étendu. Toutes les papilles fe réunifient
en une feule.
Les reins ont à-peu-près un pouce cinq lignes
de longueur , onze lignes de largeur, & fept
lignes d’epaifleur. ( M. Daubenton ).
1116& 1128. La veffit en général y fa forme, f s
différences dans les deux fx e s , &c. La veffie du
lièvre reffemble à celle du lapin. Dans le lièvre
mâle dont nous avons rapporté les dimenfions
elle avoit neuf pouces & demi dans fa grande circonférence
, 8c cinq pouces trois lignes dans fa pe^
tite circonférence.
Dans la femelle., la grande circonférence de la
; veffie étoit de neuf pouces , 8c la petite circonférence
de cinq pouces. {Ibidem).
Les uretères font très-petits. Ils s'insèrent vers
le cou de la veffîe. (Seger).
S e c t i o n t r o i s i è m e .
1129. Les glandes & les fe r étions particulières a
certains animaux y comme la fécrétion du mufe.- - Le
lièvre a , comme le lapin y de chaque côté du penné,
ou dans la région inférieure des aînés, une
glande particulière , qui fépàre une matièire jaunâtre
, d’une odeur très-forte, 8c une cavitédans
laquelle cette matière eft ver fée. (MM. Daubenton
b V. D .). Voyez ci-deffus la defeription de
ces organes, dans l'article du Lapin.
F O N C T I O N H U I T I È M E .
G é n é r a t i o n .
S e c t i o n 2e. , 3 e. 8c 4e.
n jo , 1131,1132, 1183 > 1186, I2 y 4 ,1255'.
Les fx e s en général t & les temps auxquels les fx e s
fe recherchent y la conception , la geftation , f s périodes
, fa durée , &c. Les parties de la génération
reflTemblént entièrement à celles »du lapin*
( M. Daubenton ).
Les lièvres multiplient beaucoup. La faifon Ja
plus marquée du rut pour ces animaux ; eftrtaux
mois de janvier, de février 8c de mars , (Bufon) 5
principalement dans ces deux derniers mois, (‘£r*-
leben) y mais ils font en état d'engendrer en tout
temps , & dès la première année de leur vie.. Les
femelles ne portent que trente ou trente-un jours j
elles produifent trois ou quatre petits ( Bufon fd
Erxleben , } 8c prefque -auflî - tôt qu'elles ont mis
bas, elles reçoivent le mâle, (Bufon ) y elles: Je
reçoivent aulfi lorfqu’elles font pleines , 8c par la
conformation particulière de leurs parties génitales
, il y a fouvent fupèrfétation.(Buffon & Erx-
leben)\oy. dans l'article du Lapin, nv.i86& fuiv.
S E C T I ON CINQUIÈME.
I2J7 , Ï2f8 , I2J9 , <1260 , 1261 1264 >
116$ & 1268. Le foetus & f s yenveloppes en général
y U nombredes foetus y (n p*. n 30 & fuiv.) y le
placenta 3 le cordon ombilical.} fjc. ' M'. Daubenton
ayant ouvert une hafe oif femelle de lièvre qui étoit
pleine, trouva trois foetus dans la corne gauche
de la matrice. Ces foetus avoient la tête panchée
vers la poitrine : les avant-bras étoient pliés fur
les bras, de forte que chaque main fe trouvoit
appliquée contre la tête, entre l’oeil 8c l'oreille >
les oreilles étoient étendues en arrière fur le cou»
les talons fe touchoient, 8c les pieds étoient ren-
verfés contre le bas-ventre. Ces foetus avoient
trois pouces dix lignes de longueur depuis le fom-
met de la tête jufqu'à l’origine de la queue , 8c
un pouce trois lignes depuis le bout du mufeau
jufqu’à l’ occiput. La queue avoit un demi-pouce
de longueur, 8c les oreilles huit lignes. Le cho-
rion enveloppoit entièrement le foetus » 8c on
voyoit près du ventre le placenta, qui étoit en
forme de difque , à-peu-près comme celui de
l’homme j il avoit environ un pouce 8c demi de
diamètre > fa couleur étoit jaunâtre 8c mêlée de
quelques teintes de rouge. Sa face extérieure étoit
inégalé y il y avoit fur la parois intérieure de la
corne utérine, quelques molécules d’une fubftance
femblable à celle du milieu de la face extérieure
du placenta ; ces molécules paroiffoient être des
lambeaux du placenta qui s'étoit déchiré en fe
féparant de la corne. La face intérieure du placenta
étoit rouge 8c un peu tuberculeufe dans
toute fon étendue, comme les bords de la face
externe. — Sous le chorion on trouvoit l’amnios,
qui enveloppoit le foetus en entier comme la membrane
précédente. La partie inférieure du cordon
ombilical étoit beaucoup plus grofle que la fupé-
rieure > fon extrémité aboutifîoit au bord du placenta,
8c formoit au-delfus une cavitédans laquelle
on voyoit une liqueur flotter fur le placenta.
Cette liqueur 8c cette bulle étoient l’allan-
toide qui s’étendoit avec le cordon ombilical juP
qu’au placenta. Cette veflie ayant été enflée par
de 1’ air qu'on y introduit, en foufflantdans la région
où l'amnios fe fépare de ce cordon , elle
forma au-deflus du placenta une poche qui avoit
prefque deux pouces de diamètre. 11 y avoit dans
cette bulle trois filets qui venoient de la partie
fupérieure du cordon ombilical, 8c qui fe divi-
foient chacun en deux branches près du placenta ;
ces filets étoient les vaifleaux fanguins du cordon :
l’allantoïde formoit une cloifon entre chacun de
ces trois filets 8c les parois de la bulle , de forte
qupla cavité éroitàdemLpartagéeen trois cellules,
a-peu-près comme un fruit à trois capfules. La
longueur du côrdon , depuis l ’ombilic jufqu’à la
bulle formée par l’allantoïde, étoit feulement de
neuf lignes. ( M. Daubenton éf V. D .)
F O N C T I O N N E U V I È M E .
N U T R I T I ON.
S e c t i o n m e m i e r e.
1303 ,,1304, 13°j 8c 130$. Lu laltatiqn.cn gé-.
néral y les mamelles, leur nombre , leur pofition , &ç.
Les lièvres mâles 8c femelles ont dix mamelons ,
cinq de chaque côté, quatre fur la poitrine 6c fîx
fur le ventre j mais ils font très-petits dans les
mâles. D’ailleurs leur nombre n’eft pas complet
dans tous les individus i fouvent il en manque
quelques-uns , foit fur la poitrine » foit fur Je
ventre. ( M. Daubenton ).
Les hafes ou femelles de lièvre allaitent leurs
petits pendant vingt.jours i enfuite les petits s ea
féparent, 8c ils trouvent eux-mêmes leur nourriture.
( Buffon ).
S e c t i o n u e ü x i é mé .
1319. Les alimens en général. Les lièvres fe
nourrirent d’herbes , de racines , de feuilles, de
fruits , de grains , 8c préfèrent les plantes dont la
fève eft laiteufe : ils rongent même l’écorce 8c les
bourgeons des arbres pendant l'hiver, 8eil n'y a
guère que l'aulne 8e le tilleul auxquels ils ne
touchent pas. Lorfqu'on en élève , on les nourrit
avec de la laitue 8c des légumes. {Bufon 6’
Erxleben ). Les lièvres ruminent, dit Erxleben y plu-
fieurs autres auteurs font du meme fentiment. M. de
Buffon penfe que cette opinion n’eft pas fondée ,
parce que la conformation des eftomacs 8e des in-
teftins des animaux ruminans eft toute différeEte
de celle de l’eftomac 8c des inteftins du lièvre.
S e c t i o n t r o i s i è m e .
322. Le corps grai feux. Le lièvre, dit M. de Buffon
, ne devient jamais gras lorfqu'il eft à la campagne
en liberté j cependant, ajoute cet illuftre
naturalifte, il meurt fouvent de trop de graifle
lorfqu'on le nourrit à la maifon. Th. Bartholin a
obfervé beaucoup de graifle dans le méfentère 8c
autour des reins. Seger n'en a point trouvé à la
fuiface de ces organes , ni dans aucune autre partie
du corps, dans un lièvre qu'il difféqua au mois
de mars j mais dans un autre qu’il ouvrit en novembre
, une membrane adipeufe très-épaifle cou-
vroit, dit cet anatomifte , tout le bas-ventre ; les
reins , ainfi que les vaifleaux, étoient auflî entourés
de graifle, de forte qu'on ne pouvoit les voit
qu’en les écartant.
S E c T r O N Q U A T R I E M E.
1324. Les diverfes périodes ou âges de la vie. Les
lièvres ne vivent que fept à huit ans au plus
( Bufon 8c Erxleben ) , 8c la durée de la vie eft,
comme dans les autres animaux, proportionnelle
au temps de l’entier développement du corps
( Buffori). Ils prennent prefque tout leur accroif-
fement en un an (Bufon 8c Erxleben) , 8c vivent environ
fept fois ùn an j on prétend que les mâles
vivent plus long-temps que les femelles, majs
cette obfervation ne paroît pas être fondée.
( Buffoji ).