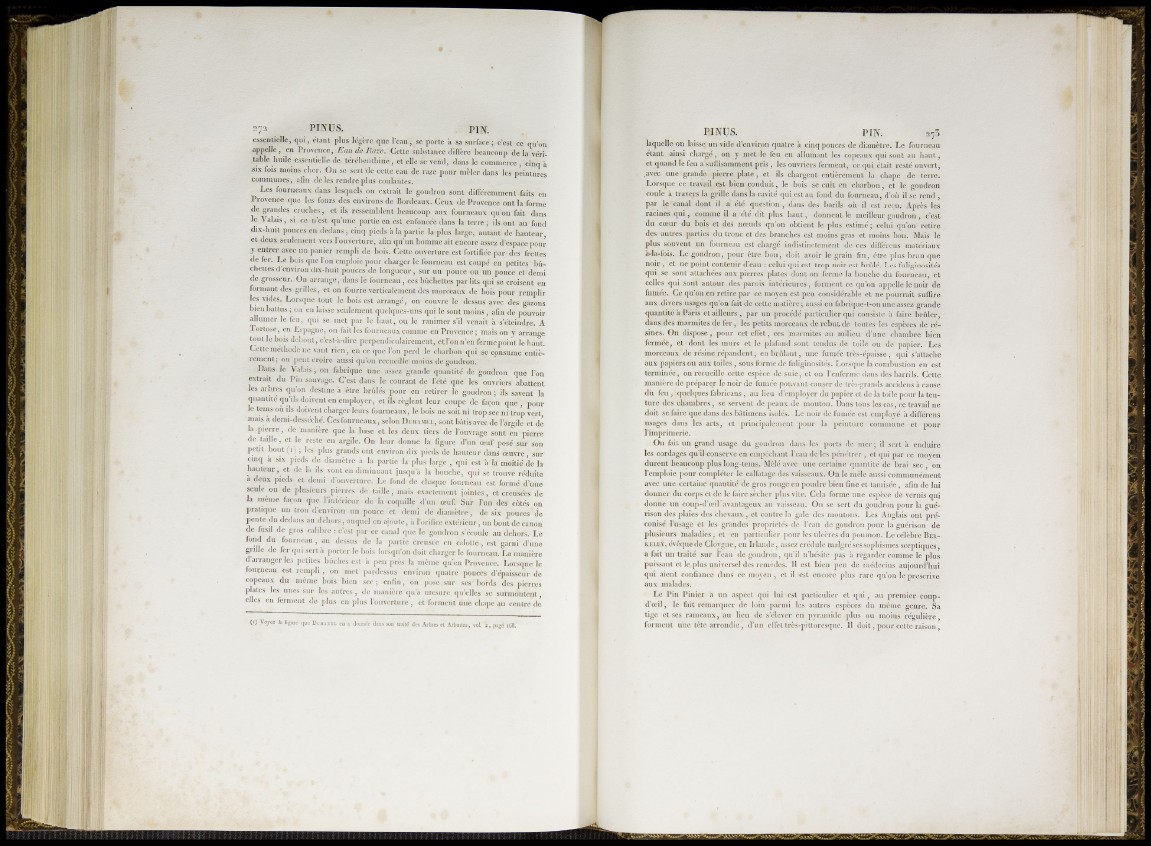
P I N U S . PIIY.
esseiniellc, qui, oluut pins logère que Tcau, sc porte a sa surface ; c'est ce qu'or
appelle, cn Provoncc, Eau de Bazc. Celle substance <lif(êrc bcauconi, «le 1, véri
table huile essentielle ,ie térébenthine, et elle se ven.l, «îans le conmicrcc cint, =
six fois moins cher. On sc sert «le ccllc can de ruzc pour mMer dans les neininre'
communes, alin de les rcudre pltis coulantes.
Les fourneaux dans Ics.juels on extrait le goudron sonl différemment faits c
Provence que les fours des euviruus de Bordeaux. Ceux de Provenc
de grandes cruches, et ils ressemblent beaucoup aux fourneaux «[
lo Valais, si ce n'est qu'une parlic cn est enfoncée dans la terre ; ils ont au fond
diuit pouces on dedans, cinq pie<ls ii la partie la pl
-ut la f.
. n fait dan
s la terre ; ils ont au fon
' 1 t " ^ " ' •• f " i'"-'--' " " H'-'» 'UUant de hauloui
ct lieux seulement vers l'ouvertiu-c, alin qu'un homme ail encore assoz d'o.spacc pot
y entrer avec un panier rempli «le bois. Cette ouverlure est l'orlifiée par «les frelU
de lor. Le bois .pie f on emploie pour charger lo fournttau ost coupé eu petites bî
chottes d'environ dix-huit pouces de longueui', sur un pouce ou un pouce ct den
«le gro.ssour. Un arrange, dans le fourneau, ces lu\,;hottos par lils «jui sc croisent e
formant des grilles, ol on foture verticalement dos morceaux de bois pour rempli
les vides. Lors.[uc tout le bois e.st arrangé, on couvre le do.ssus avec des gi
bioubattus; «JU onlai.sse soulemeul (piel.iuos-uns qui le sout m ' " "
allumer lo fon, qui se met par le haut, ou 1
Torlosc, en L.-pague, ou fait les fourneaux con
t«)ut le bois debout, c'est-à-dire perpen,
Celte méthode ne vaut rion, eu ce quo
I peul croire aussi qu'ou re
afijj «le pouvoir
imorsit venait à s'éteindre. A
iix comme eu Provence ; mais ou y arrange
•ulaircmcnt, ctl'onn'eu fermepoint le baut.
on perd le charbon qui sc consume cnlic-
1 .loillc moins dc goudron.
Dans lo Valais, on fabrique uno assez gran.le quantité dc goudron que fon
extrait du Piu sauvago. C'est dans le courant dc l'élé «pie los ouvriers abattent
les ai bres qu on destine a «Hre bridés pour eu retirer le gou.lron ; ils .savent la
quauutc qu'ils doiveni en employer, el ils règlent leur coupc de façon (i.ic pour
le tems oh ils «loivimt charger leurs fourneaux, le bois ne soit ui trop sec ni trop vert,
mais a dcmi-dessoché. Ces fourneaux, selon Dt-n.vMU,, sont bâtis avcc de l'argile et de
l a . p i e r r c , de manière que la base el los deux dcrs de l'ouvra"c sont on pierre
de taille, et le reste eu argile. On lour donne la ligtn'c «l'un ccuf posé sur son
peut bout ; les plus grands ont environ ,lix pie.ls de hauteur «lans oeuvre, sur
cmq a six ] ieds de diamètre ii la partie la plus large , qui est à la moitié «le la
hauteur, et do la ils vont en diminuant jusqu'i, la bouche, qui se trouve réduite
a doux pieds Cl <lemi d ouverture. Lo fond «le chaque fourneau est formé .f une
sculc ou de plusieurs pierres do taille , mais oxactemonl jointes, ct creusées de
la meme laçon que l'intérieur de la coquille d'un a;uf. Sur l'un des côtés on
pratique un trou donviron un poucc et demi .le diamètre, do six pc
jiente du «ledans au dehors, anrpiel cn ajoute, à f.»
de fusil de gros calibre : c'cst par ce canal <pie le goi
iidn
l'ond du four.,«MU, au de.ssus de la i-artic crcusco on cnlollc, est garni d't
grille «le for qm son à porter le bois lor.,.p,'oii doit charger le fourneau. La i =
d arranger lc:i petites bnclics est a pou près la mémo «pi'cn Pro
louvneau est rempli, tm mol ].a!,lossus ciniron (piatie pou
copeaux du morne bois bien s«;c ; enfin, on pr
plates les unes sur les a «Urcs, de manière qu
mesure
eilos «m ferment de plus on ]d orluro , cl foi
• fv
, ros «ie
• , u n bout do canon
s'écoule au dtdiors. Le
. Lorsque lo
d'épaisseur de
.sos bonis dos pierres
l'ollcs se snriimnicnl,
me chape au contre «le
P I N U S .
laquelle on lai.sse un vide d'environ quaire à ci
étant ainsi chargé, on y met lo feu en allu
cl quand le feu a suflisammcnt pris , les oiivric
.avcc une grande pierre plat«?, et ils charge
Lorsque ce travail esl bien conduit, l,- bois
coule il travers la "rillc dans la cavité qui est ai
par le canal donl il a été que.stion , dans «les barils oî
racines q i , i , comme il a o:ié dit plus haut, donnonl le
du coeur du bois et des nauuls «pi'on obtient le plus ost
des autres parties du tronc et des brauches est moins gras
plus souveut un fourneau est chargé in.listinrienrent de
P I N . 275
iq pouces de diamèlre. Le fourneau
,iant les copcanx qui sont au haut,
s ferment, cc qui élait resté ouvert.
Il enlièrcment la chape do forrc.
so cuit en char])on, ct lo goudron
fond du fourneau, d'où il .se rond ,
à-la-lbis. Le goudi
noir , ot ne poiut
qui se .sont altach
celk's qui sont aulour des parois int.
fuméo. Cc qu'on en retire par cc nioy
aux divers usages qu'on fait dc celle m
quantité à Paris cl ailleurs, par un pi
«lans dos marmites de f o r , los petits more
sincs. Ou ,lispo.se , pour cct effet, cos r
fermée, et d«,nt les murs ot le plafond
morceaux dc résine répandent, en bridai
pour èlre bon, «bit avoir 1,
•enir d'eau : colui qui csl trop
iux pierres plates dont on fe
I est r«vu. Après les
eilleur goudron , c'est
é ; cchii «ju'on retire
t moins bon. Mais le
s différons matériaux
1 qu.
aux papiers ou aux toiles, sous fo.
terminée, on recueille «
r l c i
grain fin, .'tro plus
noir est bridé. I,es fnligino.sités
me la bo.ichc <hi fourneau, et
cures, form,Mil CO qu'on appelle lo noir dc
est peu considérable ot no pourrait suffire
ère ; aussi cn fabrique-t-on une assez graudc
;édé parliculier qui consisle â faire brider,
ccaux dc rebut, de toules les espèces de rémarmites
nu milieu il'uiie chambre bien
Il tendus de toile .m de papior. Les
une fum«:e très-épaisse, .jtii s'attache
ledo Ailiginosités. Lorsque la combustion en est
termiiioe,ccllc cspèco <le suie, et ou fcnform.' dans «los barrils. Cotte
manière de pr«:parcr If noir de himéo pouvant cansor de irès-i.;rands accideus cause
«lu fou, «piohpies fabrieans , au lien .l'employer du papier oî dc la toile pour la tenture
des chauibrcs, se servent de peaux de mouton. Dans t,>us les cas, cc travail ne
doit sc faire «pie dans des bâtimcns i.solés. Le noir do fmiiéc est employé à «lilTérens
tisagos dans les arts, ct principalement pour l.i pointure communc ct pour
l'imprimerie.
On fait un grand usage du gou.lron dans los ports do mer ; il sort it enduire
les cordages qu'il conserve en empêchant l'eau do los ])én,-trer , et .pii par ce moyeu
durent boaticoup plus long-tems. .Mêlé avec uuo certaine quaniité de brai sec, on
l'emploie pour compléter le calfatage des vaisseaux. On le nu'-lo aussi communément
avcc une certaine quantité de gros rouge on p.uulrc bien fine et tamisée , afin de lui
donner du corps ol «le le faire sèchor plus vite. Cela forme une e.spèce de vernis qui
donne un coup-d'trirav.uitageux au vaisseau. On se sert ,hi goudron pour la guérison
des plaies «les chovaux , el contre la gale des mouU)ns. Les Anglais ont préconisé
l'usage ct los grandes propriétés de l'eau do goudron pour la guérison de
plusieurs maladies , el ou particulier pour los ulcères du poumon. Le célèbre BERKELEY,
évêquede Cloyguc, 011 Irlaïule, assoz cr.=dule malgré ses sophismos sceptiques,
qu'il n'bési
i. 11 csl bien peu de niéd<-«
t il est encore plus rare «p
1 regarder connne le jdus
sel «les remèdes.|.eu méd.Tius aujourd'hui
a fait uu traité
puissant et le pl
qui aient o n l i;
aux malades.
Lo Pin Pinier a un aspect qui lui est parlicid
d'oeil, le fait remarquer dc loin ]- ' '
Voyez ia figure ([uc Un 0 a-.iiH.'e dai ralld d,'s .-Vibre. vol J,
• ot .[LU, au premier coup-
?spèces du même gcure. Sa
i py ns réguliè
tige et SCS 1 'élc^ lide plus ou m,
iidie, d'uu effet lrès-piltoros«pic. II doit, poi
r ccttc rais-i
mmmm