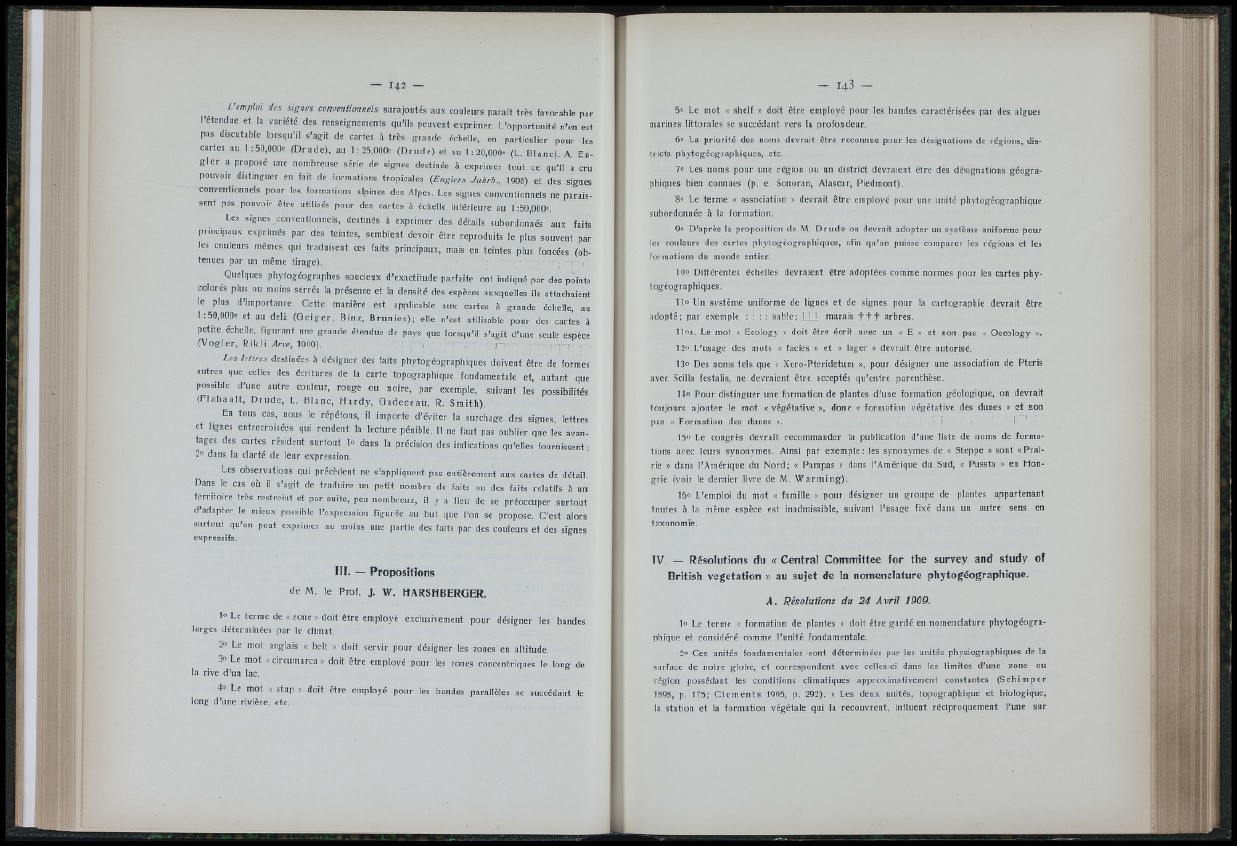
i* ■'
ÎA.
L’emploi des signes conventionnels surajoutés aux couleurs paraît très favorable par
l’etendue et la variété des renseignements qu’ils peuvent exprimer. L’opportunité n’en est
pas discutable lorsqu’il s ’agit de cartes à très grande échelle, en particulier pour les
cartes au 1:50,000e (D r u d e ) , au 1:25,000e (D r u d e ) et au 1:20,000e (L. B la n c ) . A. E n g
l e r a proposé une nombreuse série de signes destinée à exprimer tout ce qu’il a cru
pouvoir distinguer en fait de formations tropicales (Englers Jahrb., 1908) et des signes
conventionnels pour les formations alpines des Alpes. Les signes conventionnels ne paraissent
pas pouvoir être utilisés pour des cartes à échelle inférieure au 1 :50,000e.
Les signes conventionnels, destinés à exprimer des détails subordonnés aux faits
principaux exprimés par des teintes, semblent devoir être reproduits le plus souvent par
les couleurs mêmes qui traduisent ces faits principaux, mais en teintes plus foncées (obtenues
par un même tirage). i ! '
Quelques phytogéographes soucieux d’exactitude parfaite ont indiqué par des points
colorés plus ou moins serrés la présence et la densité des espèces auxquelles ils attachaient
le plus d’importance. Cette manière est applicable aux cartes à grande échelle, au
1:50,000e et au delà (Q e i g e r , B in z , B r u n i e s ) ; elle n’est utilisable pour des cartes à
petite echelle, figurant une grande étendue de pays que lorsqu’il s ’agit d’une seule espèce
(V o g l e r , Ri k i i Zlz-ri, 1909). ' : | 'I ' L à ' T“" ' ' : 1 '■ 1
Les Mir e s destinées à désigner des faits phytogéographiques doivent être de formes
autres que celles des écritures de la carte topographique fondamentale et, autant que
possible d’une autre couleur, rouge ou noire, par exemple, suivant les possibilités
(F l a h a u l t , D r u d e , L. B la n c , H a r d y , G a d 'e c e a u , R. Sm i t h ) .
En tous cas, nous le répétons, il importe d’éviter la surchage des signes, lettres
et lignes entrecroisées qui rendent la lecture pénible. II ne faut pas oublier que lés avantages
des cartes résident surtout 1« dans la précision des indications qu’elles fournissent;
2o dans la clarté de leur expression.
Les observations qui précèdent ne s ’appliquent pas entièrement aux cartes de détail.
Dans le cas où il s ’agit de traduire un petit nombre de faits ou des faits relatifs à un
territoire très restreint et par suite, peu nombreux, il y a lieu de se préoccuper surtout
d’adapter le mieux possible l’expression figurée au but que l’on se propose. C’est alors
surtout qu’on peut exprimer au moins une partie des faits par des couleurs et des signes
expressifs.
n i. — Propositions
de M. le Prof. J. W. HARSHBERGER.
1° Le terme de « zone » doit être employé exclusivement pour désigner les bandes
larges déterminées par le climat.
2o Le mot anglais « beit » doit servir pour désigner les zones en altitude.
3° Le mot « circumarca » doit être employé pour les zones concentriques le long de
la rive d’un lac.
40 Le mot « stup » doit être employé pour les bandes parallèles se succédant le
long d’une rivière, etc.
5° Le mot « shelf » doit être employé pour les bandes caractérisées par des algues
marines littorales se succédant vers la profondeur.
6° La priorité des noms devrait être reconnue pour les désignations de régions, districts
phytogéographiques, etc.
70 Les noms pour une région ou un district devraient être des désignations g éo g r a phiques
bien connues (p. e. Sonoran, Alascar, Piedmont).
80 Le terme « association » devrait être employé pour une unité phytogéographique
subordonnée à la formation.
9° D’après la proposition de M. D r u d e on devrait adopter un système uniforme pour
les couleurs des cartes phytogéographiques, afin qu’on puisse comparer les régions et les
formations du monde entier.
lOo Différentes échelles devraient être adoptées comme normes pour les cartes phytogéographiques.
11« Un système uniforme de lignes et de signes pour la cartographie devrait être
adopté; par exemple : ; : : sable : I I I marais t t t arbres.
11 «a. Le mot « Ecology » doit être écrit avec un « E » et non pas « Qe cology ».
12o L’usage des mots « faciès » et « lager » devrait être autorisé.
13° Des noms tels que « Xero-Pteridetum », pour désigner une association de Pteris
avec Scilla festalis, ne devraient être acceptés qu’entre parenthèse.
14o Pour distinguer une formation de plantes d’une formation géologique, on devrait
toujours ajouter le mot « végé tative », donc « formation végétative des dunes » et non
pas « Formation des dunes ». i > T ' '
15° Le congrès devrait recommander la publication d’une liste de noms de formations
avec leurs synonymes. Ainsi par exemple: les synonymes de « Steppe » sont «Prairie
» dans l’Amérique du Nord; « Pampas » dans l’Amérique du Sud, « Pussta » en Hongrie
(voir le dernier livre de M. W a rm in g ) .
16° L’emploi du mot « famille » pour désigner un groupe de plantes appartenant
toutes à la même espèce est inadmissible, suivant l’usage fixé dans un autre sens en
taxonomie.
IV. — Résolutions du « Central Committee for the survey and study of
British vegetation » au sujet dé la nomenclature phytogéographique.
A. Résolutions du 24 Avril 1909.
lo Le terme « formation de plantes » doit être gardé en nomenclature p h y to g éo g ra phique
et considéré comme l’unité fondamentale.
2o Ces unités fondamentales sont déterminées par les unités physiographiques de la
surface de notre globe, et correspondent avec celles-ci dans les limites d’une zone ou
région possédant les conditions climatiques approximativement constantes ( S c h im p e r
1898, p. 175; C l eme n t s 1905, p. 292). « Les deux unités, topographique et biologique,
la station et la formation végétale qui la recouvrent, influent réciproquement l’une sur
■ I ■ V
■|f4.