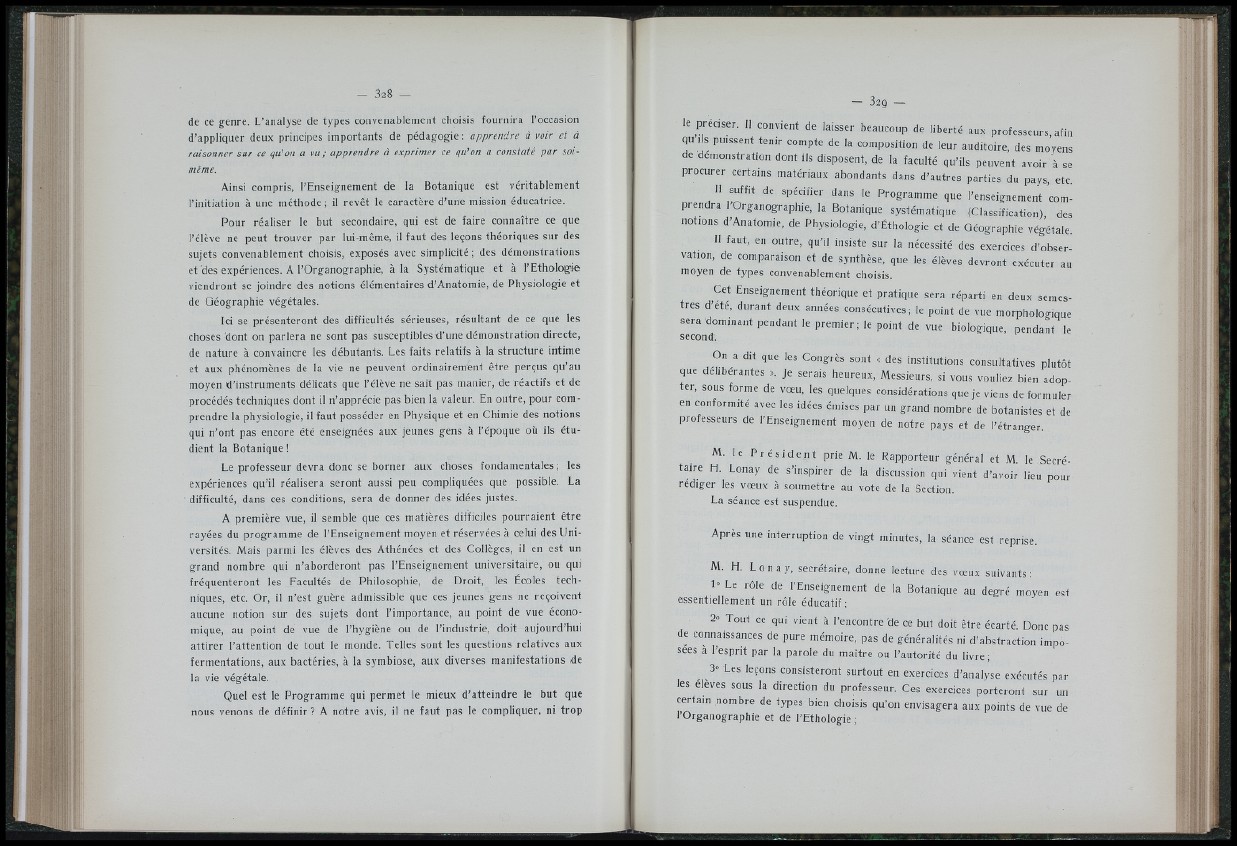
de ce genre. L’analyse de types convenablement choisis fourni ra l’occasion
d ’appliquer deux principes impor tant s de pédagogie : apprendre à voir et à
raisonner sur ce qu’on a vu; apprendre à exprimer ce qu’on a constaté par soi-
même.
Ainsi compris, l’Enseignement de la Botanique est vér i tablement
l’initiation à une mé th o d e ; il revêt le caractère d’une mission éducatrice.
Pour réaliser le but secondai re, qui est de faire connaî t re ce que
l’élève ne peut t rouve r par lui-même, il faut des leçons théor iques sur des
sujets convenablement choisis, exposés avec simplicité; des démons t rat ions
et des expériences. A l’Organographie , à la Sys témat ique et à l’Etholoigie
viendront se joindre des notions élémentai res d ’Anatomie, de Physiologie et
de Géographie végét ales.
Ici se pré sente ront des difficultés sérieuses, résul tant de ce que les
choses dont on par le ra ne sont pas susceptibles d ’une démons t ra t ion directe,
de na ture à convaincre les débutants. Les fait s rela ti fs à la s t ructure intime
et aux phénomènes de la vie ne peuvent ordinai rement êt re perçus q u ’au
moyen d ’ins t ruments délicats que l’élève ne sait pas manie r, de réacti fs et de
procédés techniques dont il n’apprécie pas bien la valeur. En outre, pour comprendre
la physiologie, il faut posséder en Physique et en Chimie des notions
qui n’ont pas encore été enseignées aux jeunes gens à l’époque où ils é tu dient
la Botanique !
Le profes seur devra donc se borne r aux choses fondamentales ; les
expér iences qu’il réal isera seront aussi peu compliquées que possible. La
difficulté, dans ces conditions, sera de donner des idées justes.
A première vue, il semble que ces mat ières difficiles pour ra ient êt re
rayées du p ro g r amme de l’Enseignement moyen et réservées à celui des Uni versités.
Mais parmi les élèves des Athénées et des Collèges, il en est un
g r an d nombre qui n’abo rd e ro n t pas l’Enseignement universi taire, ou qui
f réquente ront les Laculté s de Philosophie, de Droit , les Ecoles t e c h niques,
etc. Or, il n’est guère admissible que ces jeunes gens ne reçoivent
aucune notion sur des suje ts dont l’impor tance, au point de vue économique,
au point de vue de l’hygiène ou de l’industr ie, doit aujourd’hui
at t i re r l’at tent ion de tout le monde. Telles sont les questions relatives aux
fermentat ions , aux bactéries, à la symbiose, aux diverses mani fes tat ions de
la vie végétale .
Quel est le Pro g r amme qui pe rme t le mieux d’at teindre le but que
nous venons de définir ? A not re avis, il ne faut pas le compliquer, ni t ro p
le préciser. Il convient de laisser beaucoup de liber té aux profes seurs, afin
qu ,1s puissent tenir compte de la composition de leur auditoire, des moyens
de demons t rat ion dont ils disposent, de la faculté qu’ils peuvent avoir à se
procurer certains ma té r iaux abondant s dans d’aut res par ties du pays, etc.
Il suffit de spécifier dans le P ro g r amme que l’enseignement comprendra
Organographie , la Botanique systémat ique (Classification), des
notions d ’Anatomie, de Physiologie, d’Lthologie et de Géographie végétale.
Il faut, en out re, qu’il insiste sur la nécessit é des exercices d’o b s e r vation,
de comparaison et de synthèse, que les élèves devront exécuter au
moyen de types convenablement choisis.
Cet Enseignement théor ique et prat ique sera répar t i en deux s eme s t
re s d ’été, durant deux années consécutives; le point de vue morphologique
sera dominant pendant le premier ; le point de vue biologique, pendant le
second.
On a dit que les Congrès sont « des institu tions consultatives plutôt
que dél ibérantes ». Je serais heureux, Messieurs, si vous vouliez bien ad o p ter,
sous forme de voeu, les quelques considérations que je viens de formuler
en conformi té avec les idées émises pa r un g r an d nombre de botanis tes et de
profes seurs de l’Enseignement moyen de not re pays et de l’ét ranger .
M. le P r e s i d e n t prie M. le Rappor teur général et M. le Secrétai
re H. Lonay de s’in spirer de la discussion qui vient d ’avoir lien pour
rediger les voeux à soume t t re au vote de la Section.
La séance est suspendue.
Après une inter rupt ion de vingt minutes, la séance est reprise.
M. H. L o n a y , secrétaire, donne le cture des voeux suivant s:
U Le rôle de l’Enseignement de la Botanique au degré moyen est
essent iel lement un rôle éducatif ;
2° To u t ce qui vient à l’encont re de ce but doit êt re écarté . Donc pas
de connaissances de pure mémoire, pas de général i tés ni d ’abs t ract ion imposées
a l’espr it par la parole du ma î t re ou l’autor i té du livre;
^ 30 Les leçons consisteront sur tout en exercices d’analyse exécutés par
les eleves sous la direction du professeur . Ces exercices p o r te ro n t sur un
cer tain nombre de types bien choisis qu’on envisagera aux points de vue de
l’o r g a n o g r a p h i e et de l’Ethologie ;