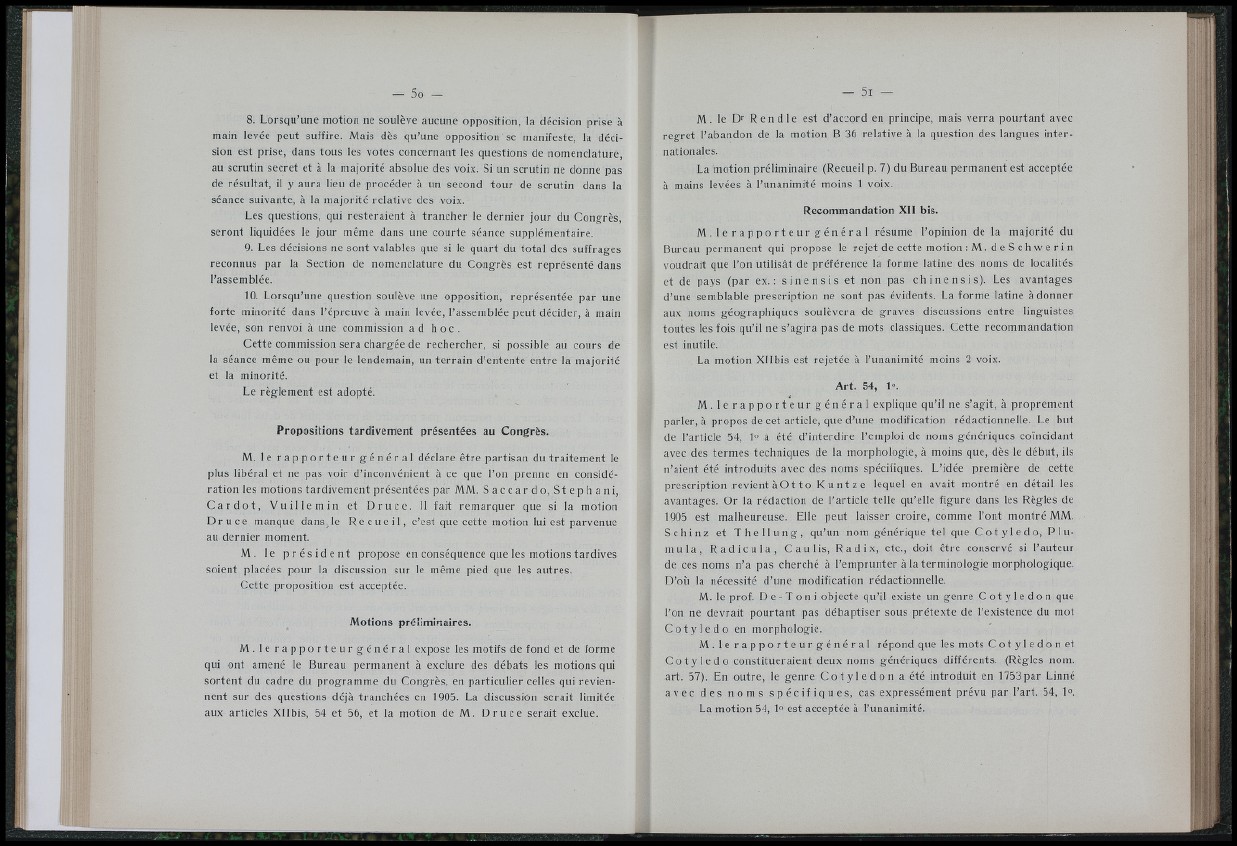
— 5o — — 5 i
8. Lor squ’une mot ion ne soulève aucune opposition, la décision prise à
main levée peut suffire. Mais dès q u ’une opposit ion se manifeste, la décision
est prise, dans tous les vote s concernant les questions de nomenclature,
au scrutin secret et à la major i té absolue des voix. Si un scrutin ne donne pas
de résultat, il y aura lieu de procéder à un second to u r de scrutin dans la
séance suivante, à la major i té relative des voix.
Les questions, qui res tera ient à t ranche r le dernier jour du Congrès,
seront liquidées le jour même dans une cour te séance supplémentai re.
9. Les décisions ne sont valables que si le quar t du total des suf f rages
reconnus par la Section de nomenclature du Congrès est repré s enté dans
l’assemblée.
10. Lor squ’une question soulève une opposition, représentée par une
for te minorité dans l’épreuve à main levée, l’assemblée peut décider, à main
levée, son renvoi à une commission a d h o c .
Cet te commission sera chargée de rechercher , si possible au cours de
la séance même ou pour le lendemain, un te r ra in d ’entente ent re la major i té
et la minorité.
Le règlement est adopté.
Propositions tardivement présentées au Congrès.
M. le r a p p o r t e u r g é n é r a l déclare êt re par t i san du t r a i temen t le
plus libéral et ne pas voir d’inconvénient à ce que l’on prenne en considérat
ion les mot ions ta rdivement présentées par MM. S a c c a r d o , S t e p h a n i,
C a r d o t , V u i l l e m i n et D r u c e . II fait rema rq u e r que si la mot ion
D r u c e manque dans le R e c u e i l , c’est que cette mot ion lui est parvenue
au dernier moment.
M. le p r é s i d e n t propose en conséquence que les mot ions tardives
soient placées pour la discussion sur le même pied que les autres.
Cet te proposition est acceptée.
Motions préliminaires.
M. l e r a p p o r t e u r g é n é r a l expose les motifs de fond et de forme
qui ont amené le Bureau pe rmanent à exclure des débat s les mot ions qui
sor tent du cadre du pro g r amme du Congrès , en particulier celles qui reviennent
sur des questions déjà t ranchées en 1905. La discussion serai t limitée
aux articles Xllbis, 54 et 56, et la mot ion de M. D r u c e serait exclue.
M. le Dr R e n d l e est d’accord en principe, mais ver ra pour tant avec
regret l’abandon de la mot ion B 36 relative à la question des langues inter nationales.
La mot ion préliminaire (Recueil p. 7) du Bureau pe rmanent est acceptée
à mains levées à l’unanimi té moins 1 voix.
Recommandation XII bis.
M. l e r a p p o r t e u r g é n é r a l résume l’opinion de la major i té du
Bureau pe rmanent qui propose le rejet de cette mot ion : M . d e S c h w e r i n
voudrait que l’on utilisât de préférence la forme latine des noms de localités
et de pays (par ex.: s i n e n s i s et non pas c h i n e n s i s ) . Les avantages
d’une semblable prescr ipt ion ne sont pas évidents. La forme latine à donner
aux noms géographiques soulèvera de graves discussions ent re linguistes
toutes les fois qu’il ne s’agi ra pas de mots classiques. Cet te recommandat ion
est inutile.
La mot ion Xllbis est rejetée à l’unanimité moins 2 voix.
Art. 54, lo.
4
M. le r a p p o r t e u r g é n é r a l explique qu’il ne s’agit, à proprement
parler, à propos de cet article, que d’une modification rédactionnel le. Le but
de l’article 54, 1° a été d’interdi re l’emploi de noms génér iques coïncidant
avec des te rme s techniques de la morphologie, à moins que, dès le début, ils
n’aient été int rodui ts avec des noms spécifiques. L’idée première de cette
prescription revient à O t t o K u n t z e lequel en avait mont ré en détail les
avantages. Or la rédact ion de l’article telle qu’elle figure dans les Règles de
1905 est malheureuse. Elle peut laisser croire, comme l’ont mont ré MM.
S c h i n z et T h e l l u n g , qu’un nom génér ique tel que C o t y 1 e d o, P 1 u-
mu l a . R a d í c u l a , C a u l is. R a d i x , etc., doit êt re conservé si l’auteur
de ces noms n’a pas cherché à l’emprunte r à la terminologie morphologique.
D’où la nécessité d ’une modification rédactionnel le.
M. le prof. D e - T o n i objecte q u ’il existe un genre C o t y l e d o n que
l’on ne devrai t p our tant pas débapt iser sous prétexte de l’existence du mot
C o t y l e d o en morphologie.
M. l e r a p p o r t e u r g é n é r a l répond que les mots C o t y l e d o n et
C o t y l e d o const i tueraient deux noms génér iques différents. (Règles nom.
art. 57). En outre, le genre C o t y l e d o n a été int rodui t en 1753par Linné
a v e c d e s n o m s s p é c i f i q u e s , cas expres sément prévu par l’art. 54, 1°.
La mot ion 54, 1° est acceptée à l’unanimité.
iif 1
i) b: . i
' 3:1 '