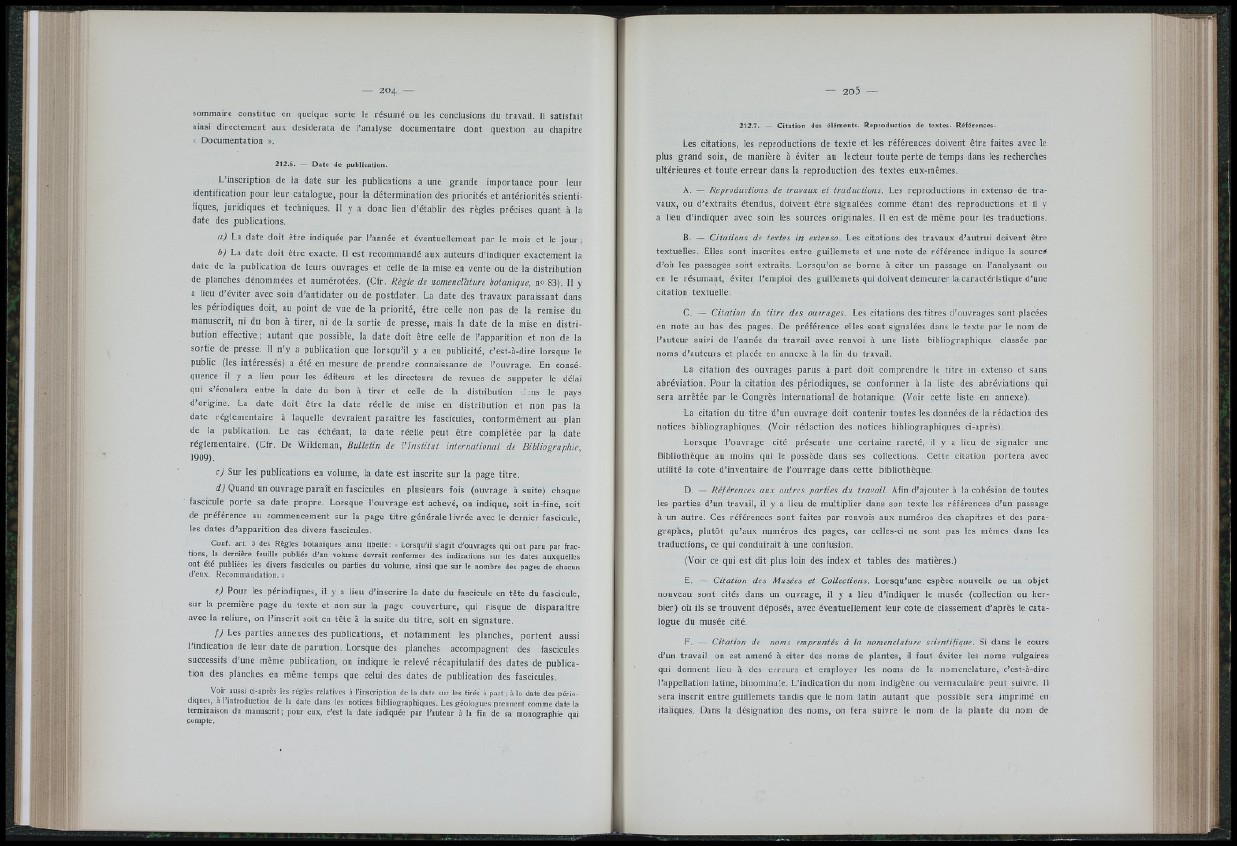
sommaire constitue en quelque sorte le résumé ou les conclusions du travail. 11 satisfait
ainsi directement aux desiderata de l’analyse documentaire dont question au chapitre
« Documentation ».
212.6. — D a t e d e p u b l i c a t i o n .
L inscription de la date sur les publications a une grande importance pour leur
identification pour leur catalogue, pour la détermination des priorités e t antériorités scientifiques,
juridiques et techniques. Il y a donc lieu d’établir des règles précises quant à la
date des publications.
a) La date doit être indiquée par l’année et éventuellement par le mois et le jour;
b) La date doit être exacte. Il est recommandé aux auteurs d’indiquer exactement la
date de la publication de leurs ouvrages et celle de la mise en vente ou de la distribution
de planches dénommées et numérotées. (Cfr. Règle de nomenclature botanique, no 83). Il y
a lieu d’éviter avec soin d’antidater ou de postdater. La date des travaux paraissant dans
les périodiques doit, au point de vue de la priorité, être celle non pas de la remise du
manuscrit, ni du bon à tirer, ni de la sortie de presse, mais la date de la mise en distribution
effective ; autant que possible, la date doit être celle de l’apparition et non de la
sortie de presse. Il n’y a publication que lorsqu’il y a eu publicité, c’est-à-dire lorsque le
public (les intéressés) a été en mesure de prendre connaissance de l’ouvrage. En conséquence
il y a lieu pour les éditeurs et les directeurs de revues de supputer le délai
qui s ’écoulera entre la date du bon à tirer et celle de la distribution d.ms le pays
d’origine. La date doit être la date réelle de mise en distribution et non pas la
date réglementaire à laquelle devraient paraître les fascicules, conformément au plan
de la publication. Le cas échéant, la date réelle peut être complétée par la date
réglementaire. (Cfr. De Wildeman, Bulletin de VInstitut international de Bibliographie,
1909).
c) Sur les publications en volume, la date est inscrite sur la page titre.
d ) Quand un ouvrage paraît en fascicules en plusieurs fois (ouvrage à suite) chaque
fascicule porte sa date propre. Lorsque l’ouvrage est achevé, on indique, soit in-fine, soit
de préférence au commencement sur la page titre générale livrée avec le dernier fascicule,
les dates d’apparition des divers fascicules.
C o n f . a r t . 3 d e s R è g l e s b o t a n i q u e s a in s i i ib e i ié : « L o r s q u ’il s ’a g i t d ’o u v r a g e s q u i o n t p a r u p a r f r a c t
io n s , la d e r n i è r e f e u i l le p u b l i é e d ’u n v o l um e d e v r a i t r e n f e rm e r d e s i n d i c a t i o n s s u r le s d a t e s a u x q u e l l e s
o n t é t é p u b l i é e s le s d iv e r s f a s c i c u l e s o u p a r t i e s d u v o l um e , a in s i q u e s u r le n o m b r e d e s p a g e s d e c h a c u n
d ’e u x . R e c om m a n d a t i o n . »
e) Pour les périodiques, il y a lieu d’inscrire la date du fascicule en tête du fascicule,
sur la première page du texte et non sur la page couverture, qui risque de disparaître
avec la reliure, on l ’inscrit soit en tê te à la suite du titre, soit en signature.
f ) Les parties annexes des publications, et notamment les planches, portent aussi
l’indication de leur date de parution. Lorsque des planches accompagnent des fascicules
successifs d’une même publication, on indique le relevé récapitulatif des dates de publication
des planches en même temps que celui des dates de publication des fascicules.
V o i r a u s s i c i - a p r è s les r é g i e s r e l a t iv e s à l ’i n s c r i p t i o n d e la d a t e s u r le s t i r é s à p a r t ; à la d a t e d e s p é r i o d
iq u e s , à l ’i n t r o d u c t i o n d e la d a t e d a n s les n o t i c e s b i b l i o g r a p h i q u e s . Le s g é o l o g u e s p r e n n e n t c om m e d a t e la
t e rm i n a i s o n d u m a n u s c r i t ; p o u r e u x , c ’e s t la d a t e i n d i q u é e p a r l ’a u t e u r à la f in d e s a m o n o g r a p h i e qui
c om p t e ,
212.7. — C i t a t i o n d e s é l ém e n t s . R e p r o d u c t i o n d e t e x t e s . R é f é r e n c e s .
Les citations, les reproductions de t ex te et les références doivent être faites avec le
plus grand soin, de manière à éviter au lecteur toute perte de temps dans les recherches
ultérieures e t toute erreur dans la reproduction des textes eux-mêmes.
A. — Reproductions de travaux et traductions. Les reproductions in extenso de travaux,
ou d’extraits étendus, doivent être signalées comme étant des reproductions et il y
a lieu d’indiquer avec soin les sources originales. Il en est de même pour les traductions.
B. — Citations de textes in extenso. Les citations des travaux d’autrui doivent être
textuelles. Elles sont inscrites entre guillemets et une note de référence indique la sourcii
d’où les passages sont extraits. Lorsqu’on se borne à citer un passage en l’analysant ou
en le résumant, éviter l’emploi des guillemets qui doivent demeurer la caractéristique d ’une
citation textuelle.
C. — Citation du titre des ouvrages. Les citations des titres d’ouvrages sont placées
en note au bas des pages. De préférence elles sont signalées dans le texte par le nom de
l’auteur suivi de l’année du travail avec renvoi à une liste bibliographique classée par
noms d’auteurs et placée en annexe à la fin du travail.
La citation des ouvrages parus à part doit comprendre le titre in extenso et sans
abréviation. Pour la citation des périodiques, se conformer à la liste des abréviations qui
sera arrêtée par le Congrès International de botanique. (Voir cette liste en annexe).
La citation du titre d’un ouvrage doit contenir toutes les données de la rédaction des
notices bibliographiques. (Voir rédaction des notices bibliographiques ci-après).
Lorsque l’ouvrage cité présente une certaine rareté, il y a lieu de signaler une
Bibliothèque au moins qui le possède dans ses collections. Cette citation portera avec
utilité la cote d’inventaire de l’ouvrage dans cette bibliothèque.
D. — Références aux autres parties du travail. Afin d’ajouter à la cohésion de toutes
les parties d’un travail, il y a lieu de multiplier dans son texte les références d’un passage
à un autre. Ces références sont faites par renvois aux numéros des chapitres e t des paragraphes,
plutôt qu’aux numéros des pages, car celles-ci ne sont pas les mêmes dans les
traductions, ce qui conduirait à une confusion.
(Voir ce qui est dit plus loin des index et tables des matières.)
E. — Citation des Musées et Collections. Lorsqu’une espèce nouvelle ou un objet
nouveau sont cités dans un ouvrage, il y a lieu d’indiquer le musée (collection ou herbier)
où ils se trouvent déposés, avec éventuellement leur cote de classement d’après le catalogue
du musée cité.
L. — Citation de noms empruntés à la nomenclature scientifique. Si dans le cours
d’un travail on es t amené à citer des noms de plantes, il faut éviter les noms vulgaires
qui donnent lieu à des erreurs et employer les noms de la nomenclature, c’est-à-dire
l’appellation latine, biuomina’.e. L’indication du nom indigène ou vernaculaire peut suivre. 11
sera inscrit entre guillemets tandis que le nom latin autant que possible sera imprimé en
italiques. Dans la désignation des noms, on fera suivre le nom de la plante du nom de